|
 |
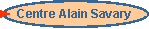 |
EPS
et activités sportives
|
|
Pour
une approche anthropologique en EPS
4e
Biennale de l’éducation et de la formation Revue EPS n° 277 Mai/Juin
1999
MARC
DURAND,
IUFM MONTPELLIER, Professeur des universités,
SOMMAIRE
:
 Approche
naturaliste de l'apprentissage et de la motivation
Approche
naturaliste de l'apprentissage et de la motivation
 Approche
prescriptive
Approche
prescriptive
-
Deux axes d'interrogation me paraissent pouvoir nourrir cette réflexion
relative à l'apprentissage et à la motivation des élèves en éducation
physique et sportive : le premier concerne le caractère dominant de
l'approche naturaliste de ces questions, le deuxième la prééminence d'une
conception prescriptive tant en ce qui concerne l'apprentissage et la
motivation, que les relations entre recherche et pratique éducative.
-
 Approche
naturaliste de l'apprentissage et de la motivation
Approche
naturaliste de l'apprentissage et de la motivation-
-
Sans que l’on puisse parler d'un modèle unique, la réflexion et les
débats relatifs à l'apprentissage moteur et à la motivation des élèves
en éducation physique et sportive sont dominés par une conception
cognitiviste. Cette conception met l'accent sur les processus de traitement
de l'information, les modalités de contrôle moteur, l'acquisition et l’organisation
de connaissances, le contrôle cognitif de la motivation et des émotions.
l'activité de délimitation et de choix de buts, puis de réduction
d'écart par rapport à ces buts, etc.
- L’individu
qui apprend est envisagé par analogie avec un système qui traite de
l'information, .stocke des connaissances sous forme de symboles. calcule et
contrôle son comportement sur la base de ce calcul. Selon ce point de vue.
l'action est la simple résultante des processus cognitifs considérés
comme organisés à un niveau séparé et autonome. Par conséquent et en
toute logique, l'action du professeur d’EPS doit être dirigée non en
direction de la motricité, des émotions, des affects des élèves... mais
de ces processus cognitifs qui les contrôlent.
- Une
telle conception a permis des avancées importantes : notamment la
conception de ces deux niveaux d'organisation, le niveau de surface et le
niveau profond, lève un certain nombre de naïvetés relatives à
l'apprentissage par répétition ou par imitation de modèles. Elle est
aussi porteuse d'apories et de difficultés.
-
-
Elle n'est pas apte à rendre compte de la dimension subjective de
l'expérience humaine (à l'inverse elle est construite à partir du refus
de cette prise en compte de la subjectivité au plan scientifique) de sorte
que seul le point de vue neutre de l'observateur extérieur est considéré
valide. D’où une tendance à ne pas prendre en compte cette subjectivité
(ou alors seulement sa maîtrise cognitive, ce qui se retrouve par exemple
lors de l'énonciation d'objectifs éducatifs tels que « le contrôle des
émotions ,), et à se défier de tout ce qui relève de l'expérience et du
vécu phénoménologique.
- Elle
ne peut expliquer ni rendre compte de la signification ou du sens de
l'expérience scolaire pour les élèves et le professeur dans la mesure
où, basée sur des modèles « computationnistes ». elle n'étudie que la
« partie sèche » de la cognition considérée comme un calcul opérant
sur des symboles. La signification demeure étrangère à cette conception
qui s'est constituée en approche scientifique à partir du choix de ne
considérer dans l'information que l'aspect quantitatif et syntaxique, à
l'exclusion des contenus sémantiques. Par conséquent, la signification
n'est pas envisagée ou (ce qui me semble plus problématique encore) est
appréhendée en terme de représentation d'un sens déjà là, inhérent
aux objets et aux pratiques (il y aurait une signification du volley-ball,
une logique interne des APS… indépendamment des acteurs, des joueurs, des
élèves !).
- Enfin
n'ayant pas une vision unitaire ou intégrative de l'activité des élèves,
cette conception échoue à rendre compte de leur action en situation
scolaire habituelle : elle se borne à expliquer des secteurs du
comportement à partir de théories régionales (de l'attribution causale,
de la fixation des buts, du contrôle des mouvements balistiques, de la
prise de décision en situation improbable, etc.). Le sujet est considéré
comme le support d'un certain nombre de processus envisagés séparément et
en direction desquels l'enseignant intervient spécifiquement. De sorte que
l'action des élèves en classe est, soit réduite à ces processus
régionaux, soit considérée comme ne relevant pas de la science.
-
-
Cette conception a trois conséquences majeures. La première est que, munis
de cette vision fragmentée, les chercheurs évitent généralement de
s'attaquer es qualité, à des questions d'éducation. L'incapacité à
rendre compte d'actions aussi complexes que l'éducation, liée au primat
d'une pensée analytique décomposant la vie (et la pédagogie) en variables
isolées et quantifiables provoque une réduction de la pensée en
éducation à l'évocation de sous-phénomènes tels que la réaction à un
échec, l'intégration des feedback, l'affrontement de la difficulté de la
tâche, l'effet de la variabilité des conditions de pratique, etc.
L'argument, souvent avancé par les chercheurs, de l'existence d'un
décalage entre le moment de la production d'une connaissance et celui de sa
possibilité d'exploitation concrète apparaît comme une figure de
rhétorique masquant l'absence de réflexion globale sur la finalisation de
la recherche. Cet espace de réflexion laissé vacant par eux est alors
occupé au nom d'autres
légitimités.
- Une
deuxième conséquence de cette conception est l'accent placé sur la notion
(polysémique et de moins en moins précise) de représentation. En effet,
ayant a priori découpé le sujet en secteurs. en fonctions ou en domaines,
il est ensuite nécessaire pour assurer une unité (voire une
individualité) à l'ensemble, de faire référence à des éléments
médiateurs. Les représentations sont censées tenir ce rôle : lieu entre
l'intention et l'action par le biais de l'image de soi, de la compétence
perçue, des images de buts lien entre l'intention et le mouvement par le
biais des programmes moteurs, des images mentales motrices…lien entre la
perception et le mouvement. entre le mouvement et la compréhension : lien
entre les APS et l'élève par le biais des représentations, sociales des
sports ... De sorte que les représentations apparaissent l'alpha et
l'oméga de l'éducation et de l'EPS, inspirant une EPS exagérément
intellectualiste, désincarnée, dé-corporéisée. Pris dans cette
dynamique, les professeurs d'EPS ont alors l'illusion de tout comprendre par
la seule référence à la notion de représentation.
- Enfin,
la troisième conséquence importante et négative de la prééminence de ce
modèle naturaliste est de concevoir la culture comme extérieure au sujet :
les APS constituent un ensemble pré-donné, déjà là, de formes
culturelles héritées de l'histoire sociale et que les élèves doivent
acquérir. Le seul élément culturel au sein des phénomènes d'acquisition
est le contenu de l'apprentissage (culture extérieure à l'élève). La
cognition, elle, relève de la biologie. De nombreux auteurs s'élèvent
aujourd'hui contre cette conception (l’un des plus véhéments est J.
Bruner dont la conférence introductive à cette Biennale de l’Education
et de la Formation est un plaidoyer pour une approche culturelle de la
cognition) et récusent d'une part une conception réifiante des rapports
entre culture et cognition, d'autre part l'idée que la cognition humaine
puisse être appréhendée de façon pertinente d'un seul point de vue
naturaliste. A ce titre, on remarquera que ce symposium, organisé en deux
tables rondes distinctes, reproduit et renforce cette césure entre les
sciences de la vie, qui n'auraient qu'à se préoccuper des processus
d'apprentissage et de motivation (et surtout de processus de contrôle), et
les sciences humaines et sociales qui devraient se préoccuper du sens et
des contenus, des APS. des pratiques sportives nouvelles... mais pas des
processus d'apprentissage (d'ailleurs le modèle est bien installé qui
génère une double naïveté : celle du psychologue lorsqu'il ose parler de
la culture ; celle du sociologue à propos de la cognition).
-
-
Parce que cette approche naturaliste divise, sépare, isole, elle entretient
un débat stérile et redondant entre les tenant d'une EPS culturelle
centrée sur la transmission et le partage d'une culture sportive, et les
tenants d'une conception a-culturelle. centrée sur des objectifs de
développement des potentialités humaines. Cette pensée analytique et
réificatrice exclut les analyses dialectiques et dynamiques, positionnant
toute visée éducative en tension entre ces deux composantes dont il
importe de n'abandonner ni l'une ni l'autre.
-
 Une conception
prescriptive
Une conception
prescriptive-
-
Cette conception naturaliste peut aussi être qualifiée de prescriptive.
Elle l'est à un triple titre :
-
-
En premier lieu, poser la cognition comme un système autonome indépendant
de la motricité ou de la motivation, c'est lui octroyer un rôle
prescripteur : le mouvement, l'action sont proscrits par la cognition. Cette
conception, on l'a vu, revient à attribuer à la cognition un statut causal
et a pour conséquence ce qu'on pourrait appeler une « dérive
intellectualiste et "représentationniste" de l'EPS.
- En
second lieu, l'explication des conduites des élèves est proposée à
partir d'un système de relations linéaires : tâche-activité
performance. En d'autres termes, ce que fait l'élève résulte de son
activité (essentiellement) cognitive, et cette activité est elle même
dépendante du système de contrainte instauré par le professeur : la
tâche. Cette relation causale linéaire peut être encore allongée de un
ou deux termes dans
la mesure où la tâche que le professeur prescrit est elle même le
résultat de son action, elle aussi résultant de l'activation de ses
processus cognitifs,... L'action pédagogique est donc un agencement
linéaire de prescriptions. Cette linéarité fait d'ailleurs dire à
certains chercheurs critiques que l'on aboutit à une régression à
l'infini et que l'on échoue in-fine à procurer une explication valide de
la motivation et de l’apprentissage ; il est théoriquement toujours
possible d'identifier un élément de statut causal supplémentaire
expliquant la cause de la cause de la cause. etc. Une telle conception est
susceptible d'une autre critique : le fait de ne pas distinguer la « tâche
» de la « situation », et de poser par principe une antériorité de la
tâche sur l'activité des élèves, revient à allouer à cette activité
cognitive de l'élève, un rôle captif et contraint de redéfinition de la
tâche. Il peut être substitué à cette conception un modèle mettant
l'emphase sur l'activité constructrice de l'élève, qui, confronté au
système de contraintes mis en place par l'enseignant développe une
activité de construction, de signification et de délimitation des
possibles pour l'action en classe. Bien que contrainte, cette activité est
fondamentalement et essentiellement autonome. Elle est à l'origine de
l'édification de couplages "action-situation" singuliers
et d'un système de causalité circulaire : la situation (c’est-à-dire ce
qui est significatif pour l'élève dans le contexte et qui perturbe son
action) définit l'action qui définit la situation, etc. Cette
co-définition de l'action et de la situation implique d'envisager une
dynamique interne ou intrinsèque à ces couplages et à penser autrement la
motivation et l'apprentissage. Sans entrer dans le détail, cela revient à
mettre au premier plan l'intentionnalité des élève, envisagée au sens
d'un "être à la situation" les impliquant dans leur
intégralité, et non pas seulement une activité raisonnable de codage,
choix, sélection de buts et sous-buts. L'apprentissage enfin n'est pas
conçu comme un processus isolé, distinct mais comme une suite de
réorganisations dynamiques de l'action, dans et par l'action, irréductible
par exemple à la construction d'un programme ou à un transfert dans les
modalités de contrôle moteur.
-
-
Enfin, cette conception est aussi prescriptive dans le mode de relation
qu'elle instaure et conceptualise entre chercheurs et enseignants. Il est
considéré que les chercheurs sont les détenteurs de la connaissance
noble, experte, juste. Eux sont par conséquent, à l'origine des progrès
et des innovations. Les professeurs, engagés dans des actions visant une
efficacité à court terme, ne peuvent opérer le recul objectivant et
réflexif nécessaire pour une connaissance débarrassée de ses scories et
ses scléroses. Par conséquent la connaissance du praticien est
considérée comme fondamentalement fausse, lacunaire et biaisée (en raison
de sa visée pragmatique, opérative) et celle du chercheur juste (en raison
de sa visée contemplative et de sa distance par rapport à la pratique). La
relation chercheur ‑praticien est donc univoque et simple : le
chercheur énonce des lois et des règles (il prescrit) et le praticien
applique ces règles et préceptes. Une telle conception est aujourd'hui
l'objet de vives discussions. Deux types, d'arguments sont avancés.
- Le
premier est que si la source d'innovation que représentent les chercheurs
n'est pas négligeable (encore qu'il reste à évaluer avec précision
l'impact réel des propositions émanant des laboratoires et ayant été
effectivement relayées dans les gymnases et les stades), en revanche, les
pratiques ne sont plus considérées comme des champs clos sur eux mêmes et
sclérosés. Les professeurs sont des professionnels, leurs actions sont
complexes. et leur activité quotidienne est aussi une activité créatrice
innovante.
-
-
De sorte que la source essentielle d'innovation. de progrès est à
rechercher non chez les chercheurs qui ne sont que ponctuellement et
transitoirement investis dans des actions d'innovation pédagogique ou
didactique, mais chez les professeurs eux‑mêmes soumis en permanence
à une pression adaptative (toujours forte quel que soit le milieu où ils
interviennent).
-
-
Le deuxième argument tient à la nature même de l'activité d'enseignement
: elle est de plus en plus décrite comme complexe, dynamique, imprévisible
et irréductible à l'application des règles ou des algorithmes énoncés
par les chercheurs. De sorte que l'emphase est en train de se déplacer vers
l'analyse des composantes de cette « sagesse de la pratique » et des
modalités les plus efficaces de sa transmission ou acquisition. Les
recherches visant l'élucidation des composantes de cette expertise
révèlent une épaisseur professionnelle et humaine conduisant à douter de
l'efficacité des prescriptions simples émanant du laboratoire du double
point de vue de leur capacité à rendre compte de phénomènes aussi
complexes d'une part, de leur efficacité concrète d'autre part. En
d'autres termes, si les théories psychologiques de la motivation et de
l'apprentissage sont de quelque intérêt en formation des enseignants,
c'est davantage comme éléments susceptibles de nourrir le répertoire de
connaissance des, professeurs que comme bases, opérationnelles pour leur
action quotidienne.
-
-
Ces remarques sans doute caricaturales et schématiques sont un double
plaidoyer. Elles constituent un appel au débat, à la réflexion commune
(dans le prolongement de ce symposium initié par la Revue EPS), beaucoup
plus qu'une prise de position normative et péremptoire, Elles manifeste
aussi le souhait du développement d'une approche anthropologique
(culturelle et cognitive) en éducation et en EPS, qui ne dédaigne pas une
visée utilitaire et finalisée.
-