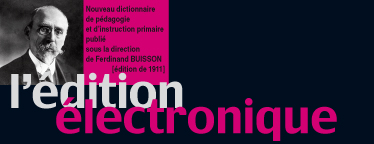 |
bBarrau (Théodore-Henri)Littérateur et publiciste français, né à Toulouse le 18 octobre 1794, mort à Paris le 19 mai 1865. Il entra de bonne heure dans l'Université et occupa dix ans la chaire de rhétorique au collège de Niort. En 1830, il fut appelé à celui de Chaumont, comme principal chargé du même cours. Ce collège, sous sa direction, devint en peu de temps l'un des plus florissants de la contrée. Déjà à cette époque, M. Barrau, bien qu'appartenant à l'enseignement secondaire, se préoccupait des questions relatives à l'enseignement populaire que la loi de 1833 avait soulevées. Aussi, en 1840, prit-il part à un concours proposé par l'Académie des sciences morales et politiques sur cette question : « Quels perfectionnements pourrait recevoir l'institution des écoles normales primaires, considérée dans ses rapports avec l'éducation de la' jeunesse », et, sur un rapport bien connu de Jouffroy, il fut jugé digne du prix, en même temps que M. Prosper Dumont, alors inspecteur de l'enseignement primaire à Fontainebleau, obtenait, sur le même sujet, une médaille d'or d'égale valeur. Jouffroy constatait dans le mémoire de M. Barrau de hautes qualités d'intelligence et de caractère, « le sens politique et pratique, la maturité du jugement, une sagesse d'esprit et une sûreté de vues qui ne se démentent jamais un moment ». Le style, ajoutait Jouffroy, est en rapport exact avec les idées : « il est simple et ferme ; la phrase serrée et rapide va droit à la pensée, qu'elle exprime toujours avec énergie, souvent avec un bonheur de tour et d'expression qui n'est jamais recherché ». Tel était alors M. Barrau ; tel il resta dans la suite de sa vie, qu'il consacra bientôt tout entière à l'instruction primaire, lorsque en 1845 l'âge de la retraite lui permit de quitter l'enseignement. Il vint alors habiter Paris, où l'appelaient en particulier ses relations avec M. Hachette, dont il fut constamment l'un des plus intimes et des plus dévoués amis. M. Barrau entra à cette époque dans la rédaction du Manuel général de l'instruction primaire ; il en devint quelque temps après le rédacteur en chef, et il fit de cette publication, en lui donnant ce caractère de bon sens et de mesure qui était comme la marque de sa propre personnalité, un des organes les plus autorisés de l'instruction primaire en France. Aussi, quand vinrent les mauvais jours de 1850 et des années qui suivirent, M. Barrau put-il prendre hautement la défense des instituteurs. Il fut, à cette même époque, le défenseur courageux des écoles normales, publiquement dénoncées à la tribune comme des « académies au petit pied », et dont la suppression ne tint qu'à un fil. M. Barrau a composé de nombreux ouvages, dont les principaux, destinés soit aux maîtres, soit aux élèves, ont eu de nombreuses éditions et sont très justement restés populaires, comme les Directions morales pour les instituteurs, les Devoirs des enfants envers leurs parents, le Livre de morale pratique, et la Patrie. En 1864, l'année qui précéda sa mort, M. Barrau avait obtenu le prix Halphen, décerne par l'Académie des sciences morales et politiques à ceux qui se sont exceptionnellement signalés pour des services rendus à l'instruction populaire.
Charles Defodon
|
