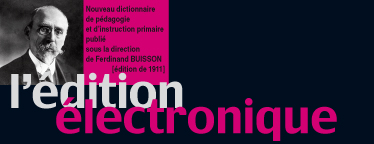 |
zZschokkeHenri Zschokke naquit à Magdebourg, en Saxe, en 1771. Resté orphelin de bonne heure, il eut une enfance triste ; ce fut seulement lorsqu'à l'âge de dix-neuf ans il eut obtenu de son tuteur la permission d'aller achever ses études à l'université de Francfort-sur-l'Oder qu'il sentit son coeur et son esprit s'éveiller aux joies de la vie et de la science. Ses études terminées, il devint Privat-Docent à l'université, et fit avec succès des cours sur l'histoire, le droit naturel, la philosophie morale et l'esthétique. En 1793 il publia son premier livre, les Idées sur une esthétique psychologique (Ideen zur psychologischen Aesthelik). Dans son ardeur juvénile, il avait attaqué avec une imprudente franchise les abus qu'il voyait autour de lui ; aussi, lorsque après deux années d'enseignement il posa sa candidature à une chaire de professeur, se la vit-il refuser net par le ministre prussien von Wöllner. Profitant alors de l'indépendance que lui assurait une petite fortune, il quitta l'Allemagne, visita l'Italie, la Suisse, Paris, et en 1796 se fixa dans les Grisons, où il obtint à l'âge de trente-cinq ans le poste de directeur du célèbre institut de Reichenau. Il se consacra avec ardeur à sa tâche, et chercha à faire de l'institut une pépinière de chauds patriotes, animés de l'esprit nouveau de tolérance et de l'amour du bien public. Il écrivit pour les écoles des Grisons un petit livre (Das nette und nützliche Schulbüchlein zum Gebrauche fur die wissbegierige Jugend im Bündnerlande) qui se répandit rapidement dans le pays rhétien, où il rendit de réels services comme manuel scolaire ; et une histoire populaire des trois Ligues grisonnes (Die drei ewigen Blinde im hohen Rhätien, Zurich, 1798). Mais il ne put rester que deux années à Reichenau. Au milieu de 1798, les paisibles vallées des Grisons se virent soudain transformées en champ de bataille des armées autrichiennes et françaises ; Zschokke, signalé aux Autrichiens comme « patriote », dut se réfugier en Suisse. Là il trouva, auprès du gouvernement helvétique qui avait fixé son siège à Lucerne, un nouvel emploi de son activité ; entouré d'hommes avec lesquels il se sentait en communauté d'opinion, le ministre Stapfer, Paul Usteri Pestalozzi, etc., il fonda un organe de propagande démocratique, le Schweizerbote. auquel succéda ensuite un autre journal, Der helvetische Genius. Mais Zschokke posa bientôt la plume du publiciste pour entrer au service du gouvernement helvétique comme commissaire administratif, et il fut envoyé en mission dans les petits cantons d'abord, puis dans le Tessin et à Bâle. Au cours de la première de ces missions, il eut à s'occuper de l'orphelinat de Stanz, dont la direction avait été confiée à Pestalozzi. Zschokke prêta son concours dévoué au développement de cette intéressante institution ; mais, après un essai de quelques mois, il jugea, comme l'avaient fait les membres du comité administratif de l'établissement, que Pestalozzi avait entrepris une oeuvre au-dessus de ses forces. Ce fut lui qui, en qualité de commissaire du gouvernement, procéda, en juin 1799, à une réorganisation de l'orphelinat, dont il dut éloigner Pestalozzi, fatigué et malade. La conduite de Zschokke dans cette affaire a été diversement jugée ; le ministre Stapfer, dans un rapport au Directoire helvétique, l'accusa de s'être laissé aller contre Pestalozzi à des préventions injustes ; mais le Directoire donna raison à son commissaire. L'impartialité de Zschokke ne saurait donner lieu à aucun doute, et la postérité, croyons-nous, a ratifié sa décision, dictée par le bon sens et une saine appréciation des circonstances. Du reste, Zschokke et Pestalozzi n'en demeurèrent pas moins unis par les liens d'une durable amitié. Lorsqu'en 1802 le parti unitaire fut renversé du pouvoir par les fédéralistes, Zschokke rentra dans la vie privée. Il s'établit dans le canton d'Argovie, où il s'était fait naturaliser citoyen suisse. Il reprit alors la plume, et écrivit d'abord un récit des principaux évènements de la révolution helvétique (Historische Denkwürdigkeiten der helvetischen Staatsumwälzung, 1803-1805) ; puis il ressuscita le Schweizerbote, qui reparut en 1804 et dont il continua la publication pendant trente-huit années. C'est dans ce journal que parurent la plupart des contes et nouvelles qui ont rendu le nom de Zschokke si populaire en Suisse et en Allemagne : le Village des faiseurs d'or, la Peste de l'eau-de-vie, Maître Jordan, etc. Son Histoire de la Suisse, écrite en style populaire, toute vibrante des accents du patriotisme le plus pur et le plus élevé, est un véritable chef-d'oeuvre, qui a puissamment contribué à réveiller dans la jeune génération l'esprit national. Non moins grande a été l'influence de ses Heures de recueillement (Stunden der Andacht), qu'il publia de 1809 à 1816 sous la forme d'un journal hebdomadaire, et qui répandirent dans un nombreux cercle de lecteurs les principes d'une morale véritablement laïque, affranchie de tout dogmatisme confessionnel. Zschokke contribua aussi directement aux progrès de l'éducation populaire dans son canton d'adoption : il fut pendant de longues années inspecteur des écoles, et fit une active propagande en faveur de l'enseignement mutuel, qui était alors regardé par la plupart des esprits libéraux comme le plus puissant moyen d'émancipation des intelligences. C'est à son initiative que sont dues la fondation de l'école professionnelle (Gewerbeschule) d'Aarau en 1827 et de l'Institut des sourds-muets d'Aarau en 1835 ; il s'occupa aussi avec zèle de l'organisation d'une Association d'enseignement (bürgerlicher Lehrverein), dont les cours étaient destinés à donner un supplément d'instruction à la jeunesse sortant des écoles primaires et qui ne pouvait recevoir l'enseignement des écoles d'ordre supérieur. Il est mort à Aarau le 27 juin 1848, à l'âge de soixante-dix-sept ans, laissant le souvenir d'un homme de bien, d'un patriote désintéressé, et d'un remarquable écrivain populaire. |
