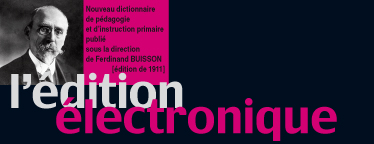 |
tTurgot (écoles)On a désigné assez longtemps sous ce nom les cinq établissements d'enseignement primaire supérieur fondés et entretenus par la ville de Paris. L'école Turgot, la première en date (1839), a servi de type à ses soeurs cadettes : l'école Colbert (novembre 1868), l'école Lavoisier (octobre 1872), l'école Jean-Baptiste Say (janvier 1873) et l'école Arago (octobre 1880). Les commencements de l'enseignement primaire supérieur à Paris furent modestes. A ses débuts, l'école de la rue Neuve-Saint-Laurent (aujourd'hui rue du Vert-Bois) ne comptait que 96 élèves externes, dont 20 boursiers nommés au concours, La rétribution mensuelle des élèves payants était de 15 francs, dont 3 pour l'abonnement aux fournitures scolaires. C'est à, Pierre-Philibert Pompée, qui devait fonder plus tard l'école professionnelle d'Ivry, que revient l'honneur d'avoir jeté les bases de l'enseignement destiné à former les sous-officiers de l'industrie et du commerce. L'article 1er de la loi du 28 juin 1833 en déterminait les matières : « L'enseignement primaire supérieur comprend, outre les matières de l'enseignement élémentaire, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, le dessin linéaire et l'arpentage, des notions de sciences physiques et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie et surtout l'histoire et la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources de la localité, — était-il ajouté sagement, — l'instruction primaire recevra les développements qui seront juges convenables. » Ce programme, réparti en trois années, a été appliqué successivement, au fur et à mesure que les familles prenaient confiance dans l'école. Après trois ans d'exercice, les cadres étaient formés. Les élèves n'étaient admis à l'école supérieure qu'à l'âge de douze ans, et après un examen constatant qu'ils possédaient les connaissances primaires. Pompée ne fut pas longtemps sans reconnaître la nécessité de recueillir dans une division spéciale une partie des nouveau-venus, pour les élever à un niveau commun avant de les aire entrer dans le cours normal : l'année préparatoire fut créée dès 1843. Dans la répartition des matières d'enseignement entre les trois années du cours normal, Pompée se préoccupa avec raison du temps que les enfants, selon leur position de fortune ou leur capacité, pourraient passer à l'école supérieure, ceux-ci une année, ceux-là deux, d'autres trois. Les programmes furent disposés de telle façon que l'enseignement offrît dans chaque année un ensemble régulier, bien qu'avec des parties inégalement approfondies, de connaissances appropriées à l'âge et au développement intellectuel de l'élève. Chaque année représentait en quelque sorte une école distincte, c'est-à-dire une école dont le programme pourrait être complètement épuisé pendant la durée d'un an. L'école supérieure exigea une organisation du personnel enseignant tout autre que celle des écoles élémentaires. Là, un maître unique était chargé des diverses branches de l'enseignement ; ici il fallut cinq ou six professeurs spéciaux : l'instruction morale et religieuse était donnée par un ecclésiastique ; à un autre professeur étaient confiées la lecture expressive, la langue maternelle, l'histoire et la géographie ; à un troisième les mathématiques ; à un quatrième les sciences physiques et naturelles ; à un cinquième l'enseignement du dessin linéaire géométrique et du dessin d'ornement. Les professeurs étaient secondés dans leur tâche par des répétiteurs surveillants, auxquels il était réservé d'enseigner l'écriture et le chant. Cette organisation d'études était soutenue par une forte discipline morale. Le successeur de Pompée, Emile Marguerin, a tracé de main de maître la description de cette discipline qui laisse peu à l'arbitraire des maîtres, ne recourt à aucun moyen violent ou humiliant, répudie la règlementation excessive et le vain entassement des tâches scolaires. « En effet, notre discipline repose presque entièrement sur un système tout idéal de punitions qui n'entraînent pas de peines réelles, et de récompenses qui ne confèrent aucun privilège. L'élève a la honte d'une punition ; il a l'honneur d'une récompense. Les sanctions sont les suivantes : on est classé chaque semaine, d'après le nombre de récompenses obtenues dans la semaine, les punitions étant défalquées, mais restant sur le livret de l'élève en regard des récompenses. Le livret expliqué, commenté, est porté le samedi à la connaissance de la famille. On est classé, chaque mois, d'après le nombre des récompenses méritées dans le mois ; on a son rang, du premier au dernier, sur le tableau de classement, lequel est lu par le directeur, et affiché ; on occupe aux tables le rang que le numéro de classement assigne. Si les punitions atteignent un chiffre qui varie selon les divisions, on avertit l'élève publiquement qu'il perd son temps et ! ne mérite pas les sacrifices faits pour lui par ses. parents. S'il continue, il est mis à l'ordre du jour. Après un second ordre du jour, on expose la situation à la famille et on l'invite à retirer l'élève pour éviter le renvoi officiel. Voilà le système. Il est beaucoup plus efficace qu'on ne le croirait a priori. Toutes les fois qu'il est manié habilement, il suffit pour conduire une division, sans retenues, sans autres punitions que des devoirs à refaire ou des leçons à rapprendre. » Déjà l'enseignement de l'école Turgot portait ses fruits : les élèves sortants commençaient à être recherchés et trouvaient des positions honorables et lucratives dans les bureaux et les comptoirs de la finance et du commerce, dans les ateliers manufacturiers et artistiques, dans les administrations publiques et privées. Déjà l'école Turgot pouvait être considérée comme un type à prendre pour la création d'établissements similaires, lorsque survint la loi du 15 mars 1850 qui supprima l'enseignement primaire supérieur. Pompée, ne jouissant plus de la liberté d'action dont il avait besoin pour compléter son oeuvre, donna sa démission au mois de décembre 1852. (Voir Pompée.) Le second directeur de l'école Turgot, Emile Marguerin (Voir Marguerin), en homme vraiment supérieur, eut d'abord le rare mérite d'accepter le plan de l'édifice commencé avant lui. Mais il sut avec un remarquable esprit de sagesse l'asseoir sur les bases les plus solides, le grandir sans sortir des lignes principales, le développer enfin dans les plus larges proportions. « Nul peut-être de notre temps, a dit Gréard le jour des funérailles du second fondateur de l'école Turgot, n'a mieux compris le caractère pédagogique et la portée sociale de cet enseignement destiné aux classes moyennes, dont MM. Guizot, Saint-Marc Girardin, de Salvandy, avaient si bien marqué la place entre l'enseignement primaire et l'enseignement classique, sous le nom d'enseignement intermédiaire. » Marguerin maintint l'école Turgot sur le terrain ferme où elle s'était tout d'abord placée. Le caractère de l'enseignement resta le même : celui d'un enseignement général tendant à la pratique, mais ne s'y engageant pas, se tenant scrupuleusement à égale distance de l'enseignement classique et de l'enseignement technique, s'appropriant aux besoins de ses disciples, des enfants de la classe moyenne et de l'élite de la population ouvrière, ne les formant directement à aucune profession et les préparant à toutes, — celles, bien entendu, qui se rattachent à l'industrie et au commerce. Fort de cette idée que l'enseignement primaire supérieur doit être poussé plus loin dans une ville de deux millions d'habitants que dans une ville de six mille âmes, Marguerin n'hésita pas à introduire à l'école Turgot tous les développements que n'interdisait pas la loi. C'est ainsi que, sous le couvert d'une intelligente interprétation de la législation de 1850, il ajouta aux programmes de son école les éléments de la mécanique appliquée et la tenue des livres. Les langues vivantes, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, furent à l'école supérieure ce que sont les langues mortes au lycée, un enseignement fondamental, avec celle différence toutefois que les professeurs devaient préparer leurs élèves à se servir un jour de la langue qu'ils avaient apprise. Le nombre des élèves augmentait chaque année : de 300 qu'il était en 1852, il était monte à près de 500 en 1856. Dans ce nombre il s'en trouvait quelques-uns de fort intelligents, qui montraient de réelles aptitudes pour les sciences. Qu'en fallait-il faire? les abandonner plus qu'à moitié route et les obliger à ne pas monter plus haut? Marguerin pensa avec juste raison que l'école qui avait suscité ces intelligences d'élite devait les soutenir jusqu'au bout. Il lui parut indispensable d'assurer la possibilité d'une instruction plus étendue et plus spéciale aux élèves susceptibles d'entrer dans les grandes écoles professionnelles qui n'exigent pas le diplôme du baccalauréat. De là la création de l'année complémentaire, création qui a heureusement achevé de donner à l'enseignement de Turgot son ensemble et sa portée. Le recrutement du personnel fut la plus grande préoccupation de Marguerin. Les maîtres qu'il fallait à l'école Turgot ne se trouvaient ni dans les écoles primaires ni dans l'enseignement secondaire. Il fallut les découvrir un à un, s'en emparer pour ainsi dire, et les initier à des méthodes qu'ils ne connaissaient pas. Marguerin eut la main heureuse : il s'entoura de professeurs qui surent le comprendre, travaillèrent avec ardeur à son oeuvre et firent sous sa direction des livres destinés à devenir la base de l'enseignement dans les écoles municipales. C'est cette collaboration notamment qui. dans l'étude de la langue française, a introduit l'exercice de la décomposition des mots et leur groupement en familles. Les programmes de l'enseignement secondaire spécial rédigés en 1865 empruntèrent presque en entier le plan du cours complet et gradué de comptabilité suivi à. l'école Turgot. C'est là encore que fut organisé l'enseignement du dessin géométrique, d'après des livres et des collections de modèles exactement appropriés aux degrés d'études que représente cette école. La première, à Paris, elle a mis en honneur les excursions scientifiques et les promenades instructives. Des notions d'économie politique, de législation usuelle, de droit commercial vinrent dans une sage mesure s'ajouter au cadre des études. La situation financière de l'école municipale supérieure répondait au succès des études. La rétribution mensuelle était restée fixée à 15 francs ; ce n'est qu'en 1875 qu'elle fut portée à 18 francs. C'est avec ce fonds, représentant annuellement 165 francs par tête d'élève, que l'école Turgot faisait face à ses dépenses ordinaires : traitement du personnel administratif et du personnel enseignant, acquisition du matériel d'instruction, bibliothèque, instruments de physique, collections d'histoire naturelle, etc. De 1852 à 1870, les recettes ont même notablement dépassé les dépenses : chose rare dans un établissement qui n'avait d'autres revenus que ceux d'un externat. En 1867, un arrêté préfectoral avait réglé d'une façon modeste, mais convenable, les traitements des directeur, préfet des études, agent comptable, surveillants généraux, professeurs, maîtres répétiteurs et agents du service. Le traitement annuel des professeurs, divisés en deux catégories, était calculé d'après le nombre d'heures de service : le taux minimum de l'heure, pour la première catégorie, commençant à 200 francs, pour s'élever, par augmentations triennales, jusqu'au maximum de 300 francs ; le taux de l'heure pour la seconde allant de 150 à 250 francs. Tous les traitements étaient susceptibles d'augmentations triennales. Le budget des dépenses de l'année 1867 était de 112 690 francs, celui des recettes s'élevait à 119 625. Le nombre des élèves dépassait 700. Depuis longtemps les bâtiments de la rue du Vert-Bois étaient devenus trop étroits pour contenir cette population scolaire. L'administration municipal qui soutenait puissamment les efforts de Marguerin, faisait construire, rue Turbigo, une nouvelle école, qui ne fut complètement terminée qu'au mois d'octobre 1874, mais qui fut occupée en partie dès 1869. Là. dans de vastes locaux, heureusement aménagés, l'école Turgot trouva des amphithéâtres, des laboratoires, des salles de manipulations, des bibliothèques, des collections d'instruments, d'appareils, etc., dignes de l'établissement qui a été le modèle du système. Répondant au voeu de la population parisienne, l'administration préfectorale avait chargé Marguerin d'organiser une seconde école supérieure municipale. L'école Colbert fut construite spécialement pour sa destination, suivant un plan très étudié, rue Château-Landon. Elle fut ouverte, avant le complet achèvement du bâtiment scolaire, en novembre 1868. Adolphe Focillon en fut le premier directeur, et Marguerin fut nommé administrateur des écoles municipales. Les événements de 1870 ne retardèrent qu'un moment les progrès des écoles municipales. Le personnel à cette époque se montra plein de coeur et de dévouement. Tandis que quelques professeurs, entraînés par un patriotisme exalté, quittaient Paris et prenaient les armes, les classes recommençaient au mois d'octobre 1870 à Turgot et à Colbert dans les amphithéâtres, les salles d'études étant converties en ambulances. Elles continuèrent sans interruption jusqu'au 11 mai 1871, jour où les délégués de la Commune vinrent réclamer la direction des écoles. Dès les premiers jours de juin, l'ancien personnel reprenait sa place et son travail comme si rien ne s'était passé. Le premier conseil municipal élu de Paris voulut doter la rive gauche d'une école du type Turgot. Marguerin choisit très heureusement, rue d'Enfer, au point d'intersection des Ve, VIe, XIIIe et XIVe arrondissements., les bâtiments laissés libres par le départ de l'Ecole spéciale d'architecture. Les travaux d'aménage ment furent vivement conduits et, dès la rentrée d'octobre 1872, l'école Lavoisier put ouvrir ses portes à 200 élèves. Quelques mois après, en janvier 1873, l'école d'Auteuil, qui reçut un peu plus tard le nom de Jean-Baptiste Say, fut installée dans des bâtiments qu'elle partagea avec l'école normale primaire de la Seine. Elle reçut des internes et des demi-pensionnaires ; mais son système d'études demeura identique à celui des autres écoles municipales. Un cinquième établissement fut appelé à desservir la région populeuse du sud-est de Paris. Il fut ouvert en 1880, sous le nom d'école Arago, dans un édifice spécial, construit place de la Nation. Pour la suite de ce qui concerne les écoles primaires supérieures de garçons de la Ville de Paris, Voir l'article Paris.
Gabriel-François Filon
|
