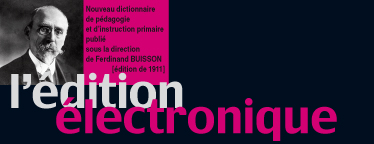 |
rRenouardAugustin-Charles Renouard, né à Paris en 1794, fils du libraire bien connu Antoine-Augustin Renouard, fut d'abord élève de l'Ecole normale supérieure, puis étudia le droit et devint avocat à Paris. De bonne heure il s'intéressa aux questions d'éducation : il fut l'un des secrétaires de la Société pour l'instruction élémentaire, et prit une part active à tous les efforts tentés sous la Restauration pour améliorer l'enseignement. En 1815, à vingt et un ans, il publie une brochure intitulée Projet de quelques améliorations dans l'éducation publique ; il y parle de la condition des maîtres d'étude, qu'il propose de remplacer par des moniteurs choisis parmi les élèves ; d'un meilleur emploi des récréations, dont les heures, c perdues souvent dans l'ennui, pourraient être utilement employées à tant d'agréables apprentissages » ; de l'étude des sciences, trop négligées dans les collèges. Deux ans plus tard, il prend part au concours ouvert par la Société pour l'instruction élémentaire pour le meilleur livre de morale populaire : le prix fut accordé au Simon de Nantua de L.-P. de Jussieu ; l'écrit de Renouard valut à son auteur une médaille d'or et fut publié en 1819 sous le nom d'Eléments de morale. C'est un traité dogmatique, divisé en trois parties, qui envisagent successivement l'homme dans ses rapports avec les autres hommes, dans ses rapports avec lui-même, et dans ses rapports avec Dieu. En 1824, Renouard lit paraître des Considérations sur les lacunes de l'éducation secondaire en France ; ce mémoire, écrit aussi à l'occasion d'un concours, ouvert en 1823 par la rédaction des Tablettes universelles, et auquel le jury, composé de Victor de Broglie, Guizot, Jomard et de Rémusat, décerna le prix, est des plus intéressants à consulter: on y trouve la première idée de l'enseignement primaire supérieur, que la loi de 1833 devait créer dix ans plus tard. L'auteur montre que l'enseignement secondaire, tel qu'il est organisé, ne peut convenir qu'à une très faible partie de ceux qui désirent s'instruire. « Que peut apprendre dans nos collèges, exclusivement consacrés aux études classiques, celui qui voudra conduire la charrue, manier le rabot, porter le mousquet? » L'instruction secondaire n'existe que comme apprentissage aux professions lettrées: c'est un mal dont on se plaint avec raison. Mais comment y remédier? « Les uns, pour rendre l'éducation secondaire plus accessible à la multitude, ont conseillé l'affaiblissement et presque la suppression de quelques-unes de ses parties les plus élevées. D'autres, au lieu de vouloir rabaisser l'éducation secondaire à la portée de la multitude, paraissent croire qu'on peut élever la multitude au niveau de l'instruction classique ; et ils pensent que tout serait gagné si le nombre des étudiants pouvait s'accroître dans nos collèges suivant une progression rapide. » Renouard rejette l'une et l'autre de ces solutions, et en propose une troisième : la création d'établissements qu'il appelle « écoles populaires du second degré », où serait donnée une instruction faisant suite à celle de l'école primaire, et différente de celle des collèges. « L'absence d'une éducation secondaire appropriée au besoin des classes laborieuses présente un inconvénient fort grave qui n'a pas été assez remarqué : c'est d'enlever à ces classes tout ce qui s'y rencontre d'esprits distingués, capables de les élever, de les ennoblir en quelque sorte tout entières. Quiconque sent en lui-même le besoin d'une éducation secondaire, ou appartient à des parents qui en comprennent la nécessité, se trouve entraîné insensiblement vers les professions lettrées, les seules auxquelles notre éducation s'adresse, et se voit, souvent malgré lui, poussé loin de la destination première que lui assignait sa position naturelle, et où se rencontrait peut-être sa place la plus utile. Les bourses accordées aux dispositions précoces entretiennent cet inconvénient, et présentent une sorte de prime au mérite pour le faire sortir des classes inférieures, qu'il importerait si hautement au contraire de ne pas dégarnir de lumières et appauvrir de talents. Il faut qu'on puisse aspirer à devenir un artisan instruit, sans devenir un artisan latiniste. Il faut permettre à un père d'être tout à la fois ambitieux pour l'intelligence et pour le coeur de ses fils, et modeste pour le choix de leur profession. » Les objets d'études des « écoles populaires du second degré » dont Renouard propose la création seraient la langue nationale, la morale, la géographie et l'histoire, les éléments des sciences naturelles et mécaniques, l'arithmétique et les éléments de la géométrie, le dessin, la gymnastique. La révolution de Juillet ouvrit à Renouard la carrière des hautes fonctions. Nommé d'abord conseiller d'Etat et secrétaire général du ministère de la justice, il fut élu en 1832 député de la Somme, et devint le rapporteur de la loi de 1833 sur l'instruction primaire. Il affirma dans son rapport, avec une grande hauteur de vues, sa foi dans le progrès social par l'instruction. « Ce qu'il adviendra de l'universalité d'enseignement, disait-il, ce que sera la société quand tous les citoyens sauront lire et écrire, quand les forces de leur pensée seront doublées, quand le sentiment complet de leurs droits et de leurs devoirs les suivra dans chacun des actes de leur vie publique et privée, nous l'ignorons tous. Mais ce que nous savons, c'est que cet avenir sera bon, parce que les instincts qui poussent l'humanité dans des voies morales ne sauraient être trompeurs. » En 1837, Renouard fut nommé conseiller à la Cour de cassation, et en 1846 il fut élevé à la pairie. Lors du coup d'Etat du 2 décembre 1851, ce fut lui que la Haute-Cour de justice chargea de rédiger le rapport sur la mise en accusation du président. Sous l'empire, il ne conserva que ses fonctions de conseiller à la Cour de cassation ; en 1869, il fut nommé conseiller honoraire. L'Académie des sciences morales l'admit dans son sein en 1861. Après la chute de l'empire, il rentra dans la vie politique : en 1871, à l'âge de soixante-dix-sept ans, il accepta les fonctions de procureur général à la Cour de cassation, qu'il résigna en 1877, au lendemain du 16 mai ; il devint alors président du comité de jurisconsultes dit de résistance légale. Il avait été élu sénateur en novembre 1876. Il est mort à Paris le 17 août 1878. |
