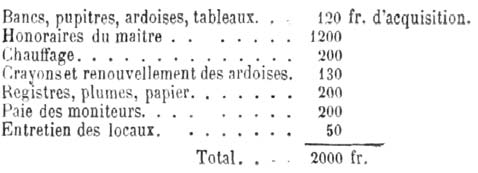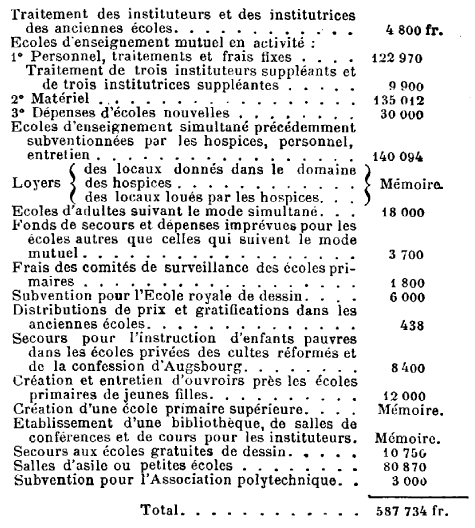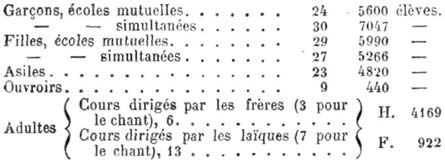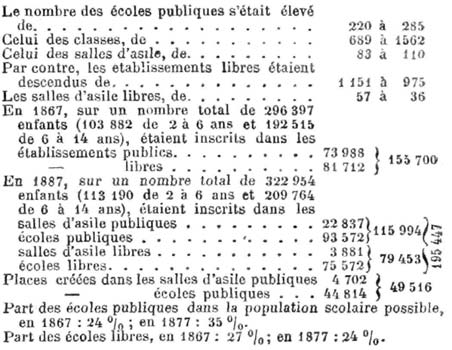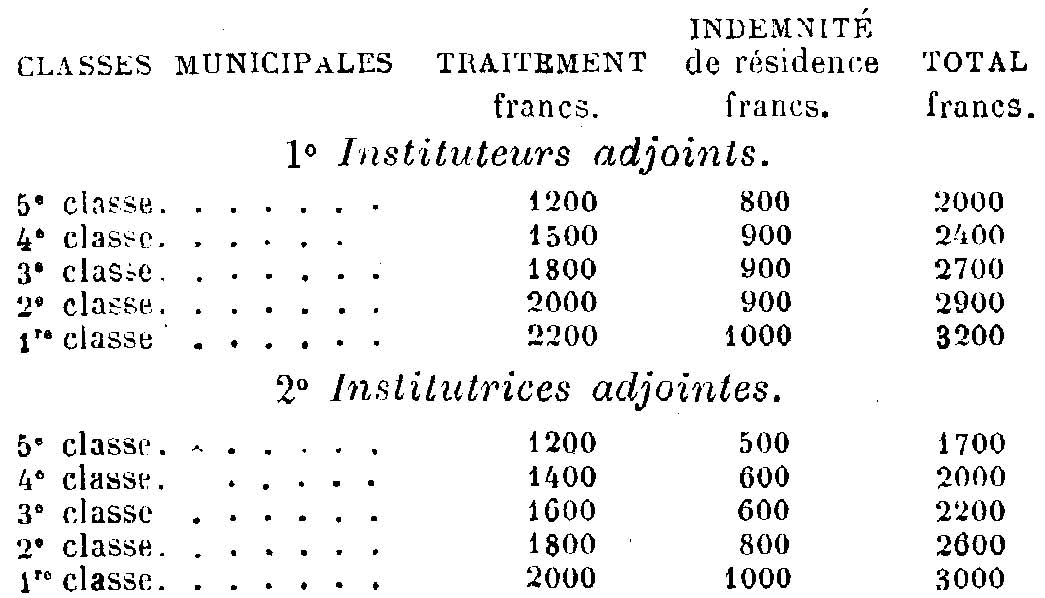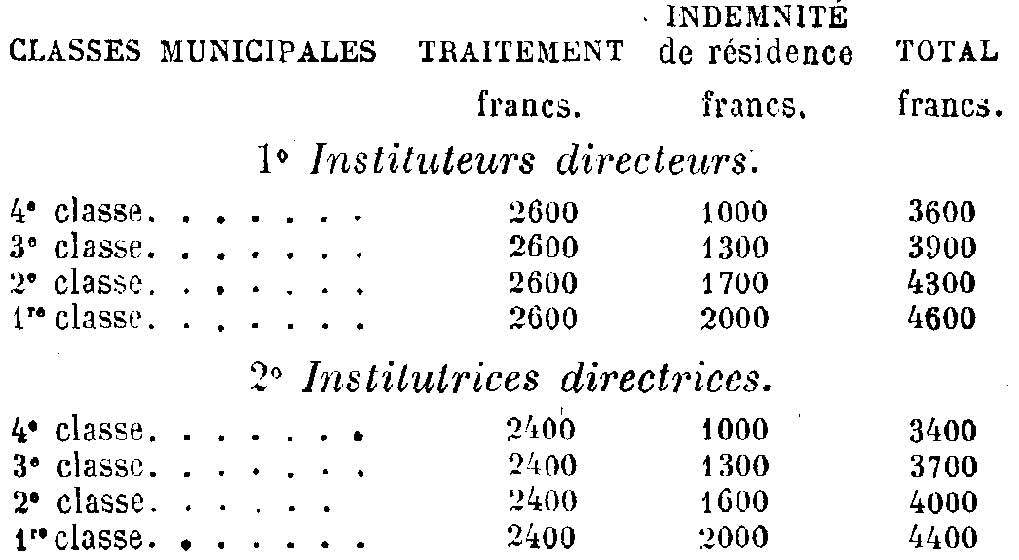|
pParisI. - Historique de l'enseignement primaire jusqu'en 1884. — L'ancien régime. — Pendant toute la durée du moyen-âge, Paris n'eut d'autres ressources, pour l'instruction des enfants pauvres ou peu aisés, que ce que l'on a appelé, jusqu'à la Révolution, les petites écoles. Ces établissements paraissent avoir eu pour origine l'école épiscopale installée dans le cloître Notre-Dame. Comme toutes celles du même genre, l'école épiscopale de Paris ne fut destinée tout d'abord qu'au recrutement des clercs, de même que les écoles claustrales servaient surtout au recrutement des moines. Les élèves devaient y être exercés « à la lecture, à la science des comptes et même à la grammaire » (concile de 789). Ils étaient confiés au chantre, le second dignitaire du chapitre. Peu à peu des externes séculiers furent adjoints aux jeunes clercs. L'école devint insuffisante, et l'on en établit de semblables dans chaque paroisse, puis dans chaque quartier, pour les garçons d'abord, puis pour les filles, et ce furent les petites écoles ou écoles de grammaire, placées sous l'autorité du chapitre de Notre-Dame et, par délégation, sous celle du chantre : Scholarum grammaticalium villae et banleucae Parisiensis collatio, institutio et destitutio, ac visitatio et omnimoda dispositio spectant ud Canlorem Parisiensem solum et in solidum (passage d'un ancien manuscrit intitulé : Antiquus liber D. Cantoris Parisiensis, recopié en 1357). Le chantre (Voir Chantre et Ecolâtre) avait des attributions fort étendues et remplissait, à l'égard des petites écoles, le rôle que remplit aujourd'hui l'autorité publique à l'égard des écoles primaires. Il avait un vice-gérant, un promoteur et un greffier. Il fixait le nombre des écoles et celui des élèves qu'elles pouvaient recevoir, et les visitait par lui-même ou par son délégué. Il avait son tribunal et tenait ses assises à l'officialité ; là, il jugeait les conflits, sauf appel au chapitre et plus lard au Parlement. Il rédigeait des statuts qu'il proclamait dans son synode annuel, sorte de conférence ou de congrès auquel tout le personnel enseignant : était tenu d'assister. Il recevait le serment des maîtres et maîtresses, leur renouvelait chaque année leurs lettres de maîtrise, et leur rappelait leurs obligations dans des sortes de mercuriales dont plusieurs nous ont été conservées. Son omnipotence, qui n'était que celle que possédait de tradition et que ne cessa de revendiquer le chapitre sur les petites écoles, ne fut pas toujours incontestée. Plus d'une fois l'Université, les maîtres-écrivains et le lieutenant civil dont ils dépendaient, et, plus tard, les curés de Paris, la tinrent en échec. La moralité de ses choix fut aussi plus d'une fois critiquée : dans un factum, le syndic de l'Université reprocha au chantre Claude Joly de mettre à la tête des écoles cantorales « des sergents, des fripiers, des fiacres, des gargotiers, des cabaretiers, des maçons, des perruquiers, des rubaniers, des fèrandiniers, des jardiniers, des violons, des joueurs de marionnettes, des fondeurs de cloche, et même ses propres laquais ». Pendant ces querelles, dont ils eurent plus d'une fois à souffrir, les maîtres et maîtresses d'école poursuivaient leur tâche, aussi pénible sans doute qu'aujourd'hui, car, dit l’auteur de l'Instruction méthodique pour l'école paroissiale, dressée en faveur des petites écoles, « l'exercice de ceux qui sont employés aux petites écoles est très rude et très pénible. Il faut qu'ils arrachent bien des épines sur les terres qu'ils défrichent avant que d'y voir des fruits. Comme l'emploi dont ils font profession est sans éclat, il est aussi sans plaisir et sans goût. » Ils se multipliaient à mesure que Paris s'agrandissait. Dans le rôle de la taille imposée en 1292 par Philippe le Bel sur les habitants de Paris, on voit figurer onze mesures d'école établis sur un certain nombre de paroisses, concourant à l'impôt en payant chacun le cinquantième de leur revenu. Un livre fort curieux, intitulé « Statuts et reglemens des petites écoles de grammaire de la Ville-Cité, Université, faux-bourgs et banlieuë de Paris, imprimé par l'ordre de Messire Claude Joly, chantre, et par les soins de Me Martin Sonnet, promoteur desdites écoles, » Paris, 1672, nous a conservé (p. 176) le procès-verbal, rédigé en latin, d'un synode tenu par le chantre Guillaume de Sauvreville, le 6 mai 1380, avec la liste nominative des maîtres et maîtresses qui y furent présents : ce document énumère 22 maîtresses et 41 maîtres, dont 2 bacheliers ès décrets et 7 maîtres ès arts, ce qui prouve que la fonction n'était point dédaignée. Le même livre indique de la façon la plus précise et la plus détaillée, pour l'année 1672, « les quartiers reglez et assignés aux maistres et maistresses d'écoles ». — « Ces quartiers, y est-il dit, reglez par Messieurs les chantres il y a longtemps, pour la demeure des maistres et des maistresses d'écoles, ont été divisés, assignés, et ainsi imprimez en faveur desdits maistres et maistresses pour leur plus grand bien, et pour éviter les differens qui pourroient arriver entr'eux, comme aussi pour la plus grande commodité du public, afin que lesdits maistres et maistresses en certains endroits ne fussent pas les uns contre les autres, et qu'en d'autres endroits il n'y eust ny maistres et maistresses, mais qu'en tous les quartiers le public trouvast des maistres et des maistresses logez en egale distance ou à peu près. Et comme à Paris il y a Ville, Cité et Université, et que dans chacune d'iceles il y a plusieurs paroisses, on a suivi cet ordre. Chaque paroisse a plusieurs differens quartiers, excepté quelque» petites, particulièrement en la Cité, qui n'en ont qu'un, et même sur quelqu'unes de ces petites paroisses un seul quartier comprend plusieurs desdites paroisses. Il y a dix-sept paroisses dans la Ville (rive droite), et dans icelles cent-quatre quartiers ; dans la Cité il y en a quatorze, et sur icelles onze quartiers ; et enfin dans l'Université (rive gauche) il se trouve douze paroisses, et dans icelles sont contenus cinquante-un quartiers : et cela fait le nombre de cent soixante-six quartiers dans quarante-trois paroisses, lesquels doublez pour les maistresses, font trois cens trente-deux, tant maistres que maistresses, sans la banlieuë. On y a ajouté aussi les paroisses des villages de la banlieuë de Paris, comme estant de toute antiquité de la jurisdiction de Monsieur le Chantre aussi bien que celles de la Ville. La banlieuë comprend environ trente-cinq à quarante villages ou paroisses, places, ruës, lieux, maisons, fermes ou hameaux. » Les 166 quartiers établis par le chantre sont énumérés aux pages 108 à 172 du volume. L'exemplaire que possède le Musée pédagogique porte, écrits à la main, à côté du nom de la plupart des quartiers, les noms des maîtres qui y exerçaient. Le mélange des sexes, l'admission par un maître ou une maîtresse d'enfants d'un sexe différent du sien, sont punis par l'excommunication, sans compter les amendes et le retrait de la lettre de maîtrise. Les buissonniers (ceux qui tiennent les écoles clandestines ou buissonnières), comme aussi ceux ou celles qui dépassent le nombre d'élèves prescrit, qui enlèvent des élèves à leurs voisins, qui s'établissent à moins de dix ou vingt maisons de distance d'une autre école, etc., encourent des peines plus ou moins graves. Pour enseigne, chaque établissement doit porter un tableau modeste, « sans ornements ni traits de plume », sur lequel on lit en gros caractères : « Céans Petite Ecole et le nom de celuy qui voudra mettre le dit tableau, et ensuite : Maistre d'école ayant droit et faculté d'enseigner à la jeunesse le Service, à lire, écrire et former les lettres, la grammaire, l'arithmétique et calcul, tant au jet qu'à la plume ». On commence, bien entendu, par la lecture du latin. Les enfants les plus intelligents étudient la grammaire latine, les autres sont exercés sur « les huit parties du discours », et apprennent l'orthographe, surtout au moyen de la copie. Tout écolier qui apprend à écrire apporte une main de papier, des plumes, un canif, une règle, un cornet à encre ; le maitre ou le moniteur lui trace un modèle au haut de la page. Les livres sont : l'alphabet, un livre latin intitulé Proverbia, un Nouveau Testament, un office de la sainte messe, la Vie des saints, les deux tomes de la Fleur des exemples, le Paradisus puerorum, des catéchismes, des petits livres à thèmes, un Apparat Royal, des rudiments, un traité de la civilité française, etc. L'installation est ce qu'elle peut ; souvent les garçons sont d'un côté sous la conduite de l'instituteur, les filles de l'autre, sous celle de sa femme. Mais de bonne heure on s'est fait un idéal sur les dimensions de la salle de classe, les fenêtres, les tables, les bancs, la cheminée, le cabinet d'aisance ; sur les méthodes et procédés à employer pour les diverses matières d'enseignement, le classement des élèves, les registres à tenir, le système disciplinaire à établir, le choix des officiers nécessaires au bon ordre : intendants, observateurs, admoniteurs, répétiteurs, récitateurs de prières, lecteurs, officiers d'écriture, receveurs pour l'encre et la poudre, balayeurs, porteurs de l'eau, portiers, aumôniers, visiteurs des familles [Instruction méthodique pour l'école paroissiale en faveur des petites écoles par M. I. D. B., prêtre, ouvrage dédié à M. le chantre de Paris, 1654, véritable manuel qui semble résumer la science pédagogique acquise et mise on pratique depuis longtemps dans les petites écoles). Les petites écoles étaient payantes. On y admettait gratuitement les enfants pauvres, en les tenant toutefois à l'écart, l'on devine pour quelles raisons. Mais soit que les locaux fussent insuffisants, soit que les maîtres et maîtresses eussent de la répugnance à les recevoir, un grand nombre de ces enfants demeuraient privés d'instruction, même d'instruction religieuse. Dès lors, « désirant remédier à l'ignorance qui régnait dans leurs paroisses, principalement parmi les pauvres dont les enfants, faute d'argent, ne pouvaient aller aux écoles ordinaires, demeuraient pour la plupart errants et vagabonds dans les rues, sans discipline et dans une ignorance extrême des principes de la religion, les curés de la ville crurent qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour y remédier que d'établir des écoles de charité dans les principales paroisses de la ville, où les pauvres pussent être instruits de leur catéchisme, et en même temps y apprendre à lire et à écrire gratuitement soit par les curés, soit par des ecclésiastiques par eux préposés ». Ce passage d'un plaidoyer prononcé le 23 janvier 1680 marque bien la nouvelle phase dans laquelle entra l'instruction populaire à Paris vers le milieu du dix-septième siècle : pour parer à l'insuffisance des petites écoles ou au peu de bon vouloir des maîtres et maîtresses à l'égard des enfants pauvres, les curés, les fabriques, des associations fondèrent des écoles de charité. On prit d'abord toutes les précautions possibles pour ne point éveiller les susceptibilités du chantre et de son personnel : on restreignit le programme à la lecture et au catéchisme ; on fit agréer les maîtres et maîtresses par le chantre et l'on soumit à son contrôle le rôle des enfants admis. Ainsi en agirent du moins Vincent de Paul, le curé de Saint-Laurent, celui de Saint-Eustache (1639). Mais d'autres furent plus osés : les curés de Saint-Roch, de Saint-Paul, de Saint-Louis-en-l'Isle, de Saint-Etienne-du-Mont, etc., s'attribuèrent le droit de choisir les maîtres et maîtresses et d'examiner « leurs vie, moeurs, conduite et capacité pour enseigner les pauvres enfants de la paroisse à bien prier Dieu, le catéchisme, à lire et à écrire » (Pompée, Rapport historique sur les écoles primaires de la ville de Paris, depuis leur origine jusqu'à la loi du 8 juin 1833). En vain M. Le Masle, le chantre d'alors, « craignant que la multitude des écoles séparées, faites sous prétexte de charité, ne vînt à ruiner les écoles de quartier », résolut de ne plus accorder d'autorisation pour les ouvrir ; en vain il offrit aux curés de continuer à faire enseigner les pauvres par ses maîtres et maîtresses, sur la présentation d'un billet délivré par eux, ainsi que cela s'était toujours pratiqué jusqu'alors. Les curés répondirent que « les pères et les mères aisés ne souffriraient pas que l'on mêlât les pauvres gueux, garçons et filles, avec leurs enfants, lesquels auraient à mépris et leur saleté et leurs haillons ». Favorisés au fond par l'archevêque et par le Parlement, les curés, les compagnies de charité qu'ils avaient formées, les communautés religieuses auxquelles ils s'adressaient, revendiquèrent l'indépendance de leurs écoles, et, comme il est arrivé si souvent de nos jours, y admirent d'autres élèves que des enfants réellement pauvres. Ainsi, le chantre, dans une de ses visites, put signaler une école sur la paroisse de Saint-Jean-en-Grève « où plusieurs maîtresses enseignaient, en diverses classes, quatre ou cinq cents filles ou demoiselles bourgeoises et autres, de toutes conditions et de toutes paroisses, bien mises et bien vêtues, qui paient et qui font des cadeaux ». Le chantre Claude Joly, un des successeurs de Le Masle, fit toutes les concessions possibles. Il alla jusqu'à offrir de délivrer gratuitement les permissions à quiconque se proposerait de n'élever que des enfants pauvres. Tout fut inutile : les religieuses de Saint-Avoie, de l'Annonciation, les filles de Saint-Lazare, de la communauté de Sainte-Geneviève, de Sainte-Marthe, de. Sainte-Croix, les Ursulines, purent, grâce à des arrêts du Parlement, soustraire leurs écoles à l'autorité du chantre. Celui-ci ne conserva, en fin de compte, que le droit de visiter les écoles de charité et le privilège d'accorder des lettres de maîtrise qu'il ne pouvait plus refuser (1684). Les maîtres et maîtresses des petites écoles, bien qu'ils eussent payé fort cher leur maîtrise et supporté les frais des nombreux procès entrepris dans leur intérêt, virent pour la plupart leurs écoles diminuer ou se fermer devant la concurrence redoutable des écoles de charité, venant s'ajouter à celle que leur faisaient déjà, depuis le règne de Charles IX, les maîtres-écrivains jurés (Voir Maîtres-écrivains). De nouvelles écoles charitables, contre lesquelles les maîtres des petites écoles et les écrivains jurés se liguèrent en vain, se fondèrent à la fin du dix-septième siècle, sous l'impulsion de J.-B. de La Salle. De la paroisse de Saint-Sulpice les écoles des Frères s'étendirent bientôt à d'autres quartiers. Malgré les arrêts du grand chantre, du lieutenant civil du Châtelet et même du Parlement, les nouveaux venus ne se découragèrent pas ; on n'aboutit qu'à les obliger de renvoyer les fils de « chirurgien, de serrurier, traiteur, orfèvre, épicier, marchand de vin, » considérés comme étant en état de payer une rétribution scolaire. En 1698, ils comptaient plus de 1000 élèves et 14 classes. En 1704, ils étaient accusés de tenir plus de vingt établissements, auxquels s'ajoutèrent bientôt les écoles fondées par les Frères des écoles chrétiennes du faubourg Saint-Antoine, autre association moins prospère, mais qui prétendait avoir hérité des traditions de Messieurs de Port-Royal. Pourtant les petites écoles demeurèrent debout : en 1736, on en comptait encore 191 pour les garçons et 170 pour les filles, avec un personnel d'environ 600 maîtres et maîtresses, chaque école comprenant un ou deux auxiliaires, La Révolution. — Cet état de choses paraît s'être maintenu jusqu'à la Révolution. Que devinrent les diverses écoles de Paris pendant cette période troublée ? La plupart des écoles de charité disparurent avec les fondations qui servaient à leur entretien. Les religieux et religieuses furent dispersés. Selon toutes probabilités, il ne resta que les anciennes petites écoles, qui vécurent de leurs propres ressources, soumises tout au plus aux fluctuations de la législation du moment. Cependant la municipalité dut se mettre en devoir de satisfaire aux décrets qui se succédèrent pour l'organisation de l'enseignement public à son premier degré. Sous l'énergique impulsion de la Convention, les écoles se multiplièrent. D'ailleurs la Commune parisienne ne se montrait pas moins zélée pour l'instruction populaire que ne l'étaient les législateurs. Le 15 septembre 1793, une députation vint, « au nom du département de Paris et des districts ruraux, de la Commune, des sections et des sociétés populaires », présenter à la Convention une pétition tendant à établir trois degrés d'instruction au delà des écoles primaires : « le premier pour les connaissances indispensables aux artistes et aux ouvriers de tous les genres ; le second, pour les connaissances ultérieures nécessaires à ceux qui se destinent aux autres professions ; le troisième, pour les objets d'instruction dont l'étude difficile n'est pas à la portée de tous les hommes ». Le 27 septembre 1793, Chaumette faisait abolir les peines corporelles dans les écoles de Paris. En conformité d'un décret du 4 ventôse an II, les instituteurs et institutrices dont le traitement ne s'élevait pas à 600 livres reçurent une augmentation de traitement pour toute l'année 1793, et le premier quartier de 1794, jusqu'à due concurrence. A partir du 15 germinal an II, c'est-à-dire du second quartier de 1794, les instituteurs et institutrices furent payés, conformément au décret du 29 frimaire an II, d'après le nombre de leurs élèves, à raison de vingt livres par élève et par an pour les instituteurs, et de quinze livres par élève et par an pour les institutrices. Un arrêté du corps municipal du 9 pluviôse an II avait invité les sections à prendre des mesures pour la surveillance des écoles de leur arrondissement ; un autre arrêté, du 6 germinal, ordonna aux sections de remettre un relevé des registres ouverts par chacune d'elles pour l'inscription tant des instituteurs et institutrices que des enfants qui devaient être envoyés aux écoles. Le 9 floréal, le Conseil général de la commune élut dix-huit commissaires pour surveiller les écoles primaires ; mais à la fin de messidor cette surveillance fut transférée aux comités civils. Après le 9 thermidor, un décret du 14 fructidor an II chargea la Commission exécutive de l'instruction publique de l'administration directe des écoles parisiennes. En conséquence, ceux des instituteurs ou institutrices qui n'avaient pas encore touché leur traitement du trimestre germinal-prairial (et un certain nombre étaient dans ce cas) furent payés, non par le département, mais par la Commission exécutive ; et grâce à cette circonstance on trouve aux Archives nationales les listes nominatives d'élèves qui furent fournies à la Commission à cette occasion : ces états nous font connaître les noms et les adresses de 175 instituteurs et institutrices de Paris, le chiffre des sommes touchées par eux pour les trimestres de germinal et de messidor an II, et, ce qui est encore plus intéressant et plus probant, les noms de leurs élèves. Le décret du 27 brumaire an III, qui remplaça celui du 29 frimaire an II et alloua aux instituteurs et aux institutrices des traitements de 1200 et de 1000 livres, n'entra en vigueur, en ce qui concerne les traitements, qu'à partir de germinal an III ; il cessa d'avoir force de loi à la fin de vendémiaire an IV, date à laquelle les dispositions d'un autre décret, celui du 3 brumaire an IV, furent appliquées : la rétribution scolaire fut rétablie, et les instituteurs et institutrices ne reçurent plus aucun traitement, la République se bornant à leur concéder la jouissance d'un logement. Lorsque furent établies les écoles centrales, un décret du 12 ventôse an III avait fixé à cinq le nombre de ces écoles pour le département de Paris. Toutefois il n'en fut établi que trois : Voir Centrales (Ecoles). Quant à l'instruction élémentaire, son histoire pendant la période du Directoire n'est pas encore écrite, et nous ne possédons que quelques documents épars, mais qui fournissent au moins la preuve de l'existence des écoles. Voici par exemple un procès-verbal de distribution de prix datant du sixième jour complémentaire de l'an VII: « L'administration centrale du département de la Seine, en exécution de ses dispositions précédentes, s'est transportée, avec le commissaire du Directoire exécutif et le secrétaire en chef, à l'édifice dit de l'Oratoire, rue Honoré, pour y procéder à la distribution des prix aux élèves des écoles de Paris. Le local était disposé d une manière convenable et des productions des arts ornaient son enceinte. Les membres du jury d'instruction publique, les instituteurs et institutrices, ainsi que les députations convoquées des différentes autorités constituées du département, et un public nombreux, ont pris place. » On trouve parmi les élèves couronnés des enfants de cinq à quatorze ans. Le Consulat et l'Empire. — Un autre procès-verbal de distribution de prix, du 21 germinal an IX, aux élèves des écoles primaires et particulières du Ier arrondissement, fait connaître que des maîtres particuliers « voulaient bien se charger d'une partie de l'instruction gratuite » ; mais que les écoles primaires étaient peu prospères et que les élèves qui les fréquentaient n assistaient point à la solennité ou n'y étaient présents qu'en petit nombre : « Pourquoi, s'écrie l'auteur indigné, les écoles primaires, ces écoles si intéressantes, n'ont-elles pu partager les mêmes avantages? Par quelle fatalité, tandis que les lois de la France régénérée appelaient de toutes parts les peuples à la lumière et multipliaient les moyens d'instruction, ces ateliers des premiers travaux de l'esprit humain n'offraient-ils encore, il y a peu de temps, que l'effroyable spectacle de la solitude et de l'abandon? Osons en faire ici l'aveu c'est qu'en butte à la malveillance et à la calomnie, ces écoles paralysées trouvaient encore des hommes qui auraient rougi d'apprécier les bienfaits des institutions républicaines ; c'est que, trop peu multipliées et trop distantes des différents points du territoire, ces écoles laissaient à l'insouciance des parents des prétextes d'en éloigner leurs enfants. Citoyens, vous n'apprendrez pas sans doute avec indifférence que, jaloux de propager l'enseignement public, vos magistrats n'ont pas tenté en vain d'arracher vos écoles à cette espèce de nullité dans laquelle les ennemis des lois et du gouvernement s'étaient efforcés de les plonger ; que, pour ne plus laisser d'excuses à la négligence des parents, ils ont trouvé dans le zèle des instituteurs des deux sexes répandus sur cet arrondissement les facilités et les moyens pour assurer aux enfants des familles indigentes une éducation gratuite, dont sans doute ils sauront se rendre dignes par leur assiduité et leur travail. » Quoi qu'il en soit, le Consulat trouvait la ville de Paris avec 24 écoles primaires publiques seulement (rapport du préfet de la Seine de septembre et octobre 1800). Dès que Chaptal et plus tard Portalis eurent, dans leurs rapports (an IX et an XII), exprimé des sentiments de bienveillance et de regret à l'égard des écoles dirigées jadis par les associations religieuses, ces dernières reparurent à Paris. L'Empire les encouragea : les associations religieuses hospitalières et enseignantes furent placées sous la protection spéciale de « Madame Mère » ; les Frères des écoles chrétiennes furent agrégés à l'Université par le décret du 17 mars 1808. Vers la fin de l'Empire, les écoles primaires de Paris (les écoles de charité non comprises) étaient au nombre de 400 et comptaient 14 000 élèves, soit environ 35 élèves par école. F. Cuvier (Projet d'organisation pour les écoles primaires, 1815) trouve ce nombre beaucoup trop considérable pour que les maîtres qui les dirigeaient puissent vivre honorablement. Les écoles étaient d'ailleurs dès lors de deux espèces : celles du jour, réunissant les enfants de quatre à quinze ans, et celles du soir pour les élèves de plus de quinze ans. Elles se divisaient en outre, relativement à la position sociale des familles, en trois catégories bien distinctes : les écoles de charité, destinées aux véritables pauvres ; . celles que fréquentaient les enfants de la classe immédiatement au-dessus du pauvre ; enfin celles qui étaient fréquentées par les enfants de la classe aisée. Dans les deux premières catégories d'écoles, l'instruction était à peu près la même elle consistait dans la lecture, l'écriture et l'arithmétique et dans quelques leçons d'orthographe. Dans la troisième, on ajoutait à ces matières des leçons de grammaire et des notions de géographie et d'histoire ; en arithmétique, on allait ordinairement jusqu'aux règles de trois inclusivement. Ce partage des écoles était alors dans les esprits, car, dit F. Cuvier, « il y aurait peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients à réunir dans la même école des enfants aussi différents que le sont par leurs goûts et leur langage ceux du petit marchand et de l'artisan aisé, et ceux du journalier et de l'artisan pauvre ». Cuvier propose de réduire de moitié les écoles existantes. Laissant de côté les écoles de charité, il veut répartir les 14 000 enfants qui vont aux écoles primaires dans 200 écoles environ : 100 de premier ordre seraient chargées des enfants aisés, et 100 du deuxième ordre des enfants pauvres ; dans chaque ordre, 50 classes recevraient les enfants de quatre à huit ans, et 50 ceux de huit à quinze ; il y aurait de plus des cours du soir pour les garçons ouvriers qui ont encore besoin de l'instituteur. Il ne croit pas que les grandes agglomérations (écoles mutuelles) puissent réussir à Paris à cause des distances et de l'embarras des rues. « Jamais en outre, ajoute-t-il, on ne se persuadera parmi nous, à moins d'une longue expérience, que 500 écoliers réunis dans une même école et dirigés par des enfants puissent être aussi bien soignés et aussi bien instruits que 20 ou 30 conduits par un homme fait. » La Restauration. — Ces objections n'arrêtèrent point les hommes qui cherchaient une solution plus large et plus libérale du problème de l'instruction populaire dans les grandes villes. Pour parer à l'abandon où l'Empire avait laissé les écoles et à l'insuffisance aussi bien des écoles de charité que des écoles payantes, MM. De Gérando, de Lasteyrie, J.-B. Say, de Laborde, Jomard, l'abbé Gaultier, etc., se constituèrent en Société pour l'instruction élémentaire et introduisirent en France, à Paris d'abord, le mode mutuel, « cette méthode qui abrège le temps, diminue la dépense, égaie l'étude, éloigne les difficultés, dont on ne peut plus contester la bonté, dont on ne saurait plus nier les progrès » (Rapport de M. de Laborde à la Société pour l'instruction élémentaire, 10 janvier 1816). « Au bruit du canon et des combats », un premier établissement avait été fondé dans une maison obscure de la rue Jean-de-Beauvais. Il n'avait reçu d'abord que douze élèves, sous la direction de M. Martin, l'un des maîtres que la faculté de théologie protestante de Montauban avait envoyés en Angleterre étudier la méthode. Quand le nombre des élèves s'augmenta, on transporta l'école dans l'église du collège de Lisieux. Là, elle compta bientôt 200 enfants ; la ville prit l'école à sa charge, et elle devint l'établissement type. Puis s'ouvrirent : l'école Popincourt, dans une fort belle salle du couvent de Saint-Ambroise, préparée pour 500 élèves ; l'école de la duchesse de Duras, dans une pièce de son propre hôtel ; l'école de la rue des Billettes, fondée par le consistoire de la confession d'Augsbourg (classe de garçons et classe de filles) ; l'école de Sainte-Elisabeth, au faubourg du Temple, qui fut la première grande école de filles établie à Paris sur le nouveau plan. Les frais d'une école mutuelle à Paris étaient alors ainsi évalués :
La grande difficulté était de trouver des emplacements : Jomard fut chargé de ce soin par le préfet, M. de Chabrol. Le fruit de ses démarches fut l’organisation complète de quatre écoles et la préparation de douze autres « où les enfants ne fussent plus entassés les uns sur les autres autour du mur pendant que le milieu seul restait libre ». On cherchait à établir, dans l'enceinte des Petits-Pères ou à la Halle-aux-Draps, une école centrale de 500 garçons et de 400 filles, pour présenter « le modèle le plus parfait d'une éducation morale et religieuse». On estimait à 50 000 le nombre des enfants qui n'étaient point en état de se procurer l'éducation ; 10 000 étaient élevés dans 120 écoles gratuites aux frais des hospices de la Ville de Paris, et coûtaient annuellement 180 000 francs, soit de 12 à 36 francs par élève. Ces 180 000 francs, pensait-on, devaient suffire, avec la nouvelle méthode, pour la totalité de la population. Pendant que l'enseignement mutuel s'organisait et s'étendait avec l'autorisation du gouvernement et malgré les obstacles que lui suscitait d'ores et déjà la « Congrégation », un arrêté (7 octobre 1816) prescrivait aux instituteurs de Paris déjà en exercice de se présenter dans le plus bref délai devant l'inspecteur d'académie chargé de leur arrondissement « pour être examinés par lui et recevoir ensuite le brevet de capacité proportionné aux moyens d'instruction dont ils auraient fait preuve ». En 1817, la population totale de Paris était de 713 916 habitants ; on trouvait 35 699 enfants de deux à six ans, et 71 395 de six à quatorze ans. ensemble 107 005 enfants. Il existait 132 écoles fréquentées par 15 000 élèves, c'est-à-dire par une moyenne de 14 %. En 1818, un arrêté préfectoral porta « qu'il ne serait accordé d'autorisation pour l'enseignement, dans la Ville de Paris, qu'aux instituteurs qui auraient obtenu un brevet de deuxième degré ». En 1819 (9 octobre), le préfet de la Seine, en prenant un arrêté qui astreignait les institutrices au brevet, à l'autorisation et à la surveillance d'un comité de dames nommé par lui, définit les écoles primaires « celles où l'on enseigne seulement la lecture, l'écriture et les éléments de calcul ». Il établit ainsi la situation des écoles de filles à Paris : « Les seules écoles reconnues sont les suivantes : 1° les 12 écoles communales établies dans chacun des arrondissements municipaux de Paris et dont les dépenses sont payées sur le budget de la Ville ; 2° les écoles d'enseignement mutuel entretenues par la Ville sur un fonds spécial ou par la Société de l'instruction élémentaire ou par des fondateurs particuliers ; 3° les écoles de charité entretenues par les bureaux de bienfaisance ; 4° les autres écoles tenues par des institutrices qui appartiennent à des congrégations religieuses ». Il y a une dame surveillante par arrondissement. Pour avoir le droit d'exercer, il faut, outre le brevet de capacité, une autorisation spéciale, et cette autorisation est délivrée sur la proposition du maire et de la dame surveillante, ou du fondateur de l'école ; en cas de faute grave, le brevet peut être retiré. On voit, par ces données, quelle fut la situation de l'instruction primaire à Paris sous la Restauration. On peut dire que le fait le plus saillant de cette période fut la création des écoles mutuelles, c'est-à-dire, en fin de compte, celle de l'instruction primaire laïque dont ces écoles devinrent le type et comme le drapeau. Aussi les congréganistes virent-ils en elles des rivales plutôt que des alliées, et cherchèrent-ils tout d'abord à les éclipser, à les déprécier et à les mettre en suspicion. La monarchie de Juillet. — Sous le gouvernement de Juillet, les situations que nous venons d'esquisser ne firent guère que se développer pour se mettre de plus en plus au niveau des besoins. Les salles d'asile, dont on connaît l'origine, — Voir Maternelles (Ecoles), — commencèrent à se multiplier. En 1834, il n'y en avait, à Paris, que 15, recevant 2800 enfants. Il venait d'en être créé 5 nouvelles pour 650 enfants, et 4 autres se préparaient. Au budget de 1837, la gestion économique de ces établissements passait du comité des dames, qui les avait administrés jusqu'alors, à l'administration municipale. Il en était de même pour les 68 écoles simultanées et les 29 ouvroirs précédemment défrayés par les bureaux de bienfaisance et les hospices, ainsi que pour les 7 cours d'adultes dirigés par les frères ; le Comité central établi par l'ordonnance royale du 5 novembre 1833 pour exercer, à Paris, les attributions du comité d'arrondissement, achevait ainsi d'étendre son action sur tout le service de l'instruction primaire. Par la création de nouvelles écoles, on venait de gagner 2530 places, dont 1560 pour les garçons et 970 pour les filles. Mais, vu les difficultés qu'on éprouvait à trouver « des localités dans des quartiers très resserrés», le comité portait surtout son attention sur l'amélioration de ce qui existait. Les deux écoles spéciales israélites et les deux écoles de la confession d'Augsbourg passaient au nombre des écoles communales et étaient entretenues comme telles. L'enseignement du chant était donné dans toutes les écoles ; des réunions périodiques des meilleurs élèves prenaient le nom d'orphéon, et les enfants y étaient appelés pour s'exercer à l'exécution musicale. Les classes particulières aux moniteurs et monitrices pour perfectionner leur enseignement étaient en activité. On prenait des dispositions « pour placer dans les écoles de nouveaux appareils, tels que des collections de solides de géométrie en grande dimension, de mesures de capacité pour les solides et les liquides, des niveaux d'eau, des équerres de maçon, etc. », On créait trois places de suppléants et trois de suppléantes auprès des écoles mutuelles. Des dispositions étaient prises pour établir les « localités » des deux premiers ouvroirs auprès des deux écoles de jeunes filles de la rue des Grès et de la rue du Pont-de-Lodi, et le comité central s'occupait de l'organisation à y introduire. Pour satisfaire à la loi de 1833, on dressait les plans d'une école supérieure de 300 élèves : l'enseignement, dans cette école, devait comprendre « toutes les connaissances nécessaires pour entrer avec avantage soit dans la carrière commerciale, soit dans la carrière industrielle ». Douze bourses venaient d'être créées à l'école normale de Versailles (1er octobre 1836) : la fondation avait été mise en activité par la voie du concours entre les moniteurs de toutes les écoles communales ; six autres places allaient être mises au concours pour le 1er octobre 1837. Deux établissements que la Ville avait fondés en 1815 sous le titre d'écoles normales pour l'enseignement du mécanisme de la méthode mutuelle, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, étaient conservés, mais comme simples cours. L'association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique se livrait à l'instruction des classes ouvrières ; l'administration, qui n'avait pu jusqu'alors que mettre des locaux à sa disposition, lui accordait une subvention pour achat d'instruments, de modèles et autres objets nécessaires à l'enseignement. La Ville payait à l'Ecole royale de dessin de la rue de l'Ecole-de-Médecine une subvention qui lui donnait le droit de faire délivrer gratuitement les fournitures à 100 élèves. Elle allouait des subventions à trois autres écoles de dessin. On se préparait à organiser l'enseignement secondaire des femmes. Le budget de l'instruction primaire de la ville de Paris s'élevait alors (1837) à 587 734 francs. En voici le détail, que nous reproduisons parce qu'il fait bien ressortir la situation du moment :
Le Manuel général, alors journal officiel de l'instruction primaire, nous donne le détail des établissements auxquels s'appliquaient ces dépenses (t. XIII, statistique de 1838) :
Cette statistique fournit, sinon le nombre réel des élèves, du moins le nombre des enfants que le Comité central, dans sa séance du 11 août 1838, jugeait, conformément à une circulaire du 5 décembre 1835, pouvoir être admis suivant les lois de la salubrité dans les diverses écoles. L'auteur de cette statistique s'exprimait ainsi : « Le budget de 1837 est de 587 734 francs. Celui de 1838 dépassera 700 000 francs. Avec de pareilles ressources que l'administration municipale consacre chaque année à l'instruction primaire, les besoins sont assurés avec magnificence ; car il faut reconnaître qu'aucune capitale en Europe ne peut montrer aux étrangers d'aussi nombreuses ni d'aussi belles écoles communales, des salles d'asile aussi bien pourvues de tout le matériel nécessaire, enfin des écoles privées qui rivalisent d'importance avec les écoles communales. » Pourtant, il reconnaît qu'il y a des ombres à ce tableau : « Certaines écoles privées font un contraste sensible. Le département de la Seine n'a point d'école normale. Les 12 boursiers qu'on envoie à Versailles se recrutent difficilement et sont mal accueillis ensuite parce qu'ils ne sont point pourvus de l'espèce de diplôme que des personnes capables, mais sans autorité légale, délivrent à ceux qui, en petit nombre, suivent leur cours établi près de la place Saint-Sulpice. On objecte contre la création d'une école normale la difficulté de trouver un local convenable, de surveiller les élèves-maîtres pendant les heures et les jours de sorties, la dépense que pourrait entraîner l'habitation dans une aussi grande ville, enfin le prix élevé qu'il faudrait fixer à la pension pour couvrir les frais. Il existe des tiraillements entre les comités municipaux, qui ne se trouvent pas assez écoutés, et le Comité central qui, tout en subissant de fâcheuses influences, dispose trop des nominations et des récompenses. Les deux inspecteurs universitaires (MM. Lamotte et Ritt), placés sous la direction de M. Cousin, membre du Conseil royal, ne suffisent point à la lâche, » etc. Dans les années qui précédèrent la loi de 1850, cette situation continua sans doute à s'améliorer, mais en restant sensiblement la même quant aux institutions, ainsi qu'il appert d'un tableau comparatif dressé pour les années 1830, 1838 et 1844 par H. Say dans ses études sur l'administration de la ville de Paris. L'enseignement du dessin s'étendait et s'affermissait (six cours pour les hommes, 1250 élèves ; un cours pour les femmes, .250 élèves ; une subvention de 20 000 francs en faveur de ces cours). L'enseignement de la couture se généralisait dans les écoles de filles : sur la proposition de Mlle Sauvan (rapport au Comité central, séance du 15 avril 1845), des ouvroirs étaient établis auprès de plusieurs écoles dirigées par des soeurs de charité, les uns pour les internes (orphelinats), les autres pour les externes (une cinquantaine d'élèves passaient dans chacun de ces ouvroirs deux heures dans l'intervalle des classes). Pour les premiers, la ville allouait à la directrice un traitement de 600 francs ou simplement une indemnité de logement. Des comités de dames fournissaient de petits vêtements aux enfants des salles d'asile, mais non aux élèves des écoles. « Les écoles, pensait-on alors, ne doivent pas être des écoles de charité, et, en offrant l'instruction, on n'entendait pas soustraire les parents à la loi commune qui veut que chacun pourvoie à ses besoins et à ceux de sa famille » (H. Say, ouvrage déjà cité). Du reste, la gratuité n'était point dans les idées du temps. On reprochait aux règlements des frères d'être un obstacle à rétablissement d'une rétribution dans les écoles communales. Les frères recevaient un traitement individuel de 750 francs, avec le logement dans la communauté particulière dont ils dépendaient. Le traitement des instituteurs laïques s'élevait à 1800 francs, avec des augmentations quinquennales de 200 francs jusqu'à concurrence de 2400 francs. Le recrutement de ces derniers se faisait un peu au hasard, le département n'entretenant que quelques bourses à l'école normale de Versailles. Celui des institutrices était, comme aujourd'hui, plus facile : un cours normal était établi depuis longtemps aux frais de la ville, et les autorités municipales « n'avaient que l'embarras du choix parmi un grand nombre de jeunes personnes distinguées par leur instruction comme par leurs moeurs, et toutes appartenant à des familles honorables ». — « Les soeurs de charité se montraient en général bonnes et dévouées ; mais elles manquaient d'instruction suffisante », et leurs écoles, ainsi que celles des frères, étaient signalées comme présentant l'inconvénient « de renvoyer les élèves entre les deux classes, alors que les parents, livrés à leurs occupations, ne pouvaient surveiller leurs enfants ». La supériorité numérique des écoles congréganistes s'expliquait par cette circonstance « qu'en général elles étaient en rapports avec les maisons de secours ; que les frères s'arrogeaient le monopole de l'enseigne d'Ecoles chrétiennes, obtenaient plus de succès dans les arts graphiques, etc. » Les écoles mutuelles, bien qu'elles se fussent perfectionnées grâce aux cours normaux faits par M. Sarazin, d'une part, et de l'autre par Mlle Sauvan, étaient moins populaires et moins recherchées. Ce qui en retardait la création était toujours la grande dimension nécessaire pour l'unique salle de classe dont elles se composaient, et la nécessité d'y joindre une autre salle non moins grande ou préau couvert pour les récréations. Chaque fois que la Ville pouvait disposer d'un terrain suffisant, elle en profitait pour réunir, dans une même construction, une école mutuelle de garçons, une école mutuelle de filles, et une salle d'asile. C'est ainsi que se formèrent les groupes scolaires du faubourg du Roule, des rues du Renard-Saint-Merry, des Bernardins, de Charonne, ce dernier construit d'après les indications du Comité central lui-même. Pendant que l'instruction élémentaire se développait ainsi, l'enseignement primaire supérieur était donné au collège Chaptal (ancienne école François Ier), et à l'école Turgot, ouverte depuis 1839. Le collège Chaptal donnait une sorte d'enseignement mixte, participant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire ; mais l'école Turgot conservait l'enseignement primaire supérieur dans toute son intégrité. Elle avait été, comme nous l'avons dit plus haut, construite pour 300 élèves. La Ville s'y réservait 60 places qu'elle donnait au concours. Les études n'y furent que de trois ans, jusqu'à ce que l'on eut ajouté un cours préparatoire et un cours complémentaire d'une année chacun. Comme autre moyen d'enseignement primaire, la Ville de Paris comptait un grand nombre d'écoles libres, généralement peu prospères, médiocrement dirigées, sans méthodes fixes, hésitant entre les modes individuel, simultané et mutuel, ayant, comme autrefois les écoles des maîtres-écrivains dont elles étaient la continuation, à lutter contre les écoles gratuites, changeant souvent de mains et donnant lieu à des spéculations regrettables. Toutefois, elles réunissaient un effectif considérable d'élèves et rendaient ainsi de grands services, puisque, en fin de compte, les écoles communales ne recevaient que 28 000 enfants dans une ville où la population atteignait un million d'âmes. Pour l'enseignement plus développé des filles, la ville possédait une école supérieure recevant 45 pensionnaires et établie au passage Saint-Pierre. Cette école avait été fondée, avant la Révolution, par un curé de Saint-Louis-Saint-Paul, pour former des « femmes de ménage ». La Ville y entretenait 20 bourses. La plupart des élèves avaient fini par s'y préparer au brevet et par se destiner à l'enseignement. En dehors de cet établissement, le haut enseignement était donné aux filles dans les pensions et dans les institutions. L'enseignement des pensions comprenait : l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, la grammaire française, l'arithmétique jusques et y compris les proportions et les règles qui en dépendent, l'histoire de France, la géographie moderne, les notions élémentaires de physique et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le dessin, la musique, les travaux d'aiguille, les langues vivantes. Celui des institutions comprenait en outre : les éléments et l'histoire de la littérature française, avec des exercices de grammaire et de style, la géographie, l'histoire ancienne et moderne, les éléments de la cosmographie. Des diplômes spéciaux correspondaient à ces programmes (arrêté du 16 mars 1837). De 1848 à 1865. — La loi du 15 mars 1850 effaça ces distinctions dans les degrés de l'instruction primaire. A Paris comme ailleurs, toute hiérarchie disparut dans les écoles, sinon en fait, du moins en droit, On put ouvrir une école, externat, pension ou institution, sous la garantie uniforme du brevet de capacité (remplacé par la lettre d'obédience pour les institutrices appartenant à une congrégation religieuse). Le décret du 31 décembre 1853 distingua inutilement les écoles de filles en écoles de second ordre et de premier ordre ; il fut sans effet dans la pratique. C'était une conséquence nécessaire de la lettre d'obédience, devenue suffisante pour ouvrir des établissements de tous les degrés, depuis la modeste école primaire jusqu'aux grandes maisons d'éducation du Sacré-Coeur, des Oiseaux, de Sainte-Clotilde, etc. Pour les garçons, deux grandes écoles, Chaptal et Turgot, se soutinrent par leurs propres forces, en concurrence avec l'école similaire que les frères avaient établie rue des Francs-Bourgeois et qu'ils transportèrent plus tard près de l'église Saint-Paul. Voici le dénombrement des établissements existants en 1851-1852 : Les écoles supérieures dont il vient d'être question ; Les deux cours d'enseignement mutuel, [devenus les seuls moyens réguliers de recrutement du personnel enseignant, le département ayant cessé d'envoyer des élèves-maîtres à Versailles : cours pour les instituteurs à la Halle-aux-Draps, sous la direction de M. Sarazin ; cours pour les institutrices, rue de la Petite-Friperie, sous la direction de Mlle Sauvan ; le programme comprenait la méthode de lecture, d'écriture et de calcul, de grammaire, de dessin linéaire et de géométrie pratique élémentaire ; dans l'école des élèves-maitresses, la couture était substituée au dessin ; Un cours de chant à la Halle-aux-Draps, pour fournir des répétiteurs de musique populaire ; Un cours normal pour la tenue des salles d'asile, rue Saint-Antoine, près de la rue Neuve-Saint-Paul ; Des écoles communales pour le sexe masculin ; laïques : 31 écoles d'arrondissement, 18 cours d'adultes, 7 écoles spéciales de dessin ; congréganistes : 25 écoles, 6 cours d'adultes ; Des écoles communales pour le sexe féminin ; laïques : 35 écoles d'arrondissement, 19 cours d'adultes ; congréganistes : 26 écoles ; Des salles d'asile, au nombre de 38 ; Des ouvroirs. Le budget municipal de l'instruction primaire s'élevait à 1 212 520 francs. Le service général comprenait à cette époque plus de 200 établissements, qui recevaient environ 45 000 élèves. On estimait que le nombre des enfants et des adultes susceptibles de recevoir à Paris l'instruction primaire s'élevait à 84312. (Vallet de Viriville, Histoire de l'instruction publique en Europe.) Le fait saillant des années qui suivirent fut le retour lent, mais bien marqué, au mode simultané. Le mode mutuel avait eu surtout sa raison d'être dans la pénurie où l'on était de maîtres et de maîtresses et de ressources pour les rétribuer, comme aussi dans la difficulté que l'on éprouvait (faute de ressources encore) à trouver des locaux, des classes suffisamment vastes, des mobiliers et tout l'outillage scolaire utile, sinon absolument nécessaire. Peu à peu les ressources augmentèrent. En même temps les inconvénients du mode mutuel apparurent à tous les yeux, et les esprits se reportèrent vers le mode simultané. D'ailleurs, le mode mutuel, tel que l'avaient compris ses premiers partisans, tel qu'avaient cherché à le maintenir M. Sarazin et Mlle Sauvan, reçut des atteintes profondes en 1853. Il fut décidé alors que tout établissement où le minimum des présences moyennes arriverait à 150 serait partagé en deux classes pourvues chacune d'un maître spécial et destinées à recevoir, la première, sous le nom de classe supérieure, 60 à 80 élèves ; la deuxième, sous le nom de classe élémentaire, tout le reste de l'école. Ce reste n'était rien de moins, dans certains établissements, qu'un effectif de 200 et 300 enfants. Ainsi, le mode mutuel et le mode simultané, se faisant mutuellement des emprunts, engendrèrent le mode mixte. En 1847, une école alla plus loin (la grande école de la rue Morand, sous la direction de M. Régimbeau) : elle fut organisée à l'instar des écoles simultanées, et réunit 900 élèves partagés en un certain nombre de classes où les élèves étaient de forces sensiblement égales. Un certain nombre d'écoles furent mises sur le même pied (rue Saint-Hippolyte, 13e arrondissement ; rue d'Aligre, 12° ; rue Cujas, 5e, etc.). Administration de Gréard (1865-1878). — Les choses en étaient là lorsque Gréard, nommé par Victor Duruy inspecteur de l'académie de Paris, fut chargé en 1865 du service de l'enseignement primaire dans le département de la Seine. A partir de 1870, il eut le titre de directeur de l'enseignement primaire de la Seine, et y joignit en 1872 celui d'inspecteur général. Cet éminent administrateur conçut dès l'abord un plan de réformes dont voici les points principaux : Achever de substituer le mode simultané à ce qui restait du mode mutuel dans les écoles laïques ; par suite, multiplier les classes et les maîtres ; Donner aux écoles ainsi transformées une organisation uniforme ; Diminuer peu à peu les effectifs exagérés, de manière à rendre possible une intervention suffisante du maître auprès de chaque élève ; Améliorer et agrandir les anciens locaux et en créer de nouveaux au moyen de constructions ou de locations, rapprocher ainsi les écoles des enfants et des familles, y créer un nombre de places moins disproportionné avec les besoins constatés ; Rendre le recrutement du personnel moins incertain en dotant le département de la Seine d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices ; Pourvoir plus libéralement à l'existence de ce personnel en élevant les traitements ; Transformer les salles d'asile ; Réorganiser les cours d'adultes ; Mettre l'enseignement, à tous ses degrés, au niveau des exigences de l'époque et des besoins d'une grande capitale ; Ménager d'utiles transitions entre l'école et l'atelier et prolonger, le plus possible, dans l'intérêt de l'instruction et de la moralité, la durée de la vie scolaire ; Enfin donner une sanction aux études et récompenser tous les efforts. C'était là une oeuvre laborieuse, une tâche qu'un esprit hardi et sûr de lui-même pouvait seul entreprendre, eu égard aux circonstances au milieu desquelles elle devait, sinon s'achever, du moins se commencer et se développer, aux ressources qu'il fallait trouver, aux esprits qu'il fallait persuader, aux volontés qu'il fallait en quelque sorte forcer. Elle fut courageusement abordée cependant. Les diverses parties en furent souvent menées de front ; dans tous les cas, chaque année fut marquée par une étape ou par un progrès que l'auteur put constater et faire toucher du doigt dans ses remarquables rapports au préfet de la Seine, rapports où les considérations les plus élevées, unies à de sûrs principes de pédagogie théorique et pratique, ne cessent de se trouver mêlés aux statistiques laborieusement et consciencieusement établies. Après douze années (1877), l'oeuvre était debout, complète, ne demandant qu'à être continuée, qu'à être perfectionnée, parce que toute chose en ce inonde est susceptible de perfectionnement. Le mode mutuel se mourait lentement. Jusqu'à l'entrée en fonctions de Gréard, il n'avait à peu près complètement disparu que dans 34 établissements. La nouvelle « organisation pédagogique » des écoles, inaugurée en 1868, lui porta le dernier coup (Voir Organisation pédagogique des écoles primaires publiques et Gréard). Tout effectif d'école, si nombreux qu'il pût être, fut partagé en trois cours : cours élémentaire, cours moyen ou intermédiaire, et cours supérieur. Chacun de ces cours put être fractionné et être réparti en un certain nombre de classes, soit nuancées, soit parallèles ; chaque classe dut avoir son maître ou sa maîtresse propre et responsable, sous la responsabilité générale du directeur ou de la directrice. Dans ces conditions, il n'y avait plus place pour les moniteurs : les anciennes grandes salles de 150 pieds de long sur 30 de large furent coupées par des cloisons et diminuées par des corridors d'accès. Les effectifs de chaque classe furent ramenés à celui que comportent les forces d'un homme obligé de se tenir en communication incessante avec ses élèves. Ils restèrent cependant, durant quelque temps, de 100, de 90, de 80 élèves pour les classes élémentaires, de 70 à 75 pour les classes du cours moyen, de 50 à 60 pour les classes du cours supérieur. Mais peu à peu ils descendirent au chiffre normal de 60, de 50 et de 40. Sous le second Empire, l'administration préfectorale, dans ses projets pour l'embellissement de Paris, avait laissé les. constructions scolaires au dernier plan. D'impérieux besoins et le réveil de l'opinion devaient bientôt mettre fin à ce délaissement des intérêts de l'instruction primaire. Au début de la guerre de 1870, les habitants des communes suburbaines se réfugièrent pour la plupart à Paris. Ils y installèrent comme ils purent leurs écoles et leurs municipalités. Mais un grand nombre d'enfants appartenant soit à ces communes, soit à des départements voisins, soit même aux écoles libres des divers quartiers, refluèrent vers les écoles de la ville. On leur y fit place ; ils y trouvèrent, comme tous les autres élèves, le chauffage, la nourriture, en un mot tous les secours que purent leur assurer, pendant une période de quatre mois, les maires et les comités organisés à cet effet. Malgré ces embarras et ceux qui naissaient d'une situation profondément troublée, l'ordre et la suite des éludes ne furent point interrompus : l'administration centrale continua d'exercer sur les écoles au moins son autorité morale. L'autorité effective avait passé le plus souvent aux mairies. Celles-ci, pendant le règne éphémère de la Commune, se rendirent maîtresses absolues des écoles. Elles achevèrent les laïcisations commencées précédemment sur quelques points, notamment dans le 11e arrondissement. Quand la paix fut rétablie, l'autorité revint aux pouvoirs institués par la loi. Les choses furent remises sur l'ancien pied, et le service scolaire reprit sa marche régulière. Mais, pendant la crise, bien des enfants avaient appris le chemin de l'école communale ; ils ne devaient plus l'oublier. Aussi, dès 1871, l'insuffisance des anciens locaux apparut avec une évidence qui ne permettait plus aucune illusion ; un recensement scrupuleux la mit en pleine lumière. Le nombre des places, dans les écoles et dans les salles d'asile, fut calculé avec toute la précision possible en pareille matière, en même temps que la dépense nécessaire pour pourvoir aux besoins tels qu'ils se révélaient (préparation du budget de 1872, rapport de Gréard au préfet de la Seine). En même temps, les mobiliers se transformaient. Peu à peu disparurent les tables étroites et grêles et les bureaux gigantesques des écoles mutuelles, puis les longues et lourdes tables et les vastes chaires des anciennes écoles simultanées ; des tables de cinq, quatre, trois et deux places, avec des bureaux à la fois commodes et peu embarrassants, y furent substitués. Les classes se garnirent, en outre, de l'outillage nécessaire: tableaux noirs, cartes murales, globes, collections, bibliothèques et musées scolaires, etc. La fondation de nouvelles écoles et l'accroissement du nombre des classes impliquaient une augmentation considérable du personnel enseignant. De ce chef, comme nous l'avons déjà remarqué, les ressources étaient médiocres et fort aléatoires. L'administration précédente avait créé une excellente institution : aux termes d'un arrêté du 27 janvier 1866, pris en conformité de l'article 35 de la loi du 15 mars 1850, des enfants de quatorze à seize ans, ayant donné des marques de vocation pour l'enseignement et chez lesquels un concours avait permis de constater un certain degré d'instruction, étaient placé dans les meilleures écoles sous le titre d'élèves-maîtres et d'élèves-maîtresses stagiaires, avec des traitements variant de 400 à 600 francs. Parvenus au brevet, ils formaient le plus souvent des adjoints et des adjointes de valeur. Ils remplaçaient au moins avec avantage les maîtres et maîtresses formés par les cours normaux dont il a été parlé plus haut et qui avaient disparu depuis longtemps. Mais rien ne pouvait tenir lieu d'écoles normales régulières, et il était peu honorable pour le premier département et pour la première ville de France de manquer de semblables établissements. Ce que l'administration n'avait pu obtenir, ni sous le gouvernement de Juillet, ni sous le second Empire, elle l'obtint sous la République. Une école normale d'instituteurs fut ouverte dans le 16e arrondissement (Auteuil) le 1er octobre 1872. L'année suivante, au mois de janvier, l'ancienne école supérieure de jeunes filles du passage Saint-Pierre, transférée rue Poulletier, fut transformée en école normale d'institutrices. Les élèves-maîtres et les élèves-maîtresses du dehors furent néanmoins maintenus comme aides, à la condition de se préparer aux écoles normales, pour lesquelles ils constituèrent tout d'abord un excellent élément de recrutement. Mais un des plus sûrs moyens d'encourager un personnel scolaire et de le conserver, c'est de lui assurer une existence honorable, en rapport avec la dignité de la fonction et le dévouement qu'elle exige. Des arrêtés des 8 avril 1872 et 3 février 1873 élevèrent les anciens traitements au point de départ et au point d'arrivée ; les maxima purent atteindre: pour les directeurs 3400 fr. pour les adjoints 2000 fr. ; pour les directrices 2900 fr., pour les adjointes 1800 fr. ; à ces traitements s'ajoutaient le logement ou des indemnités de 600 et de 400 francs. Par une mesure qui devait se généraliser plus tard, un certain nombre de directeurs et de directrices furent déchargés de classe et purent ainsi vaquer librement à leur fonction de surveillance et de direction. Les salles d'asile, malgré les efforts d'un personnel dévoué, conservaient leur caractère primitif de garderie ou de refuge. A raison de leurs effectifs exagérés, la méthode propre à ces établissements était plutôt appliquée dans son mécanisme que dans son esprit ; grands et petits, confondus en un seul auditoire, recevaient en commun des leçons qui, si habilement qu'elles fussent faites, ne profitaient en réalité à personne. Gréard conçut la pensée d'isoler, au moins à certaines heures, les enfants les plus âgés et les plus intelligents et de leur faire donner, par les maitresses, des leçons au cours desquelles la méthode pût déployer toutes ses ressources et produire tous ses résultats. A cet effet, des salles spéciales furent préparées et pourvues du matériel froebelien. C'est peut-être la seule amélioration possible et pratique que comporteront de longtemps nos salles d'asile ou écoles maternelles. La jeune fille peut passer sans danger de l'école maternelle à l'école primaire : elle y retrouve au moins les soins et la main d'une femme. Mais il n'en est pas de même pour le petit garçon ; il sautait brusquement du régime doux de la salle d'asile au régime sévère et à la forte discipline de l'école, souvent au grand préjudice de son développement physique et moral. Pour parer à cet inconvénient, Gréard provoqua la création d'écoles spéciales de petits garçons, confiées exclusivement à des femmes de choix, donnant ainsi l'idée des classes ou écoles enfantines, qui devaient plus tard prendre place dans la hiérarchie de nos établissements scolaires. Pour beaucoup, quoi qu'on fasse, l'instruction n'est qu'ébauchée à l'école primaire. D'un autre côté, une foule d'ouvriers arrivent illettrés dans la capitale et y apportent un contingent d'ignorance qu'il importe de combattre. C'est pour cela qu'à Paris les cours d'adultes ont été, de tout temps et plus qu'ailleurs, une nécessité. Pendant la période dont nous nous occupons, ces cours furent réorganisés sur les bases suivantes : séparation des adultes des apprentis : gradation des cours, divisés, comme ceux des écoles du jour, en cours élémentaire, moyen et supérieur ; institution d'un examen spécial pour l'obtention d'un certificat d'études primaires : substitution, pour les maîtres, d'un traitement fixe aux anciennes indemnités éventuelles ; précautions prises pour assurer au moins la fréquentation régulière des jeunes apprentis. (Gréard, L'enseignement primaire à Paris et dans le département de la Seine de 1867 à 1877, p. 144.) Outre le besoin de développer son instruction générale, l'ouvrier de Paris, pour soutenir sa renommée d'habileté et de bon goût et maintenir sa supériorité incontestée d'exécution, se trouve dans la nécessité de perfectionner sans cesse son éducation esthétique. Tel a été le but de la création, dès l'origine, d'écoles spéciales de dessin. En 1867, le nombre des écoles de dessin d'art était de 26, celui ries écoles de dessin géométrique de 9. Dix ans plus tard, le nombre des unes était porté à 33, celui des autres à 12. Des prix et des concours encouragèrent les maîtres et les élèves. L'enseignement du dessin fut, en outre, introduit dans le programme même de l'école primaire, et partout, d'après l'avis des meilleurs maîtres, le relier fut substitué à l'estampe, qui demeura seulement comme corrigé. Les femmes eurent à leur disposition des cours subventionnés au nombre de 20, qui furent ramenés à 13 afin de concentrer davantage les éléments et les ressources ; pour les préparer au commerce, à l'apprentissage, à une meilleure tenue du ménage, il fut ouvert des cours de comptabilité, de coupe et d'assemblage, etc. La gymnastique fut établie dans les écoles de Paris en 1872. Une leçon eut lieu dès lors dans chaque école à l'issue de la classe du soir, de 4 heures 1/2 à 5 heures, trois fois par semaine. En 1876, il n'y avait pas moins de 203 maîtres, tant instituteurs que professeurs spéciaux. Cet enseignement fut également introduit dans les écoles de filles et fut confié aux jeunes maîtresses formées à l'école normale ou à des maîtresses dont l'aptitude avait été préalablement constatée. Dans une capitale comme Paris, un grand nombre d'enfants trouvent une carrière dans Te haut commerce, dans l'industrie, dans les administrations publiques ou particulières. Ils doivent y être spécialement préparés par un enseignement intermédiaire, c'est-à-dire trouvant sa place entre l'enseignement primaire élémentaire qui ne suffit pas, et l'enseignement secondaire qui est trop élevé ou qui, dans l'espèce, serait beaucoup plus nuisible qu'utile. Paris n'avait, pour satisfaire à ce besoin, que Chaptal et Turgot. Trois autres écoles du type Turgot furent ajoutées à ces établissements : les écoles Colbert, rue de Château-Landon (20e arrondissement), Lavoisier, rue d'Enfer (5e arrondissement), J.-B. Say, rue d'Auteuil (16° arrondissement) ; une quatrième, l'école Arago, devait en outre bientôt s'élever près de la barrière du Trône (12e arrondissement). Mais le plus grand nombre des enfants qui forment la clientèle ordinaire de l'école primaire la quittent pour l'atelier, et presque toujours de bonne heure, au grand préjudice de leur développement physique, intellectuel et moral. Il importe à un haut point que des exercices intelligents de travail manuel puissent les disposer à l'apprentissage en le retardant de quelques années, et le rendre en même temps moins long, moins dangereux et plus fructueux. C'est dans cette pensée que fut conçue et organisée l'école d'apprentis de la Villette, à laquelle correspondirent, dans une certaine mesure, sur la rive gauche, les ateliers annexés à l'école communale de la rue Tournefort. Ces institutions, comme on le voit, préludaient à l'introduction du travail manuel dans le programme de l'instruction primaire. En même temps, la question de l'apprentissage était étudiée, et, si elle n'était pas résolue, des mesures étaient au moins prises pour que les nécessités de l'apprentissage pussent se concilier avec la fréquentation de l'école (écoles de demi-temps et cours du soir). Les études primaires n'avaient eu jusque-là pour encouragements que des bourses d'apprentissage, des distributions de récompenses trimestrielles et annuelles, des bourses dans les écoles supérieures, obtenues par voie de concours. Les bourses d'apprentissage, tombées en discrédit et presque délaissées, furent remplacées par des livrets de caisse d'épargne, plus immédiatement appréciés des familles. Le certificat d'études fut réglementé et particulièrement encouragé, car, pensait Gréard, « si le concours est l'épreuve de l'élite, l'examen du certificat d'études est l'épreuve de la moyenne. C'est par un progrès naturel, sans autre effort que celui d'une application de chaque jour, que les élèves peuvent arriver à ce couronnement de leurs études. » (Rapport au préfet de la Seine, du 25 septembre 1875.) Au milieu de toutes ces améliorations, la situation numérique des établissements, des classes et des effectifs scolaires s'était ainsi modifiée :
Le fait le plus saillant qui ressort de ces chiffres, c'est la décadence des écoles libres, aussi bien quant au nombre des établissements qu'au nombre des élèves qui les fréquentent. Bien organisée, mieux installée, mieux outillée, objet d'une surveillance et d'une sollicitude incessantes, entièrement gratuite d'ailleurs, l'école publique ne peut qu'absorber de plus en plus l'école libre payante, abandonnée à ses propres ressources, écrasée par le prix des loyers, souvent en outre desservie par des maîtres ou maîtresses de passage qui, la plupart, aspirent à trouver dans l'enseignement public une position plus assurée et plus lucrative. Nous devions insister particulièrement sur cette période de dix années ; toutes les grandes réformes que réclamait l'instruction primaire à Paris y ont été réalisées ou bien y trouvent leur point de départ. L'administration de Carriot, qui a suivi celle de Gréard, n'a eu en quelque sorte qu'à les développer. 2. — Situation de l'instruction primaire à Paris en 1883-1884. — Ecoles maternelles. — Les écoles maternelles (anciennes salles d'asile), dont on a poursuivi et étendu la transformation, étaient, en 1883-1884, au nombre de 128 avec 20 215 places ; 16 écoles enfantines en étaient en quelque sorte le prolongement. Ecoles primaires de garçons et de filles, — Ces établissements, en 1883-1884, étaient pour les garçons, au nombre de 188, y compris les 16 écoles enfantines précédentes (64 556 places) ; pour les filles, au nombre de 173 (57 242 places). Pour satisfaire à la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement obligatoire, la Ville dut procéder à des installations provisoires dites baraquements. Les améliorations apportées dans le régime des écoles étaient : la généralisation de l'institution des directeurs et directrices non chargés de classe, la création d'un grand nombre de cours complémentaires, où l'enseignement est plus développé et qui suppléent, dans une certaine mesure, à l'insuffisance des écoles primaires supérieures ; l'établissement de cantines scolaires qui permettent aux enfants de trouver à midi, soit gratuitement, soit moyennant une rétribution des plus modiques, des aliments chauds et réconfortants. Apprentis et adultes. — Des classes dites de demi-temps, spécialement destinées aux apprentis des deux sexes, étaient ouvertes, aux heures les plus commodes, pour assurer l'exécution de la loi du 19 mai 1874 et, de celle du 28 mars 1882. Elles étaient au nombre de 62 et recevaient environ 2000 élèves. Les cours d'adultes, ouverts le soir, de 8 heures 1/2 à 10 heures 1/2, se divisaient en cours d'enseignement primaire et en cours spéciaux de chant, de dessin et d'enseignement commercial. Les cours d'enseignement primaire étaient répartis entre 116 écoles, 68 pour les jeunes gens, 48 pour les jeunes filles. Ils réunissaient d'une part 12 430 élèves, d'autre part 3719. On comptait, pour les jeunes gens, 28 cours spéciaux de chant fréquentés par 825 élèves, et, pour les jeunes filles, 7 cours du même ordre qui, quoique de création récente, réunissaient déjà environ 200 personnes. Ecoles primaires supérieures. — Les écoles supérieures de garçons mentionnées plus haut comptaient 3930 élèves tant externes que pensionnaires. Une école supérieure pour les jeunes filles, établie rue de Jouy, recevait 300 élèves ; des projets étaient à l'étude pour la création, à bref délai, de quatre ou cinq autres écoles du même genre. Enseignement professionnel. — On comprend sous cette dénomination des écoles préparatoires aux divers métiers ou professions qu'embrasseront, selon toute probabilité, les élèves des écoles primaires. Pour les garçons ou jeunes gens, la Ville avait l'école d'apprentis du boulevard de la Villette (désignée sous le nom d'école Diderot). Elle possédait, depuis 1881, l'école municipale de chimie et de physique industrielles de la rue Lhomond. Pour les filles, elle avait créé les écoles professionnelles et ménagères de la rue Bossuet, de la rue Violet et de la rue Galeron, ainsi que des cours spéciaux d'enseignement commercial qui avaient lieu le soir, de 8 à 10 heures, de façon à pouvoir être fréquentés par les jeunes gens et les jeunes filles employés dans le commerce. Pour la préparation des jeunes filles aux professions qui leur sont accessibles, la Ville était secondée par l'initiative privée. Ainsi, la Société pour l'enseignement professionnel des femmes, qui continuait l'oeuvre entreprise en 1862 par Mme Elisa Lemonnier. entretenait, rues de Poitou, Duperré, d'Assas, des Boulets, des écoles où plus de 500 jeunes filles, tout en perfectionnant leur instruction, suivaient des cours de commerce, de couture, de dessin industriel, de gravure et de peinture sur porcelaine, sur faïence ou sur verre. Un certain nombre d'écoles rivales, dites catholiques, avaient adopté le même plan d'études et poursuivaient le même but. La Société pour l'instruction élémentaire, que nous avons vue fonder en quelque sorte l'instruction primaire laïque sous la Restauration, faisait faire, rue du Fouarre, des cours gratuits où plusieurs centaines de jeunes filles trouvaient le complément d'instruction nécessaire pour l'obtention du brevet élémentaire ou du brevet supérieur. Pour les garçons, la Chambre de commerce entretenait, rue Amelot et rue Trudaine, des écoles pour les hautes études commerciales ; les Associations polytechnique, philotechnique, etc., se chargeaient, dans des cours du soir, de compléter les enseignements donnés dans les écoles du jour. Il existait enfin des écoles spéciales d'orfèvrerie, d'horlogerie, de papeterie, de typographie, etc. A toutes ces institutions, la Ville ajoutait de nombreux cours de couture, comprenant la coupe et la confection des vêtements, et surtout des cours de dessin. Commencé par les instituteurs et les institutrices dans les cours élémentaire et moyen, confié ensuite à des maîtres spéciaux et d'une aptitude éprouvée, l'enseignement du dessin se continuait dans les classes plus élevées, dans les écoles supérieures, enfin dans des cours spéciaux au nombre de 63 pour les hommes et de 14 pour les femmes. Il était encouragé par des concours, par des récompenses telles que livrets de caisse d'épargne, livres, médailles, et, pour les jeunes gens, par des bourses de voyage qui permettent aux élèves jugés les plus aptes de faire une tournée d'études en France ou à l’étranger. Comme préparation générale à l'éducation professionnelle, la Ville, devançant l'application de la loi du 28 mars 1882, avait introduit, dans ses écoles communales de garçons, le travail manuel : à partir de l'âge de dix ans, les enfants étaient appelés à participer à des exercices d'atelier, dirigés, sous la surveillance des instituteurs, par des contremaîtres choisis parmi les ouvriers présentant les garanties de moralité et de compétence nécessaires. Institutions complémentaires. — Il était pourvu aux besoins des enfants pauvres ou délaissés par les caisses des écoles et par une caisse dite des pupilles. Une caisse des écoles était fondée depuis longtemps dans chaque arrondissement. La caisse des pupilles avait pour objet d'assurer l'éducation des enfants que leurs familles ne pouvaient élever elles-mêmes, en les plaçant dans des pensionnats primaires libres choisis après une enquête minutieuse. Les enfants admis dans ces internats ne pouvaient y être reçus avant l'âge de six ans et y rester au delà de l'âge de treize ans. A partir de cet âge, l'administration, si les familles le désiraient, leur assurait l'apprentissage d'un métier manuel en les admettant dans ses établissements d'enseignement professionnel. A cet effet, le Conseil municipal, non content d'avoir établi la gratuité absolue dans les écoles primaires supérieures, avait créé un certain nombre de bourses d'entretien, qui pouvaient être accordées aux familles dignes d'intérêt, pour leur permettre de faire suivre à leurs enfants les études primaires supérieures et de se priver du salaire que les enfants auraient pu leur rapporter s'ils avaient été employés immédiatement à un travail manuel. Les Conseils municipaux élus qui se sont succédé depuis 1871 avaient voté des millions pour mettre l'instruction primaire à la hauteur des besoins de la cité parisienne. En dehors des sommes considérables affectées à la construction de nouveaux locaux, au renouvellement ou à la transformation du matériel, la Ville consacrait annuellement plus de 24 millions et demi (24 565 601 francs en 1883-1884) à l'entretien de ses écoles et aux services qui en sont les accessoires obligés. Un développement si marqué de l'enseignement primaire public n'avait pu que hâter la décadence de l'enseignement libre, au moins des écoles privées laïques. Ces derniers établissements n'étaient plus qu'au nombre de 722, dont 161 pour les garçons et 561 pour les filles. Par contre, l'enseignement privé congréganiste avait trouvé l'occasion d'une prospérité au moins momentanée dans la laïcisation des écoles communales. Cette grave mesure, commencée en 1879, avait reçu son dernier complément en 1883. En général, les frères et les soeurs dépossédés avaient ouvert des établissements privés dans le même quartier (67 pour les garçons et 139 pour les filles). Le plus grand nombre de leurs élèves les y avaient suivis. D'un autre côté, les écoles communales où ils avaient été remplacés s'étaient promptement remplies, et la laïcisation avait étendu le bienfait de l'instruction primaire à un plus grand nombre d'enfants. [E. BROUARD, avec additions.] 3. — L'enseignement primaire à Paris, de 1884 à 1909. Ecoles primaires élémentaires et Ecoles maternelles publiques. Le développement de l'enseignement primaire élémentaire public a continué d'une manière ininterrompue dans cette période. Les écoles maternelles, qui n'étaient qu'au nombre de 128 en 1884, étaient en 1909 au nombre de 177. Le nombre des écoles de filles est passé de 173 à 213, celui des écoles de garçons de 188 à 202. Le nombre des maîtres s'est élevé, dans cette période, pour les écoles de garçons, de 1450 à 1917, pour les écoles de filles de 1413 à 1992, pour les écoles maternelles de 408 à 896, soit au total une augmentation de 1534 maîtres et maîtresses, l'effectif total étant finalement de 4805, chiffre auquel il convient d'ajouter 344 stagiaires suppléants et stagiaires suppléantes, portant ce total à 5149. Quant au nombre des élèves incrits, il était en 1884 de 24 377 dans les écoles maternelles, de 52 543 dans les écoles de filles, de 62 521 dans les écoles de garçons. En 1909, il est de 43 720 dans les écoles maternelles, de 81 101 dans les écoles de filles, et de 81 471 dans les écoles de garçons, soit une augmentation de 19 343 pour les écoles maternelles, de 28 558 pour les écoles de filles, et de 18 950 pour les écoles de garçons. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la fréquentation paraît s'être légèrement améliorée. En effet, tandis qu'en 1884 la moyenne des présences était dans les écoles de filles de 47 519 et dans les écoles de garçons de 57 778, en 1909 elle est da»s les écoles de filles de 75 939 et dans les écoles de garçons de 77 437, c'est-à-dire que la proportion des présences par rapport aux inscriptions est passée, pour les écoles de filles, de90 % à 94 %, et pour les écoles de garçons de 92 % à 95 %. L'organisation pédagogique des écoles primaires élémentaires de Paris ne s'est pas trouvée modifiée par les règlements organiques de 1887. On peut dire, au contraire, que ces règlements ont étendu cette organisation à toutes les écoles de France, dans lesquelles la division en trois cours s'est trouvée appliquée. Mais tandis que dans beaucoup d'écoles de province le cours supérieur n'existe pas en fait, toutes les écoles de Paris ont au moins une division de cours supérieur. Seulement, une distinction est à faire entre ces divisions de cours supérieur dans les différentes écoles. Il en est en effet où, la majorité des élèves possédant déjà le certificat d'études, la préoccupation de la préparation à cet examen n'existe pas. L'enseignement s'en trouve allégé, et une place un peu plus grande est faite aux matières pour lesquelles il n'y a pas de sanction à l'examen. Ces cours, qui ont un emploi du temps un peu différent de celui des autres, prennent le nom de cours supérieur A. Les résultats qui y sont obtenus sont très intéressants. Dans la plupart des cours supérieurs et dans un certain nombre de cours moyens, les enseignements spéciaux, dessin, chant, travail manuel et gymnastique, sont donnés en tout ou en partie par un personnel spécial. Ecoles privées. L'enseignement privé a subi une diminution correspondant à ce développement des écoles publiques. Les écoles privées de garçons, qui étaient au nombre de 219 en 1884, ne sont plus maintenant qu'au nombre de 116. Les écoles de filles, qui étaient au nombre de 708, ne sont plus qu'au nombre de 481, ce qui, pour l'ensemble des écoles élémentaires, représente une diminution de 330écoles, se décomposant de la manière suivante : Ecoles laïques de garçons, 47 écoles de moins ; Ecoles congréganistes de garçons, 56 écoles de moins ; Ecoles laïques de filles, 115 écoles de moins ; Ecoles congréganistes de filles, 112 écoles de moins. Quant aux écoles maternelles privées, de 62 elles sont passées à 34. La diminution porte presque exclusivement sur les écoles congréganistes, qui étaient 43 et qui ne sont plus que 16. Le nombre total des élèves de toutes les écoles privées, qui était de 95 913, est maintenant de 58 765. Les écoles laïques de garçons, qui en avaient 13 750, en ont 12 860 ; les écoles laïques de filles, qui en recevaient 27 824, en reçoivent 32 600. Les écoles congréganistes de garçons ont vu leur effectif tomber de 19 197 élèves à 3711 ; celui des écoles congréganistes de filles est tombé de 35342 à 9594. Pour se rendre compte de la mesure dans laquelle ces variations sont dues à l'application de la loi qui a supprimé l'enseignement congréganiste, loi dont l'exécution ne sera complète qu'en 1914, il convient de rapprocher les chiffres que nous venons de citer de ceux que donne la statistique de 1900. En 1884, les écoles congréganistes de garçons étaient au nombre de 67 ; elles étaient au nombre de 69 en 1900: elles sont au nombre de 11 en 1909. Il y avait 143 écoles congréganistes de filles en 1884 ; il y en avait 162 en 1900 : il en reste 31 en 1909. En 1884, les écoles congréganistes de garçons recevaient 19 197 élèves ; elles en avaient 20 352 en 1900, et seulement 3711 en 1909. En 1884, les écoles congréganistes de filles comptaient 3 542 élèves ; en 1900, 41 978 ; en 1909, seulement 9594. Enseignement primaire supérieur. Une seule école primaire supérieure a été créée à Paris dans la période que nous étudions. C'est l'école primaire supérieure de jeunes filles ouverte rue des Martyrs sous le nom d'École Edgar Quinet. La construction d'une nouvelle école primaire supérieure de jeunes filles dans le quartier de la gare Montparnasse est actuellement à l'étude. L'école Lavoisier (garçons) a été entièrement reconstruite et agrandie. Au total, on compte aujourd'hui 8 écoles primaires supérieures, ayant en tout 6010 élèves, soit 4931 garçons et 1079 filles. Dans leur ensemble, ces établissements sont loin de suffire aux besoins de la population, si l'on en juge par le nombre considérable de demandes d'admissions, nombre bien supérieur à celui des places vacantes ; une sélection est faite à l'aide d'un concours ouvert dans chacune des écoles, de telle sorte qu'on peut dire que l'enseignement gagne à cette situation en qualité ce qu'il perd en quantité. La valeur même de ce recrutement a comme résultat que, bien que les programmes soient à peu près les mêmes que ceux des écoles primaires supérieures de province, l'enseignement a un caractère plus élevé. Dans toutes les écoles primaires supérieures de garçons, des élèves de quatrième année se préparent soit à l'Ecole centrale, soit à l'Ecole municipale de physique et chimie. Au collège Chaptal, la modification est encore plus profonde, et un décret du 26 juillet 1895 a constaté cette situation en définissant ce collège : un établissement spécial d'enseignement primaire supérieur auquel est annexée une section d'enseignement secondaire moderne. Cette disposition a permis au collège Chaptal de prendre part au concours général des lycées et collèges de Paris jusqu'à la suppression de ce concours, et d'y remporter les plus brillants succès. Chaque année, il fait recevoir un grand nombre d'élèves au baccalauréat et aux diverses écoles du gouvernement. Ses succès sont particulièrement brillants à l'Ecole polytechnique, où, à diverses reprises, le premier rang a été obtenu par un élève du collège Chaptal. Un décret du 26 janvier 1896 a institué au ministère de l'instruction publique un comité consultatif « chargé d'étudier les questions relatives au personnel des écoles primaires supérieures de Paris. Ce comité, composé du vice-recteur, des directeurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire au ministère, de huit membres du Conseil municipal, de trois délégués du Conseil supérieur, de cinq inspecteurs généraux, et du directeur de l'enseignement primaire de la Seine, adresse au ministre des propositions pour les nominations aux fonctions de directeurs, surveillants généraux, professeurs titulaires et délégués ; les maîtres auxiliaires et les répétiteurs sont nommés par le préfet. Des écoles primaires supérieures se rapprochent les cours complémentaires, dont l'organisation a reçu de profondes modifications depuis 1897. Si, dans un certain nombre de ces cours, on a continué à appliquer les anciens programmes et à consacrer la plus grande partie du temps aux matières d'enseignement général, il en est au contraire d'autres où plus de la moitié des heures de la journée est réservée aux enseignements spéciaux, dessin et travail manuel pour les garçons (cours complémentaires professionnels) ; dessin, travaux féminins, couture, lingerie, modes, ménage (cours complémentaires manuels et ménagers), comptabilité, dactylographie, sténographie, langues vivantes (cours complémentaires commerciaux), pour les filles. Actuellement, sur 40 cours complémentaires de garçons, recevant 1799 élèves (au lieu de 12 cours recevant 592 élèves en 1884), on compte 17 cours complémentaires professionnels, recevant 598 élèves ; sur 51 cours complémentaires de filles, avec 3132 élèves (au lieu de 33 cours en 1884 avec 1255 élèves), on compte 16 cours complémentaires manuels et ménagers, recevant 799 élèves, et 4 cours commerciaux qui en reçoivent 439. Enseignement professionnel. Les écoles professionnelles de Paris sont aujourd'hui au nombre de 15, soit 7 pour les garçons et 8 pour les filles. A l'école d'apprentis Diderot, fondée en 1873 ; à l'école municipale de physique et chimie, fondée en 1882 ; aux écoles de dessin appliqué, Germain Pilon et Bernard Palissy, créées en 1882 et 1883, sont venues s'ajouter pour les garçons, en 1889, l'école Estienne (école du Livre), et en 1886 l'école Poulie (école du Meuble). D'autre part, l'orphelinat Dorian, acheté par la Ville en 1885, reconstruit et agrandi depuis, a une section professionnelle fortement organisée dans laquelle renseignement est analogue à celui de l'école Diderot et où sont admis un certain nombre d'externes par voie de concours. Dans les huit écoles professionnelles de filles, à l'exception de l'école de la rue Duperré, ancienne école Elisa Lemonnier rachetée par la Ville en 1906, qui est réservée à l'enseignement du dessin appliqué à l'industrie, les jeunes filles sont préparées aux diverses professions de la femme, couture, modes, lingerie, confection, broderie, fleurs artificielles, etc. Les matinées y sont d'ailleurs consacrées à l'enseignement général, tout au moins pendant les deux premières années d'études. Une loi du 27 décembre 1900 a soumis à l'autorité du ministère du commerce les écoles professionnelles de Paris, qui jusque-là étaient placées sous le condominium des deux ministères de l'instruction publique et du commerce. Le ministre du commerce nomme les directeurs ; le préfet désigne les autres fonctionnaires sur la proposition du directeur de l'enseignement primaire de la Seine. Pour le personnel technique, les comités de patronage sont consultés ; le plus souvent ils organisent des concours pour la désignation des titulaires. Les écoles professionnelles de garçons reçoivent actuellement 1186 élèves, les écoles professionnelles de filles 2165. Ces écoles rendent de très grands services, mais n'ont pas complètement résolu la question de l'apprentissage à Paris. L'éducation des élèves y coûte cher, et l'on ne pourrait les multiplier sans imposer à la Ville des sacrifices considérables ; les élèves en sortent trop jeunes pour qu'on puisse leur confier dans les industries des situations en rapport avec l'instruction qu'elles ont reçue. Aussi, une enquête est-elle instituée en ce moment après laquelle on a lieu d'espérer qu'une solution de cette question si importante pourra être adoptée. Dès maintenant, un projet est à l'étude pour la création, dans un certain nombre d'écoles primaires, de classes dites d'apprentis dans lesquelles les enfants pourvus du certificat d'études seraient admis toute la journée, mais recevraient un enseignement encore plus pratique que celui des cours complémentaires professionnels dont il a été question plus haut. Dans un grand nombre d'écoles de Paris, en effet, sont installés des ateliers pour le travail du fer ou du bois (55 pour le fer et 138 pour le bois), qui ne sont occupés par les élèves que quelques heures par semaine. Des maîtres ouvriers — dont le recrutement, assuré par un cours normal, s'améliore chaque jour — y donnent l'enseignement du travail manuel. Des combinaisons faciles à imaginer permettraient d'utiliser ces locaux et ce personnel pour les classes d'apprentis projetées, de manière que cette création puisse être réalisée dans les meilleures conditions et sans entraîner de grosses dépenses, les instituteurs de l'école pouvant, moyennant des indemnités spéciales, prêter leur concours en ce qui concerne l'enseignement général. Cours d'adultes. Parmi les cours d'adultes entretenus par la Ville de Paris, il en est d'ailleurs qui, à ce point de vue de l'instruction des apprentis, offrent un intérêt tout particulier. Ce sont les cours dits « techniques », qui, créés en 1895, sont aujourd'hui au nombre de 13 et reçoivent 1144 élèves. L'enseignement dans ces cours comprend, outre l'étude des éléments de géométrie, de technologie et de physique nécessaires aux diverses professions, des exécutions graphiques et des travaux d'atelier. Leur programme varie dans le détail suivant les besoins du quartier où ils sont installés. Ils ont lieu le soir ou le dimanche dans la matinée. Leurs résultats sont très appréciés ; ils seraient tout à fait satisfaisants si la fatigue des élèves qui y assistent après une journée d'un travail souvent pénible ne nuisait forcément à leurs progrès. Aussi, depuis 1908, trois essais ont-ils été tentés dans des conditions qui les rendent particulièrement intéressants. Ce sont des cours qui ont lieu de cinq heures et quart à six heures trois quarts et qui ont été institués dans des locaux d'école par l'initiative privée, avec l'encouragement et le concours des industriels du quartier. L'un de ces cours est aujourd'hui entretenu par la Ville, les deux autres le seront certainement à brève échéance, car le succès a paru répondre aux espérances de leurs fondateurs. Le premier s'adresse plus particulièrement aux apprentis mécaniciens, le second aux apprentis tôliers-ferblantiers-ornemanistes, le troisième aux menuisiers parqueteurs. A côté de ces cours, il convient de placer les cours commerciaux, au nombre de 69 pour les hommes et 38 pour les femmes, recevant respectivement 3100 et 840 élèves. Les cours de dessin pour les adultes hommes reçoivent 2832 élèves ; pour les femmes, les cours de dessin ne sont qu'au nombre de cinq, mais des subventions sont largement accordées à des cours libres dits « cours subventionnés », qui prennent part aux concours généraux institués pour les élèves des cours municipaux. Enfin, les cours d'adultes proprement dits, qui ont pour objet non pas d'apprendre la lecture et l'écriture à des illettrés, mais de compléter l'enseignement primaire donné dans les écoles, sont actuellement au nombre de 160, 108 pour les hommes, recevant 3510 élèves, 52 pour les femmes, avec 700 élèves. A côté de ces cours entretenus par la Ville, des sociétés d'enseignement (Association polytechnique, Association philotechnique, Société d'enseignement moderne, Société pour l'instruction élémentaire, etc.) ont créé d'innombrables cours qui, trop souvent, font double emploi sur certains points. Il est incontestable qu'une partie des efforts considérables qui sont faits ainsi en faveur de l'enseignement populaire sont perdus. Une commission de surveillance vient d'être instituée, composée de représentants des ministères de l'instruction publique et du commerce, de l'administration municipale, du Conseil municipal et des différentes associations, qui mettra dans l'organisation de cet enseignement libre l'unité et l'ensemble de vues qui font défaut, subordonnera la concession des locaux scolaires aux besoins réellement constatés, et assurera peut-être une meilleure répartition des subventions qui sont accordées à ces associations et qui s'élèvent à 120 000 francs environ par an. Recrutement du personnel. Le personnel des instituteurs et des institutrices des écoles de Paris se recrute presque exclusivement parmi les maîtres et maîtresses des écoles de la banlieue. Des exceptions sont faites seulement pour les élèves sortis respectivement des deux écoles normales en tête de leur promotion et qui sont appelés directement dans les écoles élémentaires de Paris. D'autre part, les élèves de l'école normale d'institutrices qui le demandent sont pourvues immédiatement d'emplois dans les écoles maternelles de la Ville. En 1909, treize ont été dans ce cas. Mais la banlieue elle-même a des besoins bien supérieurs aux effectifs des écoles normales. Ces deux écoles reçoivent chaque année 40 élèves chacune, et ce chiffre n'a été atteint tout récemment à l'école normale d'institutrices que grâce à la mesure qui a permis d'externer la majorité des élèves et a rendu vacante une partie des locaux occupés par les dortoirs. En 1909, il a fallu pourvoir à 163 emplois d'instituteurs et à 236 emplois d'institutrices. La plupart des institutrices qui ont été nommées avaient reçu une préparation pédagogique suffisante ; le plus grand nombre avaient d'ailleurs exercé soit en province, soit dans l'enseignement privé, et leur valeur est attestée par les épreuves qu'elles ont subies dans le concours institué pour le recrutement d'un cadre d'institutrices auxiliaires chargées du service des remplacements en banlieue et recevant, outre l'indemnité journalière prévue par la loi, un traitement fixe de 900 francs assuré par le département ; c'est à ces institutrices et aux élèves de l’école normale que sont réservés les neuf dixièmes des emplois vacants dans le cadre légal. Pour les instituteurs, la situation est différente. Il est vrai que beaucoup de maîtres de province qui, pour la plupart, sont des élèves d'école normale, demandent à venir dans le département de la Seine, mais on ne peut pas attribuer à ces candidats toutes les places vacantes, d'abord, parce que ce serait fermer la porte de l'enseignement public aux jeunes gens originaires du département de la Seine, ensuite parce que l'entrée dans les cadres de ce département d'instituteurs comptant déjà des services modifie les conditions de l'avancement, ce qui ne va pas sans soulever des protestations. Force est donc de faire appel à un certain nombre de débutants dont l'apprentissage se fait dans le service des remplacements, et cela n'est pas sans inconvénient. Il y a la quelque chose à faire, et la question vaut qu'on s'en préoccupe. Diverses solutions sont à l'étude. Administration, inspection. L’inspecteur de l'académie de Paris délégué par le ministre à la préfecture de la Seine y exerce en vertu d'une nomination préfectorale les fonctions de directeur des services départementaux et municipaux d'enseignement. Un emploi de sous-directeur vient d'être créé, dont le titulaire, qui appartiendra au cadre des inspecteurs d'académie des départements, pourra seconder le directeur dans une partie de ses attributions. Le service de l'inspection est confié à dix-sept inspecteurs primaires, dont onze affectés spécialement à Paris, et cinq à la banlieue, une circonscription s'étendant à la fois sur Paris et la banlieue ; à trois inspectrices primaires pour les écoles de filles de six arrondissements de Paris ; et à cinq inspectrices des écoles maternelles, dont le service est réparti entre Paris et la banlieue. Une circulaire du 7 mai 1906 a chargé celles-ci, à l'exclusion des inspecteurs primaires, de visiter, d'inspecter les écoles maternelles, de veiller à l'exécution des programmes, et de noter le personnel. A côté de ces fonctionnaires nommés par le ministre, des inspecteurs et des inspectrices désignés par le préfet sont chargés d'inspecter soit les enseignements spéciaux, soit les services administratifs proprement dits. Enfin, l'inspection médicale des écoles qui, jusqu'à ce jour, était assurée par 126 médecins en vertu d'un règlement du 15 décembre 1883, sera confiée à partir du 1er octobre 1910 à 210 médecins qui non seulement protégeront les écoles contre la propagation des maladies contagieuses, mais encore tiendront à jour un livret individuel pour chaque élève. Le traitement de ces fonctionnaires sera d'ailleurs porté de 800 à 1200 francs par an. OEuvres auxiliaires de l'école. Diverses institutions ont pour but d'assurer la fréquentation de l'école par les enfants pauvres et de la leur faciliter, ainsi que d'éviter l'abandon dans la rue à ceux dont les familles ne peuvent se charger d'eux en dehors des heures de classe. Pour recevoir les enfants avant l'ouverture et les garder après la fermeture de l'école, il a été créé depuis 1896 par la Ville des garderies du matin, des études surveillées du soir, et des classes du jeudi. Les premières, au nombre de 43, ont reçu en 1909 1135 élèves ; les secondes ont compté 14 533 enfants, dans 359 classes ; les troisièmes, ouvertes dans 309 écoles, ont été fréquentées par 11 741 enfants. Les caisses des écoles ont été spécialement créées pour assurer et faciliter la fréquentation scolaire. Elles font face à cet objet au moyen des cotisations de leurs membres, de dons et legs, et de subventions de la Ville. Au 31 décembre 1909, leur actif total s'élevait à 2036 050 francs. A l'aide de leurs ressources propres, les caisses d'écoles distribuent des vêtements et des chaussures aux enfants des écoles primaires. Elles reçoivent des subventions de la Ville pour le service des cantines, pour les distributions de vêtements et chaussures dans les écoles maternelles, pour les colonies scolaires et les excursions de vacances. En 1909, les cantines scolaires, au nombre de 349, ont fourni des repas à 43 381 enfants, dont 13 750 payants, et 29 811 nourris gratuitement ; ce service a coûté 1 128 700 francs, dont 1 050 000 fournis par la Ville à titre de subvention, 379 500 formant la recette des bons payants, et 78 870 pris sur les ressources propres des "caisses des écoles. Le prix de revient moyen de la portion a été de 15 centimes. Pour fourniture de vêtements aux enfants des écoles maternelles, les caisses des écoles ont reçu en 1909 une subvention de 60 000 francs, et 23 757 enfants ont été secourus. Les colonies de vacances, créées en 1889, ont remplacé entièrement les anciens voyages de vacances. Le Conseil municipal y affecte une subvention qui. de 80 000 francs en 1891, est passée à 225 000 fr. en 1909. Les colonies sont en général installées dans des écoles primaires supérieures ou des collèges de province. Mais six caisses des écoles ont acquis des domaines spéciaux. En 1909, 7241 enfants (3471 garçons, 3770 filles) ont été envoyés dans les colonies. Le séjour dure vingt et un jours en moyenne. La caisse des écoles du 16e arrondissement a essayé de doubler la durée du séjour. Il y a là un essai intéressant, premier acheminement vers l'école permanente de plein air. Le prix de revient par enfant est de 55 à 60 francs. La dépense totale pour 1909 a été de 310 588 francs, sur lesquels les caisses des écoles ont fourni 85 588 francs. Des mensurations effectuées avant le départ et au moment du retour permettent de constater les heureux effets de ces séjours hors de Paris. Des augmentations de poids qui vont jusqu'à 1 kg. 500 et des développements de taille qui atteignent et dépassent un centimètre sont relevés. Enfin, des excursions journalières sont organisées pour les enfants fréquentant les classes de vacances. Les caisses des écoles ont reçu pour cet objet en 1909 une subvention totale de 11 300 francs, et 17 070 enfants ont pris part aux promenades. Il ne faut pas oublier dans les oeuvres complémentaires de l'école l'enseignement de la prévoyance et de la solidarité. Les caisses d'épargne scolaires, en facilitant les dépôts les plus minimes, apprennent aux enfants la prévoyance. Leur succès va croissant. En 1907, la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris a reçu, de 388 écoles, 82 638 versements formant un total de 207 867 francs, en augmentation de 15 595 francs sur l'année précédente. Quand à la solidarité, elle est largement enseignée par la création des mutualités scolaires, qui en 1910 existent dans tout Paris, un arrondissement longtemps réfractaire, le 13e, étant enfin entré dans le mouvement. Cette oeuvre n'est pas uniforme. Dans certains arrondissements, elle est organisée par la municipalité ; dans d'autres, elle est entièrement libre ; ici, une seule mutualité groupe toutes les écoles d'un arrondissement ; là, il y a plusieurs groupes distincts. La croissance de ces sociétés scolaires est remarquable. Le 4° arrondissement compte en 1909 1750 membres, soit 149 de plus qu'en 1908 ; dans le 7e il y a 1243 mutualistes, en augmentation de 200 sur l'année précédente ; la mutualité du 12e arrondissement a gagné 1500 sociétaires de 1906 à 1909 ; elle en a aujourd'hui 5100. L'actif de ces diverses sociétés est considérable : 100000 francs dans le 10e arrondissement, 234 900 dans le 20e, 145 000 dans le 12e, 70000 dans le 18e, etc. OEuvres complémentaires de l'école. Outre les cours d'adultes, les cours techniques, les cours du soir de toute nature dont il a été parlé plus haut, l'oeuvre scolaire est continuée après l’école par les « Petites A » ou associations amicales d'anciens élèves, et les patronages. Les premières ont pour objet de maintenir ou d'étendre l'instruction reçue à l'école, d'assister, de divertir leurs adhérents par des cours, des conférences, des fêtes. Les seconds s'efforcent, sous des formes variées, de venir en aide aux enfants les plus pauvres, souvent avec le concours des mères de famille. Ils organisent des cours, des exercices de travail manuel, des jeux, des études musicales et de langues vivantes, des promenades. Certains font plus particulièrement oeuvre de solidarité. Dans le 13e arrondissement, le patronage protège et secourt à domicile les petits chiffonniers et en envoie aux colonies scolaires de vacances. Dans chaque école, l'initiative particulière se manifeste en tout genre ; les unes organisent des exercices de tir, de préparation militaire, de natation ; dans certaines, situées près des casernes, il est fait des cours du soir pour les militaires ou les gardes républicains ; un peu partout il s'est fondé sous les auspices de l'administration des sociétés filiales de la Ligue antialcoolique, et nombreuses sont les oeuvres spéciales d'aide mutuelle, oeuvres de trousseaux, de vestiaire ; certains patronages ont organisé des cours professionnels (broderie, corsets, modes, éducation ménagère), d'autres créent des colonies de jeunes apprenties pour envoyer celles-ci au grand air. Au total, il existait à Paris en 1909 191 sociétés, petites A ou patronages, et le Conseil municipal leur accordait des subventions s'élèvant à 37 350 francs. Ce que coûtent à la Ville de Paris l'enseignement primaire et l'enseignement professionnel. Les lois de 1889 et de 1893 out laissé à la charge de la Ville de Paris toutes les dépenses de l'enseignement primaire. Le budget municipal de l'enseignement primaire et de l'enseignement, professionnel s'est élevé de 1884 à 1910 de 24 565 000 francs à 33 663 000 francs. Mais en même temps des dépenses considérables ont dû être engagées sur des fonds d'emprunt pour la construction des bâtiments devenus absolument nécessaires. Depuis 1886, date d'un premier emprunt de vingt millions, les dépenses de cette nature se sont élevées à plus de 80 millions, et actuellement on commence l'exécution d'un plan de campagne dans lequel des projets sont prévus pour une somme de 91 millions environ, dont 86 millions pour l'enseignement primaire. D'autre part, une somme de 4 millions sera consacrée à la remise en état des bâtiments existants, dont beaucoup, malgré les dépenses considérables faites annuellement par la Ville, laissent à désirer. Résumé. Les dépenses qui sont imposées à la Ville de Paris par les lois scolaires sont considérables, ainsi que les sacrifices qu'elle consent d'autre part soit pour améliorer la situation des instituteurs (allocations viagères de 400 à 600 francs aux instituteurs et aux institutrices qui, lors de leur mise à la retraite, ont vingt-cinq ans de service à Paris ; indemnités aux maîtres pourvus de certains diplômes, à ceux qui ont été retardés dans leur avancement ; indemnités compensatrices des suppressions de traitement résultant de l'application de la loi de 1853 aux instituteurs atteints de maladies contagieuses des voies respiratoires ; allocations de 300 et 600 francs à plus de six cents instituteurs comptant plus de cinq ans dans la première classe, etc.), soit pour venir en aide aux familles nécessiteuses des enfants des écoles (bourses, secours d'études, subventions aux caisses des écoles, cantines, colonies scolaires, etc.), soit pour les cours d'adultes, les enseignements spéciaux, l'enseiseignement professionnel, etc. ; et, si, sur certains points, il reste quelque chose à faire, la Ville s'en préoccupe. Si des écoles sont en mauvais état, on va les réparer, les reconstruire, les agrandir ; si des locaux sont insuffisants, on va en édifier pour une somme considérable ; si la question de l'apprentissage n'est pas encore complètement résolue, on fait tous les jours quelque chose de nouveau, et le problème va être envisagé dans son ensemble, ainsi que celui de la prolongation si désirable de la scolarité. Dans ces conditions, et étant donnés les avantages de toute sorte que la Ville de Paris assure aux enfants de ses écoles, auxquels toutes les fournitures scolaires sont distribuées gratuitement, il semblerait inutile de se demander si la loi sur l'obligation est strictement observée. Le nombre des conscrits illettrés constaté au conseil de revision a considérablement diminué. (Dans le département, on en compte, en 1908, 190 sur 26000 conscrits. En 1884, il y en avait 612, sur 17 562 conscrits.) Mais ce nombre est encore trop élevé ; il ne devrait plus y avoir d'illettrés du tout depuis la loi de 1882. Il est vrai que les chiffres que nous citons portent sur tous les conscrits nés dans le département de la Seine, et que Paris non plus que le département ne peut être tenu comme responsable de ce que sont devenus ceux qui l'ont quitté depuis leur enfance, et beaucoup des illettrés sont dans ce cas. D'autre part nous avons constaté plus haut que la fréquentation des écoles par les élèves inscrits s'est améliorée. Au surplus, à envisager l'aspect des rues dans les quartiers populaires les jours de classe et les jours de congé, on se rend compte que bien peu d'enfants échappent à l'école. Cependant, on n'oserait affirmer que tous la fréquentent, non pas que les places y manquent: les expectants qu'on trouve dans certaines statistiques et dont le nombre pourrait sembler inquiétant sont surtout des enfants qui sont reçus dans une école et dont l'inscription est demandée dans une autre qui pour le moment est au complet. D'ailleurs, partout où cela est nécessaire, la Ville crée des bourses dans des écoles privées. L'amélioration et l'agrandissement de nos locaux fait que le nombre de ces bourses diminue chaque année. Actuellement le crédit qui y est affecté est de 155 000 francs. Mais il est matériellement impossible d'observer complètement à Paris certaines prescriptions de la loi de 1886. Les listes des enfants d'âge scolaire que les municipalités doivent dresser chaque année ne peuvent être établies avec certitude ; une partie de la population extrêmement mobile échappe à tout contrôle, et c'est précisément dans ces familles nomades que la surveillance serait nécessaire. Les commissions scolaires n'y peuvent rien. Leur action s'exerce surtout sur les élèves inscrits dans les écoles publiques. Une modification à la loi parait absolument nécessaire. Il semble bien que dans une ville comme Paris on n'en obtiendra l'observation complète que si l'on assimile à une contravention ou à un délit de droit commun le fait d'y manquer, et si l'on charge de la répression les autorités qui recherchent et qui répriment les autres contraventions et les autres délits. [L. DEDOREZ.] 4. Situation du personnel enseignant de la Ville de Paris. — Un règlement en date du 20 août 1892, modifié par les décrets des 25 juin 1898 et24 juillet 1904, la loi de finances du 22 avril 1905 (art. 52) et le décret du 4 juillet 1907, a déterminé ainsi qu'il suit : 1° le mode de classement et d'avancement des instituteurs et des institutrices de la ville de Paris ; 2° les conditions de nomination des instituteurs suppléants et des institutrices suppléantes ; 3° le taux des indemnités représentatives de logement attribuées au personnel enseignant des écoles primaires publiques de Paris: «ARTICLE PREMIER. — Les instituteurs et les institutrices attachés aux écoles publiques primaires et maternelles de la Ville de Paris sont soumis à un double régime de classement et d'avancement : « 1° Au régime général établi par les dispositions des articles 6, 24 et 34, paragraphe 3, de la loi du 19 juillet 1889 ; « 2° Au régime spécial municipal déterminé par les articles suivants. « ART. 2. — Ils sont répartis en instituteurs et institutrices stagiaires, en instituteurs et institutrices titulaires. « ART. 3. — Les instituteurs et les institutrices stagiaires reçoivent un traitement fixe de 1100 francs, une indemnité de résidence de 500 francs, et l'indemnité représentative de logement fixée à l'article 9. « Ceux qui ne sont pas affectés à un poste fixe ne reçoivent, à titre d'indemnités de résidence et de logement, qu'une allocation de 2 fr. 50 par jour de service. « Le nombre des stagiaires chargés des suppléances est fixé par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil départemental. « ART. 4. — Les instituteurs et les institutrices titulaires se divisent en titulaires adjoints et adjointes et en titulaires directeurs et directrices. « ART. 5. — Les instituteurs titulaires adjoints et les institutrices titulaires adjointes sont répartis en cinq classes dont les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
« Le passage d'une classe à l'autre ne peut avoir lieu qu'après trois ans d'exercice au minimum dans la classe inférieure. « Le nombre des promotions dans chaque classe ne pourra dépasser chaque année le quart de l'effectif de la classe immédiatement inférieure. « Ne peuvent être promus dans les deux premières classes que les instituteurs titulaires adjoints et les institutrices titulaires adjointes pourvus du brevet supérieur. « ART. 6. — Les instituteurs titulaires adjoints et les institutrices titulaires adjointes ne peuvent être appelés à une direction d'école que s'ils appartiennent à la première ou à la deuxième des classes prévues par l'article précédent. « Il est dressé annuellement, dans les conditions ci-après déterminées, un tableau d'avancement pour la nomination des instituteurs et des institutrices aux emplois de directeur ou de directrice d'école de Paris. « Le préfet de la Seine, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement primaire de la Seine : « 1° Dresse la liste des instituteurs et institutrices dont les titres à une direction d'école à Paris lui paraissent devoir être examinés par une commission spéciale composée comme il est dit ci-dessous ; « 2° Fixe le nombre des candidats à inscrire sur le tableau d'avancement. « La commission spéciale comprend : « Le préfet de la Seine, président ; « L'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement primaire de la Seine, vice-président ; « Les inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire en exercice dans le département de la Seine ; « Les inspectrices des écoles maternelles de ce département ; « Dix membres du Conseil départemental de l'enseignement primaire, savoir : le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices, membres de droit ; quatre conseillers généraux ; deux instituteurs et deux institutrices délégués par le Conseil départemental. « Le tableau arrêté par la commission est publié au Bulletin départemental de l'instruction primaire. « ART. 7. — Les instituteurs titulaires directeurs et les institutrices titulaires directrices sont répartis en quatre classes dont les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
« Le passage d'une classe à l'autre peut avoir lieu après trois ans d'exercice au minimum dans la classe inférieure. « Le nombre des promotions dans chaque classe ne pourra dépasser chaque année le tiers de l'effectif de la classe immédiatement inférieure. « ART. 8. — Les promotions de classe sont accordées par arrêtés du préfet de la Seine, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement. « Il ne sera fait de promotion qu'une fois par an avec effet à dater du 1er janvier suivant. « Les stagiaires remplissant les conditions de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886 sont titularisés au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. « ART. 9. — Les indemnités représentatives de logement attribuées au personnel des écoles primaires publiques élémentaires et maternelles de la Ville de Paris sont fixées ainsi qu'il suit : « 1° Instituteurs et institutrices stagiaires, instituteurs et institutrices titulaires, 600 francs ; « 2° Instituteurs et institutrices titulaires chargés d'une direction, 800 francs. « ART. 10. — Les traitements et indemnités fixés par les articles 3 et 5 tiendront lieu, pour le personnel des écoles publiques de Paris, des traitements, suppléments de traitements et indemnités prévus par les articles 7, 8, 9 et 12 de la loi du 19 juillet 1889. « ART. 11. — Le décret du 20 mai 1890 est abrogé. « Dispositions transitoires. « ART. 12. — Les instituteurs et les institutrices attachés à une des classes établies par le décret du 20 mai 1890 seront, pour le classement général prévu au paragraphe 1er de l'article 1er, versés dans la classe correspondant à celle qu'ils occupaient lors de la promulgation du présent règlement. « ART. 13. — Les instituteurs et les institutrices de la Ville de Paris qui jouissent actuellement d'émoluments supérieurs à ceux déterminés par le présent règlement conserveront ces émoluments aussi longtemps qu'ils resteront dans les fonctions qu'ils occupent. « ART. 14. — Par dérogation au dernier paragraphe de l'article 5 pourront être promus à la 2° et à la 1re classe les instituteurs titulaires, en fonctions au 19 juillet 1889, qui ne seront pas pourvus du brevet supérieur. » Indemnités de résidence. — L'indemnité de résidence est, en ce qui concerne le personnel des écoles primaires supérieures, primaires élémentaires, et maternelles de Paris, incorporée au traitement. (Loi de finances du 13 avril 1898, art. 50.) Avantages spéciaux. — Grâce à la libéralité du Conseil municipal, le personnel de l'enseignement primaire de Paris jouit de certains avantages qui améliorent sensiblement sa situation matérielle. Voici les principaux : a) Des allocations viagères de 600 francs sont accordées aux inspecteurs primaires retraités qui ont accompli dix années de services dans le département de la Seine. (Délibération du 28 décembre 1906.) b) Il est institué, pour les instituteurs, une première classe hors cadre, dite de décanat. Cette classe est accessible à tous les instituteurs sous la condition d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans la première classe. Les maîtres rangés dans cette classe reçoivent une allocation supplémentaire de 300 francs non soumise à retenues. Après cinq ans de décanat, ils peuvent obtenir une nouvelle augmentation de 300 francs d'émoluments. Les instituteurs et institutrices munis de brevets spéciaux (chant, gymnastique, travail manuel) reçoivent une allocation annuelle de 50 francs par brevet. Le brevet supérieur de travail manuel donne droit à une allocation annuelle de 150 francs. Les institutrices munies du brevet de coupe et couture reçoivent une indemnité de 100 francs. D'autre part, la Ville de Paris vient largement en aide aux instituteurs malades, particulièrement à ceux qui sont atteints de tuberculose, lorsqu'ils sont privés e tout ou partie de leur traitement par application de la loi du 9 juin 1853. Enfin, en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du 23 décembre 1890, des allocations viagères sont accordées, en sus de leur pension, aux instituteurs retraités qui comptent à la fois cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de services à Paris. Ces allocations sont ainsi fixées : 600 francs pour les directeurs. 500 francs pour les directrices. 400 francs pour les instituteurs-adjoints. 300 francs pour les institutrices-adjointes. Pour le personnel des écoles primaires supérieures, Voir Primaires supérieures (Ecoles). |