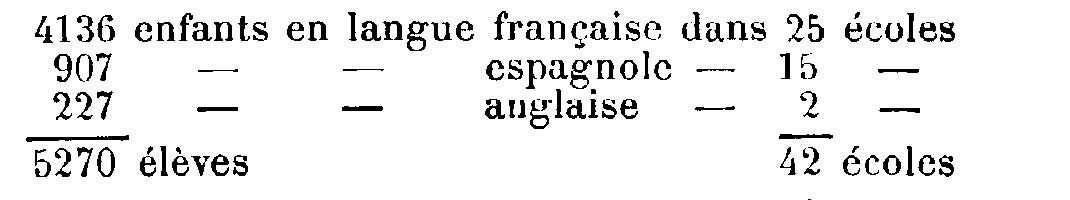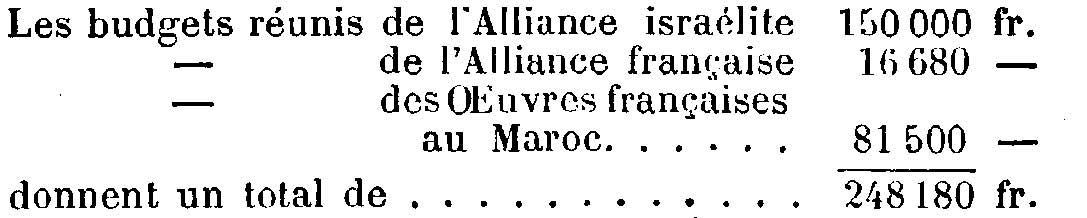|
mMarocPour se rendre compte du développement réel de l'instruction au Maroc, il ne faut pas s'arrêter seulement à l'étude des institutions étrangères au pays qui, depuis quelques années, s'efforcent d'y faire pénétrer l'éducation et l'instruction européennes. Ces institutions ne s'adressent d'ailleurs, à de bien rares exceptions près, qu'à l'élément européen et à l'élément israélite. Le Maroc est un pays musulman, et sur les huit millions d'habitants que l'on peut estimer qu'il possède, il n'y a certainement pas cinq cent mille Israélites. Le véritable enseignement populaire, celui dont l'étude peut donner la notion du niveau de l'instruction de la masse de la population, et par conséquent du niveau de sa civilisation, est donc l'enseignement musulman. Nous diviserons ce rapide aperçu en trois parties : I. Enseignement musulman ; — II. Enseignement israélite indigène ; — III. Enseignement étranger. I — Enseignement musulman. Cet enseignement n'a pas sensiblement varié depuis des siècles, et c'est faire son historique que de l'étudier tel que nous l'avons encore sous les yeux. Un des caractères distinctifs du Maroc, c'est son immuabilité traditionnelle, et cette immuabilité est peut-être plus complète en matière d'enseignement qu'en toute autre chose. Nous l'avons appelé enseignement musulman et non enseignement marocain, parce qu'il est uniquement religieux et que la dénomination d'enseignement marocain pourrait éveiller une idée d'instruction nationale qui serait complètement fausse. Tout, dans l'organisme marocain, aux points de vue judiciaire, financier et administratif, étant fondé sur la seule religion, la connaissance de cette religion est la seule qui soit considérée comme ayant une utilité quelconque. Le Coran et les Hadit (traditions), et leurs nombreux commentaires, toute la science musulmane marocaine est là. On peut y ajouter quelques ouvrages d'hagiographie et d'histoire, qui d'ailleurs ne sont pas enseignés et qui ne sont lus que par quelques rares savants. L'enseignement musulman peut être divisé en trois ordres, qui correspondent approximativement à ce que nous appelons enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur. Il n'y a pas au Maroc de budget de l'instruction publique. Les enseignements primaire et secondaire sont entretenus par les habitants des villes ou des villages où se trouvent des écoles. Dans les villes, cependant, il existe encore des professeurs qui reçoivent sur les habous (biens d'Eglise) une petite indemnité, et qui font dans une mosquée un cours, ouvert à qui veut venir y assister, sur quelques commentateurs du Coran. L'enseignement supérieur donné à Fez est seul l'objet d'une organisation budgétaire ; alimentée par les biens habous. Enseignement primaire. — C'est l'enseignement coranique, qui consiste à apprendre le Coran par coeur. La façon de procéder est toujours la même, que ce soit dans les villes, où l'école est appelée Msid, ou dans les tribus, où elle est appelée Djama. Le professeur s'appelle El Fakih, les élèves El M'hadra, au singulier El M'hadri. Chaque enfant est porteur d'une planchette (El louh) de bois dur, dont l'essence varie forcément suivant les régions. Cette planchette est en forme de trapèze de 40 centimètres environ de hauteur, sur 25 centimètres dans sa base la plus large et 20 centimètres dans son côté le plus étroit. Pour écrire, l'enfant recouvre cette planchette d'un enduit d'argile délayée dans de l'eau, que l'on appelle çounçal. On écrit sur cette sorte d'ardoise avec le Calem (plume de roseau) habituel, en se servant d'une encre appelée smac ou smagh. Cette encre est faite soit avec de la laine brûlée, et c'est la meilleure, soit avec de la corne d'agneau brûlée. La laine dont on se sert est celle qui est le plus près de la peau et qui est imprégnée de suint. Lorsque l'enfant a appris à écrire les lettres de l'alphabet, à les relier entre elles et à connaître leur valeur exacte, ainsi que toutes les voyelles et les signes orthographiques, le maître commence à lui apprendre, en la lui dictant, la première sourate du Coran, El Fatiha. Il ne se sert pour cela d'aucun livre : il sait le Coran par coeur. Au fur et à mesure que la planchette est couverte d'écriture, l'enfant apprend par coeur ce qu'il a écrit ; son attention et sa mémoire sont fortement stimulées par la crainte des coups de baguette de cognassier que le maître lui applique sur la plante des pieds pour corriger ses erreurs ou ses oublis. Dans ce cas, la victime est maintenue par deux de ses camarades qui tiennent ses pieds à la portée de la baguette du fakih. Cette correction est usitée pour toutes les fautes des écoliers, et elle leur est même souvent infligée s'ils se conduisent mal en dehors de l'école. Lorsque la phrase écrite sur la planchette est complètement apprise par l'enfant, elle est effacée et remplacée par la phrase suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin du Coran. Après que l'enfant a appris la première sourate, au lieu de continuer par la deuxième, la Vache, qui est la plus longue du Coran, et qui contient deux cent cinquante-six versets, on lui fait apprendre la dernière, les Hommes, et il continue ainsi à rebours, pour terminer par la deuxième sourate, qu'il apprend la dernière. Tous les enfants n'arrivent pas d'ailleurs, il s'en faut de beaucoup, à apprendre le Coran en entier. Un grand nombre, après avoir inutilement pendant des années fréquenté assidûment l'école et reçu une quantité innombrable de coups de baguette, sans compter tous les petits supplices inventés par les professeurs irascibles, comme de les pincer, de les mordre, et même de les faire suspendre par les pieds et par les mains aux solives du plafond, comme le berger d'Ulysse, sont reconnus incapables de recevoir dans leur mémoire le livre sacré et, au grand désespoir de leurs parents, prennent un métier quelconque ou font paître les troupeaux. Aucune explication n'est donnée aux enfants sur le Coran, qu'ils apprennent ainsi par coeur ; le maître qui le leur apprend serait d'ailleurs très embarrassé d'expliquer le moindre passage de ce qu'il enseigne. Toute sa science consiste à savoir le Coran par coeur d'un bout à l'autre, à en connaître admirablement l'orthographe exacte, toutes les intonations, tous les accents ; mais il n'y comprend rien, et ne cherche pas à comprendre, pas plus que ses élèves. Si l'un d'eux, ce qui n'arrive d'ailleurs jamais, s'avisait de demander une explication sur le sens des phrases qu'on lui fait apprendre par coeur, par lambeaux, il serait d'abord battu, pour le bon exemple, et ensuite certainement exorcisé, car seule la présence en lui d'un démon pourrait expliquer sa curiosité. On n'apprend pas le Coran pour le comprendre, mais pour le savoir, pour le posséder, non parce que cela peut être d'une utilité quelconque dans la conduite de la vie, mais pour le mérite, El Ajar, et pour la bénédiction, El Baraka, qui sont attachés au fait de posséder dans sa mémoire tout le livre sacré. La principale occupation et même la principale préoccupation de tous ceux qui sont arrivés, après bien des années, à réaliser ce tour de force de mémoire, consiste à ne pas oublier ce qu'ils ont appris, et à entretenir leur mémoire par une continuelle récitation du Coran, de façon à n'en pas perdre un seul mot. C'est que, par une singulière interprétation de quelques versets de la quinzième sourate, les Marocains en sont arrivés à croire que ceux qui, ayant appris le Coran, l'auraient oublié, seront frappés de cécité dans l'autre monde. La prononciation du Coran a une très grande importance, et elle est sujette à quelques variantes, sans cesser d'être orthodoxe. La connaissance de ces différentes manières de prononcer constitue ce que l'on appelle la science des Riouaya. Sept chioukh (pluriel de cheikh) ont posé les bases des sept prononciations différentes du Coran: on les appelle Es Saba Chioukh ET Riouaya, les « sept cheikhs de Riouaya ». Au Maroc, on n'enseigne pas les sept prononciations ; la lecture qui est adoptée dans les écoles coraniques de toutes les villes et de toutes les tribus est celle de Ouarch. disciple de Nafa ; elle est conforme au dialecte de Coreich. La très grande majorité des tolba (pluriel de taleb, « savant », littéralement « chercheur de science ») marocains n'en connaissent pas d'autre. Ceux qui veulent pousser plus loin l'étude de la prononciation du Coran continuent par la méthode de Caloun, qui ne diffère pas grandement de celle de Ouarch, attendu qu'il est comme lui élève de Nafa. On continue ensuite par la lecture d'El Mekki, qui est conforme au dialecte de Hodeil ; puis par El Baçri, qui est en dialecte des Haouâzil. Enfin le plus haut degré de la science de la lecture du Coran, au Maroc, est atteint par la prononciation du Cheikh Hamza, qui est en dialecte des Beni-Asad. Ouarch, Caloun, El Mekki, El Baçri et Hamza sont les Chioukh Er Riouaya les plus généralement enseignés au Maroc ; le dernier est considéré comme la perfection dans cette science. Un taleb flamzaoui jouit d'une très grande considération, et, dans les régions soumises au Makhzen, les tolba Hamzaouïn sont exempts d'impôts. Tous les versets du Coran ne doivent pas être lus suivant la prononciation du même cheikh, et, pour arriver à la science parfaite du livre sacré, il faudrait savoir lire chaque verset avec la prononciation du cheikh qui lui convient. Pour faire reconnaître de quel cheikh il faut employer la lecture pour chaque verset, on place en face de ce verset une lettre qui indique le cheikh dont il faut suivre la prononciation. Ces cheikhs, avec leurs disciples, ne sont pas moins de vingt. Comme nous l'avons dit, au Maroc on n'enseigne généralement que la lecture de cinq d'entre eux. Quelques rares tolba lisent également les autres cheikhs. Les jeunes gens qui ont appris le Coran sous la direction d'un fakih Ouarchi et qui, par conséquent, ne connaissent que la lecture d'Ouarch, s'ils veulent pousser leurs études de lecture et de prononciation pour arriver à celle de Hamza, vont suivre, dans des écoles souvent éloignées de chez eux, les leçons des professeurs qui enseignent les différentes prononciations ; on appelle ces professeurs Fokaha Er Riouaya. On les trouve dans certaines villes et dans les tribus de montagnes ; il y en a rarement dans les tribus arabes des plaines. Les élèves qui viennent, de loin suivre ces cours s'appellent les tolba mekhanchin (de khancha, sac), parce qu'ils mettent pour voyager leur petit bagage dans un sac qu'ils portent sur le dos. Ils sont logés dans l'école même et sont nourris par la charité des habitants. C'est un acte méritoire que de donner le mârouf à un taleb ou à plusieurs tolba. La nourriture qu'on leur donne est d'ailleurs peu coûteuse et ne suffirait certainement, ni par sa quantité ni par sa qualité, au plus modeste et au moins exigeant de nos étudiants pauvres. Le local de l'école est des plus simples et son mobilier très primitif. Dans les villes, l'école, appelée M'sid, se compose d'une pièce, généralement au rez-de-chaussée, souvent sans fenêtres et ne recevant la lumière que par la porte. Le mobilier de l'école se compose universellement d'une simple natte achetée par les élèves, et d'une sorte de banc très bas sur lequel le professeur est assis, les jambes repliées sous lui. Les élèves sont assis de la même façon sur la natte. Il n'y a jamais ni bancs ni pupitres. L'éclairage, en hiver, se fait au moyen d'une lampe qui se compose d'un verre suspendu au plafond par un fil de fer, et dans lequel se trouve de l'huile d'olive et une mèche faite d'un bout de chiffon de coton. L'huile de cette veilleuse est fournie par les élèves. Les dimensions des écoles sont très variables, et il y en a à Fez qui sont de grandes salles au premier étage, assez bien éclairées ; mais c'est l'exception. Le m'sid est généralement une petite pièce humide, mal éclairée et mal aérée. Ces pièces sont le plus souvent la propriété des biens habous, et sont quelquefois attenantes à une mosquée. Il arrive également qu'un habitant prélève sur sa propre maison une pièce à laquelle il ouvre une porte sur la rue pour en faire une école aux enfants de son quartier. Jamais aucun loyer n'est prélevé pour les écoles. Le maître d'école s'appelle El Fakih El Moucharit, c'est-à dire le professeur engagé par contrat. En effet, une sorte de contrat intervient entre les habitants et le professeur, d'après lequel ce dernier prend possession du m'sid du quartier. Dans les villes, les professeurs ne reçoivent aucun appointement fixe, ni en argent, ni en pains, ni sous aucune autre forme. Le jour de marché de la ville, chaque élève remet au professeur une petite somme, rarement inférieure à 25 centimes, rarement supérieure à 50. Le nombre des élèves pouvant être estimé à une moyenne de vingt par école, cela fait une petite somme variant de 5 à 10 pesetas par semaine. De plus, chaque fois qu'un élève a appris par coeur un certain nombre de versets du Coran, on remet au professeur une petite somme variant de 2, 50 à 5 pesetas. Le fait se produit toujours pour quelques élèves chaque semaine. Lorsqu'il s'agit d'un enfant de famille aisée, la somme est un peu plus forte. En résumé, on peut estimer que les appointements d'un fakih varient, suivant la localité, de 75 à 150 pesetas par mois ; aussi vivent-ils assez misérablement. Un grand nombre, qui ont peu d'élèves, augmentent leurs moyens l'existence en cousant des vêtements d'hommes. Comme ils sont généralement mariés, leurs femmes les aident en faisant de la couture ou en travaillant la laine. Dans les villages arabes des plaines, les douars, l'école, El Djama, est en même temps la mosquée. Cette djama est quelquefois simplement dans une tente ou dans une nouala, cabane de roseaux, ou dans une chambre construite en briques crues. Tente, nouala ou chambre, la djama est édifiée et entretenue aux frais des habitants du village. Les écoles des villages ne sont pas, comme celles des villes, éclairées par des veilleuses à l'huile. Ce sont les élèves qui s'éclairent eux-mêmes, en apportant chacun un peu de bois ou d'herbe sèche. On allume cette herbe et ce bois dans un coin de la djama, sous une ouverture préparée dans la toiture pour laisser échapper la fumée, ce qui n'empêche pas celle-ci de se répandre dans l'école au point de suffoquer les assistants. Les élèves lisent leurs planches à la lumière de ce feu ; entretenu par un des élèves, qui garde auprès de lui des sarments et des brindilles sèches pour les jeter sur le feu lorsque la flamme baisse. La durée du contrat par lequel le professeur est engagé est d'un an. Les conditions sont les suivantes : le fakih a droit à une touiza, c'est-à-dire à une ou deux journées de labour faites à son profit par les attelées de labour du douar. La terre et la semence sont fournies par le douar. Généralement il ne s'agit que d'une touiza de dra (sorte de maïs), dont on sème un quart de moudd (50 à 60 litres). Quelquefois on fait également une touiza de blé, d'un moudd de semence environ. De plus, le douar doit remettre au fakih une certaine quantité de blé par an, de dix à vingt moudds, selon l'importance du village. Chacun donne sa part de blé proportionnellement. Souvent la touiza est remplacée par une somme d'argent fixe remise au fakih. Celui-ci est nourri par le douar. Chaque famille à tour de rôle envoie sa nourriture à la djama. Chaque mercredi, les élèves apportent au fakih, qui un peu de beurre, qui un peu de laine ; ce sont les mères qui donnent à leurs (ils ces petits cadeaux pour le professeur. A la tonte des moutons, chaque propriétaire de moutons donne un peu de laine au fakih. Celui-ci n'est pas habillé par le douar et ne reçoit aucun cadeau aux fêtes. On lui envoie simplement dans ces occasions, comme lors des mariages, des naissances, ou autres réjouissances, sa part des plats de la fêle. Il est rare que le contrat d'un an ne soit pas renouvelé, et les professeurs restent souvent sept ou huit ans dans le même douar. Dans les tribus des montagnes (Djebala), l'école s'appelle El M'imra (« celle qui est pleine ») ; elle est indépendante de la mosquée du village. C'est un bâtiment en pierres sèches, crépi à la chaux, et composé seulement d'un rez-de-chaussée sans fenêtres ; la lumière vient par la porte ; cette construction, très primitive, est recouverte d'un grand toit de chaume. Entre le plafond de l'école et le toit se trouve un grenier auquel on monte par un escalier extérieur fait de grosses pierres. Ce grenier sert à emmagasiner les provisions d'huile ou de grains, et souvent de poudre et de balles, qui sont la propriété des habous de la mosquée du village. L'école est bâtie par la commune ; les nattes qui la garnissent sont achetées par les élèves, et l'huile qui sert à l'éclairage est fournie par les habous de la mosquée. Le nombre des écoles varie naturellement en proportion de l'importance du village. Les villages des Djebala, qui s'appellent dchars, se divisent en quartiers (haoum) ; chaque quartier a généralement une école. Le maître d'école est engagé aux conditions suivantes: 1° Il est fait pour lui une touiza, comme dans les tribus des plaines, avec cette différence que chaque habitant donne ses animaux de labour, ses charrues et ses laboureurs, mais que la semence est fournie par le fakih ; le terrain est donné par un des habitants les plus riches ou par plusieurs d'entre eux ; tous les travaux particuliers au labourage, le sarclage ; la moisson, le dépiquage, les transports, sont faits par la communauté ; 2° toutes les semaines, chaque maison apporte au fakih une certaine quantité de beurre de vache, de brebis ou de chèvre, selon ce que possède chacun : cela s'appelle tantôt El Djemaïa Et Tolba, « le produit de la collecte des tolba», tantôt El Khemis Et Taleb, « le jeudi du taleb », parce qu'il est d'usage de remettre au professeur la quantité de beurre battu le jeudi, et que ce sont les élèves qui profilent du congé du jeudi pour battre ce beurre ; 3° on remet de plus au professeur une petite somme d'argent annuelle qui varie de 50 à 60 mitkals, c'est-à-dire, au cours actuel du mitkal, qui vaut environ 40 centimes, de 20 à 25 pesetas hassani, qui représentent de 13 fr. 50 à 10 francs, suivant le change ; 4° il reçoit une certaine quantité de grains, généralement deux moudds de blé, deux moudds d'orge et deux moudds de dra ; 5° la communauté donne au fakih l'animal, mouton ou bouc, qui est sacrifié à la fête de l'Aïd-el-Kebir, le dernier jour de Doul Hidja, le dernier mois de l'année ; dans les tribus de montagnes, c'est généralement un bouc qui sert à ce sacrifice ; 6° enfin, une toison de mouton par chacun des troupeaux appartenant aux gens du village ou du quartier qui engage le fakih doit être remise à ce dernier au moment de la tonte. En dehors de ces conditions réglées par le contrat passé avec le maître, il y en a d'autres établies par l'usage et qui, sans faire l'objet d'aucune stipulation, constituent cependant des obligations pour la communauté. Ainsi, tous les mercredis les élèves font au fakih un petit cadeau appelé Er rebbia (de arba, le quatrième jour de la semaine, le mercredi) ; ce cadeau se compose de quelques sous. Ceux qui n'ont pas d'argent, et c'est le plus grand nombre, apportent deux ou trois oeufs, ou un peu de beurre. Il est d'usage également, dans les écoles de la montagne comme dans les autres, que, lorsqu'un enfant a appris par coeur un chapitre du Coran, il donne au fakih une petite somme ne dépassant pas un bilioun (25 centimes). De plus, une petite fête est donnée au fakih et aux écoliers à chaque khetma ou soulka. Voici quelques explications à ce sujet. Le Coran se divise en soixante hizb ; ces soixante hizb se partagent en quatre fractions de quinze hizb chacune. Chaque fois que l'enfant a achevé d'apprendre une de ces fractions, cela constitue une soulka, qui donne lieu à une khetma. Il y a donc dans le Coran quatre soulkas, et par conséquent quatre khetmas. La khetma est plus ou moins importante selon la fortune de la famille de l'écolier. Dans les écoles des tribus de la plaine ou de la montagne, on donne au fakih dans cette circonstance une petite somme variant de 2, 50 à 5 pesetas ; dans les villes, la somme est plus importante et atteint quelquefois 20 ou 25 pesetas. A ces quatre soulkas, il faut ajouter la soulka et kebira, qui donne lieu à une grande fête, nommée El Khetma el Kebira. C'est lorsque l'écolier sait par coeur le Coran tout entier. L'écolier qui a réalisé ce tour de force de mémoire est taleb ; il ne sait rien: souvent même son intelligence naturelle est pour longtemps, si ce n'est définitivement, détruite ; mais il est capable de réciter, dans un sens ou dans l'autre, le Coran tout entier, sans commettre une erreur ; il porto en lui la parole de Dieu, non seulement sans la comprendre, mais sans chercher à la comprendre, sans se douter même qu'elle puisse être comprise. Comprendre n'est rien, peut-être même est-ce mal ; savoir est tout : à partir de ce moment, l'enfant, ou plutôt le jeune homme, car il faut des années pour arriver à retenir par coeur le Coran tout entier, devient un personnage et il est entouré de la considération universelle. Le nouveau taleb est triomphalement conduit de l'école chez lui, avec accompagnement de tambourins et de hautbois. Dans les tribus arabes et dans certaines villes, il est à cheval, entouré de ses camarades, à pied, qui conduisent son cheval par la bride. Dans les tribus de montagnes, il est à pied. Il a son capuchon baissé sur le visage, et il porte comme un livre ouvert, dans ses deux mains, la planchette qui lui a servi et sur laquelle sont écrits, au centre, la première sourate du Coran, et les premiers versets de la deuxième sourate, la Vache, par un taleb ayant une belle écriture. Sur les côtés, en biais, sont inscrits les premiers versets de la sourate 48, la Victoire ou la Conquête, qui commence par ces mots : « Nous avons fait pour vous une conquête évidente ». Dans les tribus de plaine, des cavaliers galopent autour du nouveau taleb, en tirant des coups de fusil ; dans les tribus de montagnes, ce sont les remaya, les tireurs du village. La famille de l'élève offre un repas plantureux à ses parents et à ses amis, et une somme variant de 100 à 5 pesetas, selon les ressources de la famille, est remise au fakih. De plus, à chacune des quatre khetmas et à la khetma et kebira, l'élève, lorsqu'il est ramené chez lui, s'asseoit par terre, entouré de ses camarades, qui psalmodient des versets du Coran ; il tient sur ses genoux sa planchette, en ayant toujours son capuchon abaissé sur le visage. Tous les gens de sa famille et les amis passent à tour de rôle devant lui et déposent sur la planchette une petite somme. Le produit de cette collecte est remis au fakih après la cérémonie. Dans les écoles des campagnes, plaines ou montagnes, les conditions suivantes sont également posées aux maîtres d'école : Si les habitants du village qui ont engagé le fakih consentent à fournir à des tolba étrangers la nourriture qui leur est nécessaire, ce que l'on appelle El Märouf, le fakih est obligé de recevoir ces tolba. Il est stipulé également que le fakih doit faire la prière publique aux jours de fêles. S'il y a plusieurs professeurs dans le même village, c'est le plus âgé qui fait la prière, et les autres sont tenus d'y assister. Ce n'est qu'après cette prière que les professeurs qui ne sont pas originaires du village où ils professent, et qui ont leurs femmes dans un autre village, peuvent aller chez eux. De même, pour la fête de l'Aïd el Kebir, le fakih ne peut s'en aller qu'après avoir égorgé le mouton de la communauté. Les professeurs doivent également rester dans les villages où ils sont engagés, pour la nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan : Lilat el Cadr. C'est la nuit pendant laquelle le Coran est descendu sur la terre. Pendant cette nuit, les tolba, réunis dans la mosquée, récitent le Coran tout entier ; ils se partagent cette besogne en récitant chacun une partie du saint livre. Voici comment sont réglées, dans toutes les écoles de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, les heures de classe : Les élèves vont à l'école le matin, au lever du soleil ; ils y restent jusqu'à midi ; après avoir déjeuné chez eux, ils retournent à l'école où ils dorment jusqu'à une heure et demie. Le fakih les réveille alors et la classe reprend jusqu'au moghrib, le coucher du soleil. Ils sortent, pendant que le fakih fait la prière du moghrib, et reviennent ensuite à l'école, où ils restent jusqu'à l'acha, une heure et demie après le coucher du soleil. Le mercredi, à l'acer, moment de la journée qui partage par la moitié le temps qui s'écoule entre Ed dohor (une heure et demie) et le coucher du soleil, et qui varie par conséquent selon les saisons, les élèves quittent l'école ; ils ont congé le jeudi pendant toute la journée et reviennent le vendredi après la prière d'une heure. Il y a dans l'année plusieurs vacances, que l'on appelle Aouachir : 1° du 15 du mois de Ramadan au 8 du mois de Choual ; 2° du 1er du mois de Doul-Hidja au lendemain du Saba de l'Aid el Kebir, c'est-à-dire au 18 du même mois ; 3° du 1er du mois de Rabi-en-Nabaouï au lendemain du Saba el Miloud le 20 du même mois. Pendant ces vacances, les enfants vont tous les jours, le matin, à l'école, mais sans leurs planchettes et simplement pour réciter ce qu'ils ont déjà appris pour ne pas l'oublier. Pendant les sept jours compris entre les fêtes et leurs octaves, ils ne vont pas à l'école du tout. A la fête de El Achour, le 10 du mois de Moharrem, le premier mois de l'année, ils ont deux jours de congé, le jour de l'Achour et le lendemain. Les élèves étrangers couchent à l'école et y prennent leurs repas. Pendant les vacances, ils rentrent habituellement chez eux, à moins qu'ils ne viennent de très loin. Les tolba, c'est-à-dire tous ceux qui savent le Coran par coeur et qui ont en même temps quelques notions de lecture et d'écriture, forment dans chaque ville et dans chaque tribu une société, et ils ont un rudiment d'organisation administrative, d'ailleurs très simple. Dans les villes, ils ont un mokaddem (littéralement « celui qui marche devant »), qui prend l'initiative des réunions et représente les tolba devant les autorités. Dans les cérémonies, les réceptions de gouverneurs ou les fêtes religieuses, les tolba marchent en cortège, mokaddem en tête. Le titre de mokaddem des tolba est héréditaire tant qu'il y a des tolba dans la famille. Lorsqu'à la mort d'un mokaddem, aucun de ses fils n'est en état de lui succéder, son successeur est élu par les tolba, qui profitent de la circonstance pour faire des agapes. Les pouvoirs du mokaddem ne s'exercent sur les tolba que pour leur organisation d'ordre intérieur : obligation de payer une amende pour avoir enfreint certains usages dans une réunion, avoir manqué à une de ces réunions, etc. Le mokaddem des tolba, qui est en général un homme d'un certain âge et d'une certaine condition, est respecté par le Makhzen et généralement exempt d'impôts. Il jouit d'une certaine considération. Mais l'importance des tolba et de leur mokaddem se perd, comme toutes les vieilles institutions marocaines. Autrefois, lorsqu'un taleb était arrêté pour une raison quelconque, une cinquantaine de tolba avec le mokaddem allaient demander sa liberté au caïd, qui la refusait rarement. Aujourd'hui, le caïd, plus mendiant et plus avide que les tolba eux-mêmes, ne lâche le taleb que si on lui donne quelque argent. Dans la campagne, il y a également un mokaddem par chaque tribu. Dans les tribus des montagnes, l'organisation des tolba s'est mieux conservée que dans les villes et que dans les tribus de la plaine. Il s'y trouve également par chaque tribu un mokaddem, dont le titre est héréditaire clans cette famille tant que celle-ci produit des tolba capables de remplir ces fonctions. Le mokaddem de la tribu a au-dessous de lui trois ou quatre lieutenants, appelés les khalifas du mokaddem, dans les différentes fractions de la tribu. En outre, dans les écoles où il y a un grand nombre de tolba étrangers, ces tolba nomment eux-mêmes un mokaddem spécial pour trancher leurs différends et pour maintenir l’ordre dans l'école. Toutes les petites affaires qui surgissent entre les tolba sont réglées, soit par ce mokaddem spécial, soit par le mokaddem de la tribu ou par un de ses khalifas. Enseignement secondaire. — Sur le nombre considérable des enfants qui suivent les cours des écoles primaires, quelques-uns seulement continuent leurs études par l'enseignement secondaire. On peut dire que l'enseignement primaire constitue un véritable travail d'élimination pour les enfants. Il y a peu d'enfants qui n'aillent à l'école primaire pendant un certain temps. Quelques-uns ne lardent pas à y renoncer ; un grand nombre s'efforcent vainement pendant des années d'apprendre par coeur le livre sacré et n'y peuvent parvenir malgré les coups et les mauvais traitements. Le seul bénéfice qu'ils retirent de leur travail inutile est la perte de leur dignité et l'habitude de l'asservissement et de la crainte, qui les préparent admirablement à supporter jusqu'à la fin de leur vie l'arbitraire de leur gouvernement. D'autres arrivent à apprendre le Coran par coeur, mais ne poursuivent pas leurs études, soit parce qu'ils préfèrent continuer le métier de leurs-pères, comme agriculteurs, comme négociants ou comme fonctionnaires, soit que l'effort qu'ils ont fait ait été trop considérable et qu'ils soient incapables d'en fournir un nouveau ; le cas est assez fréquent. Une petite minorité, enfin, aborde les études de l'enseignement secondaire. Ces études consistent à apprendre la grammaire et la syntaxe, El Adjarroumiya et El Alfiya. Le premier de ces ouvrages est une grammaire en vers par Abou Abdallah Sidi Mohammed ben Daoud Es-Sanhadji, connu sous le nom de lbn Adjarroum, qui est mort en 1324. El Adjarroumiya est un ouvrage très concis, à tel point qu'il a besoin de commentaires. Le deuxième est un poème didactique sur la grammaire, en mille vers environ, qui a été l'objet de nombreux commentaires. Il a été composé par Djemal Ed-Din Sidi Mohammed lbn Malik El-Djayyani, né en 1203, à Damas, où il mourut en 1273. Les élèves étudient aussi lbn Achir (Abdelouhad ben Ahmed), qui est mort en 1040 de l'hégire à Fez. Son ouvrage, intitulé El-Mourchid El-Moin ala ed-Darouri min Oloum ed Din, « Le guide profitable sur ce qu'il est indispensable de savoir sur les sciences de la religion», se compose de 314 vers, nombre égal à celui des prophètes envoyés. Il traite des Kaouaïd El Islam, les bases fondamentales de la religion musulmane, qui sont au nombre de cinq : 1° la double profession de foi en Dieu et en le Prophète ; 2° la prière ; 3° l'impôt religieux ; 4° le jeûne ; 5° le pèlerinage, pour ceux à qui cela est possible. Cet ouvrage a été l’objet de plusieurs commentaires, dont les deux employés le plus fréquemment sont le petit et le grand commentaire de Mohammed el Fasi, dit El Miyara. Dans les études secondaires est également compris lbn Acim (Abou Bekr M'hammed ben Mohammed), né en 1359, mort en 1426. Il était cadi à Grenade. Son ouvrage est intitulé Et Touhfat El Houkarn fi Nakat el Ogoud ou El Hakam, « Cadeau offert aux magistrats sur les difficultés des actes et des jugements ». C'est un poème qui comprend 1697 vers et se divise en 104 chapitres. Beaucoup plus clair et plus aisé à comprendre que Sidi Khalil, dont la concision est telle qu'il est impossible d'en user pratiquement sans avoir recours à ses nombreux commentaires, l'ouvrage d'ibn Acim est pour ainsi dire un manuel de droit à l'usage de ceux qui ne recherchent pas la science juridique, mais un simple savoir pratique. lbn Acim a été l'objet de plusieurs commentaires ; le plus communément usité est celui d'Ali Et Tsouli, qui vivait sous le règne de Moulay Abderrahman, il y a une soixantaine d'années. Malheureusement, comme pour l'élude du Coran, les jeunes gens qui suivent l'enseignement secondaire se contentent le plus souvent d'apprendre les auteurs par coeur sans les comprendre. Les résultats de cette instruction sont forcément loin de développer les facultés des jeunes gens et de leur ouvrir les idées. Il semble, au contraire, que plus ils apprennent, plus leurs idées deviennent étroites et plus ils s'appliquent aux pratiques extérieures de leur religion qu'ils n'arrivent jamais à comprendre. On pourrait croire que le but de l'instruction qui leur est donnée est de tuer complètement chez eux tous les germes d'une pensée quelconque, d'une part, par un effort de mémoire absolument disproportionné, d'autre part par l'observance de pratiques matérielles qui finissent par absorber toute la vie d'un homme et la transforment en une série de petites cérémonies rituelles pour toutes ses actions les plus simples. C'est ainsi qu'en observant exactement les instructions de l'ouvrage de lbn Achir, qui indique la façon d'accomplir les fara'id, les obligations religieuses, on arrive à ce résultat, qu'on ne se lave pas pour être propre, mais pour s'être lavé d'une certaine façon. Le but recherché en se lavant n'est plus la propreté elle-même, mais simplement l'exécution stricte de certaines formules rituelles dans l'acte de se laver. L'esprit des pauvres étudiants arrive ainsi à être complètement faussé pour le reste de leur existence, et leur préoccupation d'éviter toute impureté et toute souillure matérielle finit par les transformer en maniaques incurables. A côté de cette manie de pureté, ils ont des moeurs très corrompues, qui ont été décrites dans Le Maroc Inconnu, de M. A. Mouliéras, d'une façon qui n'est pas exagérée. Les écoles d'enseignement secondaire se trouvent encore dans quelques villes et dans les tribus montagnardes de la région dite des Djebala, où, d'une part, l'instruction coranique est beaucoup plus répandue et plus suivie que dans les plaines, et où se trouvent en outre quelques écoles où les tolba peuvent étudier les auteurs que nous venons de citer. Sur la quantité des élèves qui suivent les cours secondaires, un grand nombre ne réussissent qu'à se garnir la mémoire sans grand profit ; quelques-uns cependant arrivent à acquérir, avec les explications de leurs professeurs, un savoir suffisant pour pouvoir devenir des adoul (notaires), quelquefois même des cadis de tribus ; mais ils ne sont jamais capables d'exercer les fonctions de cadi dans une ville. Ceux qui exercent cette dernière magistrature ont suivi les cours de l'enseignement supérieur à Fez. Il arrive quelquefois que, sans avoir suivi les cours de l'université de Fez, et après avoir reçu les leçons d'un professeur d'une science réelle, comme aujourd'hui encore le vieux fakih Ben Irmaq, dans la tribu des Soumatha, qui est un juriste remarquable, des tolba des Djebala arrivent à acquérir un savoir juridique assez étendu, qu'ils complètent eux-mêmes par de nombreuses lectures. Ils deviennent alors professeurs d'enseignement secondaire, sans être d'ailleurs nommés par personne, mais par la force des choses et parce que des élèves se réunissent autour d'eux. Les plus savants et les plus réputés de ces professeurs donnent également des consultations écrites (fetoua, au pluriel fetaoui) ; certaines de ces consultations font autorité, et leur réunion arrive à constituer une sorte de recueil de jurisprudence. La vie des étudiants de l'enseignement secondaire est réglée de la même façon que celle des classes de l'enseignement primaire, avec cette différence qu'ils travaillent assez souvent seuls pour apprendre par coeur les ouvrages qu'ils étudient. Comme nous l'avons dit, les tolba constituent une sorte de confrérie à laquelle appartiennent tous ceux qui sont arrivés à apprendre le Coran. Ces confréries se réunissent quelquefois pour faire des réjouissances que l'on appelle des nezaha. Il y a deux espèces de nezaha, la petite et la grande. La petite nezaha est simplement une réunion des tolba d'une ville ou de deux ou trois villages, qui ont amassé quelques sous et qui les mangent. La grande nezaha devient de plus en plus rare ; elle a lieu généralement au printemps. Quelques mois d'avance, en vue de cette fête, les tolna font des quêtes dans la ville ou dans la tribu. Ces quêtes n'ont d'ailleurs rien d'humble dans la forme et ressemblent plutôt à des réquisitions. Tous les gens riches sont imposés, soit d'une somme d'argent plus ou moins forte, soit de tant de moutons, d'un boeuf, de tant de beurre, etc. On n'ose pas refuser aux tolba, dans la crainte qu'ils n'appellent sur le récalcitrant la malédiction céleste, qui est naturellement à la disposition de gens qui savent le Coran par coeur. Ces mêmes gens, au contraire, lorsqu'ils ont reçu ce qu'ils demandent et qu'ils sont satisfaits, disent en faveur du donateur une Fatiha, qui sera également exaucée. Une fois tout ce qui est nécessaire à la nezaha réuni, les tolba empruntent les tentes, les plateaux, les réchauds, tapis, matelas, enfin tout ce qui est nécessaire, et fixent le jour de l'inauguration de la nezaha, où l'on boit, mange, et fait danser des jeunes garçons, fardés comme des filles. La nezaha dure tant qu'il y a de quoi boire et manger. Ces réjouissances sont dirigées par le mokaddem des tolba, qui maintient l'ordre et en imposant des amendes qui servent à prolonger la bombance. Autrefois, les tolba des villes nommaient de temps en temps un « sultan des tolba ». Cela donnait lieu à des réjouissances considérables ; mais cet usage est tombé en désuétude, et ce n'est plus qu'à Fez que la fête du sultan des tolba a lieu tous les ans. Les nezaha elles-mêmes deviennent de plus en plus rares ; la vie au Maroc est devenue trop dure, les besoins financiers du gouvernement et de ses fonctionnaires trop fréquents et trop pressants pour qu'on se permette de dépenser de l'argent à des réjouissances. La dernière grande nezaha a eu lieu à Larache en 1903 ; c'est celle dont parle Eugène Aubin dans Le Maroc d'aujourd'hui : « Pendant les derniers jours de notre séjour à Larache, dit-il, une ville de tentes est venue s'installer sur la falaise à proximité de notre campement. Elle grandit d'heure en heure, jusqu'à contenir tous les tolba du Khlot, au nombre de plus de cinq cents. Les jeunes étudiants, ayant quêté dans tout le pays, ont recueilli quelques centaines de douros et décidé de se réunir à Larache pour y célébrer une de leurs fêtes périodiques. Ils vivent dans une douce nonchalance, répartis dans leurs tentes, buvant du thé, mangeant les viandes débitées et cuites au milieu même du campement, et s'agitant quelquefois en vue d'une promenade collective au son d'une triste musette (ghaïta). » Enseignement supérieur. — L'enseignement supérieur était donné autrefois dans plusieurs villes. On en retrouve les traces dans les ruines des anciennes médersas (la forme arabe du pluriel de medersa est medures ; mais, selon l'usage adopté, nous francisons ce mot et écrivons au pluriel « des médersas », comme on a francisé « Coran », « cadi », etc.) abandonnées depuis longtemps. A El Kçar El Kebir, entre autres, sur la route de Tanger à Fez, on peut voir les ruines de deux médersas : celle de Djama El-Kebir, qui avait été bâtie au huitième siècle de l'hégire par le sultan mérinide Abou Inan, et dont il ne reste plus que la porte, aujourd'hui murée ; et celle de Djama Es-Saïda, construite il y a deux siècles environ et qui est également en ruine et abandonnée. Depuis déjà longtemps, l'enseignement supérieur ne se trouve plus qu'à Fez, où il est loin de briller de son ancien éclat. Ce que l'on appelle souvent l'université de Fez se réduit en somme à bien peu de chose aujourd'hui, et c'est cependant le seul centre intellectuel encore un peu vivant du Maroc. Il est difficile d'y retrouver la trace de ce qu'a dû être le mouvement intellectuel sous les Almoravides et surtout sous les Almohades. Des neuf médersas qui sont encore debout, cinq seulement sont encore utilisées pour les étudiants. Ce sont les médersas de Ras Ech Cherratin, d'Eç Cefarin, d'El Meçbahia, d'El Attarin, et de Bab El Djisa. Trois autres médersas, Eç Cahridj, Es Sba'in, et Bou 'Inania, sont désaffectées. La médersa El Oued est transformée en mosquée. Ces neuf médersas sont celles de Fès El Bali (Fez le Vieux) ; il existait également deux médersas à Fès El Djedid (le Nouveau Fez), où se trouve le palais du sultan, mais il n'en reste qu'une, celle de Moulay Abdallah. Une médersa n'est pas un collège à proprement parler, puisqu'il ne s'y fait pas de cours ; c'est un grand bâtiment construit généralement par un sultan qui en fait don aux habous, c'est-à-dire aux biens de mosquée, et à l'entretien duquel sont attribués des revenus provenant également de donations pieuses. Les étudiants y ont seulement leur logement. Dans l'origine, les administrateurs des biens de mosquées, les nadirs, logeaient les étudiants étrangers qui venaient à Fez dans les chambres des médersas, sans aucun loyer, bien entendu, et leur donnaient à chacun deux pains par jour ; les pains étaient payés par les revenus de maisons données aux habous à cet effet. On les gardait ainsi trois ans, durant lesquels ils suivaient les cours. Au bout de ces trois ans, les professeurs leur faisaient subir un examen, et renvoyaient ceux qui étaient reconnus comme incapables. Les autres étaient conservés pendant sept ans encore. Au bout de ces dix années, on leur supprimait la distribution du pain. Ils étaient censés avoir terminé leurs études. Aujourd'hui, il n'y a plus d'examen, et les étudiants peuvent rester dans les médersas tant que bon leur semble ; il y en a quelques-uns qui y sont depuis plus de trente ans. La distribution des pains se fait toujours, mais elle n'est plus calculée d'après le nombre des étudiants ; on fait tous les jours quatre cents pains, qui sont partagés entre les cinq médersas. Lorsqu'il y a peu d'étudiants, ils ont à tour de rôle deux pains par jour, et lorsqu'il y en a beaucoup c'est à tour de rôle également qu'ils passent une journée sans en recevoir. La propriété de toutes les chambres est vendue ; il est difficile de retrouver l'origine de ces ventes, qui n'ont rien de régulier, mais qui constituent un fait contre lequel personne ne proteste. Il est probable qu'elles doivent remonter à l'époque déjà reculée où la vente de la clef, c'est-à-dire à proprement parler de la jouissance des biens habous en général, a été tolérée. De même que pour les autres biens habous, la propriété de la médersa reste aux habous ; ce n'est que la jouissance, autrement dit la clef, de chaque chambre qui a été reconnue comme appartenant à une certaine époque à un des occupants sous prétexte de dépenses par lui faites dans cette chambre, et qu'il cède lui-même moyennant une certaine somme d'argent. Le droit de propriété des habous sur la médersa elle-même est établi par ce fait que ce sont les habous qui v font les réparations. Les tolba qui ne sont pas propriétaires d'une chambre dans une médersa, et ils sont nombreux, sont reçus par un taleb de leur pays qu'ils connaissent et qui y possède une chambre. Les chambres des médersas ne se louent jamais. Chaque médersa a un mokaddem qui est nommé par les tolba, et qui, généralement, n'est pas taleb lui même. Le mokaddem est une sorte de concierge de la médersa ; il dépend exclusivement des tolba, qui le renvoient à leur gré ; il est logé dans la médersa dans une chambre près de la porte, et ne peut pas être marié ; il touche des gages d'environ deux douros par mois, qui sont payés par des habous des médersas. Les obligations du mokaddem consistent à balayer la médersa, à entretenir et à allumer les lampes, et à distribuer le pain aux tolba ; il connaît le nombre de tolba qui se trouvent à la médersa et la proportion dans laquelle ils sont répartis dans les chambres ; à la porte de chaque chambre se trouve une fente par laquelle le mokaddem jette, sans ouvrir la porte, le nombre de pains correspondant au nombre de tolba qui habitent la chambre. Le mokaddem n'est pas chargé de faire les chambres des tolba ; ce sont eux-mêmes qui prennent ce soin, qui est d'ailleurs peu de chose, étant donné la simplicité du mobilier, composé généralement d'une natte et de quelques livres. En résumé, la médersa est une simple hôtellerie avec une cour au milieu, une grande pièce appelée koubba au rez-de-chaussée, qui sert de mosquée et où les étudiants logés dans la médersa se réunissent pour faire les prières ; de plus, un m'taher, chambre pour les ablutions, avec une fontaine. Un des étudiants de la médersa est choisi comme mueddin pour appeler à la prière, quoiqu'il n'y ait pas de minaret aux médersas. Ce mueddin fait l'appel à la prière du haut de la terrasse. Les prières dans les médersas sont dirigées par un imam choisi par le cadi et payé, par les habous, deux ou trois douros par mois. Les médersas ne servent à loger que les étudiants étrangers ; les étudiants de Fez habitent dans leurs familles. Deux pains par jour, et dont la dimension a beaucoup diminué, ne suffiraient pas à la nourriture des étudiants ; la plupart ont un peu d'argent, et leur famille leur envoie de temps en temps des provisions, couscous, beurre, huile, etc. Ceux qui n'ont pas d'argent vivent un peu sur les ressources des autres, et sont également nourris par charité par des gens riches de Fez, qui considèrent comme une bonne oeuvre de nourrir un étudiant ou même plusieurs. Dans ce cas, l'étudiant va le soir frapper à la porte de la maison où il sait qu'on doit lui donner quelque chose, et une négresse lui remet un plat qu'il emporte et qu'il rapporte vide le lendemain soir, car on ne donne jamais qu'un seul repas, celui du soir. Dans la journée, l'étudiant s'arrange avec le pain sec des habous. L'enseignement est donné aux pensionnaires des médersas à la mosquée de Karaouiin, la grande mosquée de Fez, dont la construction, commencée en l'an 245 de l'hégire (859 de l'ère chrétienne), fut achevée en l'an 306. De nombreuses réparations et de nombreux agrandissements ont été faits depuis à cette mosquée. Autrefois, l'enseignement supérieur relevait du cadi exclusivement ; celui-ci était comme le grand-maître de cette université. C'était lui qui nommait les professeurs ou ouléma (au singulier alem). Aujourd'hui, les professeurs sont nommés par le cadi, mais sur l'ordre du Makhzen ; il en est ainsi depuis le règne de Moulay El Hasan, qui avait cherché à centraliser toutes les institutions sous son autorité. Avant d'être nommé professeur, il faut faire un stage qui est plus ou moins long, selon les influences dont on dispose. Le candidat se fait d'abord donner par ses anciens professeurs ce que l'on appelle une idjaza, qui est une sorte de diplôme, indiquant le genre d'études qui ont été faites par le postulant d'une façon complète et satisfaisante. Pourvu de cette idjaza, le nouveau professeur se rend à Karaouiin et commence à enseigner sans recevoir d'appointements. Il ne porte pas encore le titre d'alem. mais simplement celui de fakih. Les ouléma professaient eux-mêmes gratuitement il y a plusieurs siècles, et faisaient pour vivre quelque travail délicat, comme des copies de manuscrits, ou des broderies de soie. Il n'en est plus ainsi depuis longtemps. La plupart des professeurs stagiaires, tant qu'ils ne sont pas payés, donnent des leçons particulières dans une petite mosquée retirée. Le salaire de ces leçons est très peu élevé. Pour être nommé professeur en titre, le stagiaire doit recueillir le témoignage des autres professeurs attestant que son cours est suivi et qu'il y a lieu de le pourvoir d'une chaire. C'est ensuite au candidat à user des influences dont il dispose à la cour pour obtenir du sultan la lettre adressée au cadi et le nommant professeur. Il y a cinq classes d'ouléma. On débute par la cinquième pour continuer en passant par toutes les classes sans pouvoir en sauter. Cependant, si un fakih d'une haute valeur et n'ayant pas habité Fez jusque-là venait s'y établir pour y professer, il pourrait être nommé directement alem de première classe. Les appointements des professeurs sont très médiocres : ils commencent à 15 onces par mois, ce qui représente environ 0, 54 centimes, pour arriver au maximum à 200 mitqals, qui représentent 71 pesetas 50. Ces appointements sont calculés sur l'ancienne valeur de la monnaie marocaine basée sur le milqal or ; mais celui-ci a été fondu et vendu depuis longtemps, et il est remplacé aujourd'hui par un mitqal argent, de telle sorte que, tandis qu'un demi-mitqal or (5 onces) valait autrefois un douro (5 pesetas), la valeur d'un douro est représentée aujourd'hui par 14 mitqals argent (140 onces). Les professeurs ne pourraient donc pas vivre avec leurs appointements, surtout ceux des classes inférieures, si, outre ces appointements tout à fait dérisoires, ils ne recevaient pas ce qu'on appelle la sila, c'est-à-dire une distribution de blé et d'argent, dans les proportions suivantes : Les ouléma de 1re classe reçoivent, par an et par tête, 90 moudds de blé, mesure de Fez (le moudd de Fez contient environ 30 litres) ; les ouléma de 2e classe, b0 moudds ; ceux de 3e classe, 45 ; ceux de 4e classe, 30 ; ceux de 5° classe, 15 moudds. Ce blé est remis, pour les deux tiers, au commencement de l'automne, pour le troisième tiers vers la fin de l'hiver. Le Makhzen leur donne de plus, par an et par tête, à la fin de l'été, l'argent nécessaire pour acheter un taureau, dont ils font une sorte de « confit de viande » que l'on appelle le khl'i. Ce confit est conservé dans des jarres en terre fermées, et se mange en hiver avec des oeufs ou du couscous. On leur donne également le prix de deux qollas d'huile (la qolla de Fez pèse 12 livres de 750 grammes), qui sert à faire le confit. Le Makhzen donne de plus par an à chaque professeur un costume complet, de la coiffure aux babouches. A chacune des trois grandes fêtes, les professeurs reçoivent en outre une petite somme d'argent : 1re classe, 4 douros ; 2° classe, 3 douros ; 3° classe, 2 douros ; 4e classe, 1 douro ; 5e classe, un demi-douro. Il y avait autrefois également une sila (distribution d'argent) faite aux étudiants des médersas et qui s'élevait environ à 100 douros par médersa ; cette sila est supprimée depuis près de dix ans. Les professeurs sont logés dans des maisons appartenant aux biens habous. A la mort d'un professeur, on en fait sortir ses enfants et sa veuve, à moins qu'un de ses fils ne soit rai-même taleb, susceptible de succéder à son père, et surtout qu'il n'ait des relations à la cour. Il n'y a pas de pensions de retraite pour les professeurs : les appointements, silas, maisons, leur sont conservés jusqu'à leur mort, même s'ils sont incapables de professer pendant plusieurs années. D'autre part, leurs veuves n'ont droit absolument à rien. Les ouléma augmentent leurs revenus, non seulement en donnant des leçons particulières aux étudiants, mais en donnant des consultations juridiques écrites, fetaouï. Ces consultations, selon l'importance de leur objet, se paient de un à cent douros, et certains ouléma se font ainsi un important revenu. Les cours, à la grande mosquée de Karaouiin, commencent à 6 heures du matin ; il y en a cinq successifs dans la journée : de 6 à 8 heures ; de 8 à 10 heures ; de 10 heures à midi ; de midi à 1 heure et demie ; et de 2 heures à l'acer. Après l'acer, il n'y a plus de cours ; mais il reste quelquefois des professeurs isolés qui font de petits cours particuliers à des étudiants. Pendant les trois premières séances, de 6 heures à midi, les professeurs, au nombre de cinq ou six, enseignent le droit, fik'h, c'est-à-dire les auteurs suivants : Sidi Khalil et ses principaux commentaires ; El Kharchi, Bennani, Zourkani, et leurs commentateurs ; Touhfa de Ibn Acim et ses commentaires ; Et Taoudi ben Souda, Et-Tsouli, Myara ; la Larnya de Zaqqaq et ses commentateurs ; Et Taoudi, Abou Hafç, Myara ; lbn Achir et le commentaire de Myara. De midi à l'acer, plusieurs cours sont faits en même temps, et les étudiants suivent ceux qui leur conviennent ; ce sont : la Grammaire, Nahoû ; comme auteurs : El Adjarrounya avec le commentaire d'El Azhari et ses commentaires ; El A'fya d'Ibn Malik, avec le commentaire d'El Makoudi ; — la rhétorique, El Bayan ; comme auteurs : le Moukhtaçar (Résumé) de Sa'd Et Din Et Taftazani, et ses commentaires ; — la logique, El Mantiq ; comme auteurs El Akhdari et ses commentateurs ; Bennani et ses commentateurs ; — la prosodie, 'Aroud (rarement), auteur : Zemmoury, commentaire de la Khazradjia ; — la métaphysique, Kalam (très rarement) ; auteur • Es Senousi ; —le çoulisme, Taçaououf : ne s'enseigne pour ainsi dire plus ; quelquefois cependant un professeur fait une lecture expliquée du commentaire d'Ibn Ata Allah de l'ouvrage Ala 'lHikâm d'Ibn Abbad ; — la lexicographie, Lougha : ne s'enseigne plus à Karaouiin depuis longtemps ; quelques étudiants lisent le Qamous d'Ed Djauhari, la Makarna d'El Hariri et la Makçouna d'El Makoudi: — la théologie, Tauhid : le chérit Sidi Mohammed ben El Kebir El Kittani, celui qui a provoqué en 1908 la révolution à Fez contre le Sultan Abdelaziz et que le Sultan actuel Moulay Abdelhafid a fait mourir en 1909 sous le bâton, avait commencé il y a quelques années à Karaouiin la lecture des Chamaïl, du Termidi, mais il y a bientôt renoncé, ne trouvant pas d'auditeurs. En commençant le droit avec l'ouvrage d'Ibn Achir, qui comprend : 1° le Tauhid (la théologie) ; 2° le Fik'h(le droit), les étudiants s'occupent forcément de théologie ; ils lisent en même temps quelques ouvrages spéciaux tels que la Risala d'Ibn Abi Zeid El Kairaouani, la Çoughra de Senousi, etc. L'arithmétique, El Hisâb, est enseignée le jeudi et le vendredi matin et pendant les vacances ; auteurs : El Qalçadi, El Mounia, de Ben Razy, et Ed Dourra. L'histoire n'a jamais été enseignée, et la géographie ne l'est plus depuis bien longtemps. Les professeurs font leur cours de la façon la plus simple. Ils ont chacun une place désignée dans la mosquée de Karaouiin. Le professeur va s'asseoir à sa place, à l'heure de son cours, sur un petit tapis de feutre appelé El Lebda, qu'il porte plié sous le bras et qu'il étale sur la natte de la mosquée ; les étudiants s'asseoient en demi-cercle devant lui. Le professeur n'a pas en mains le livre qu'on étudie, mais ce livre est tenu par un des élèves les plus instruits, qui lit une phrase que le professeur explique et commente ; ce lecteur s'appelle El Kâri ; chaque étudiant a son livre pour suivre le cours. Quoique les professeurs s'asseoient ainsi au niveau de leurs élèves, il y a cependant à Karaouiin des chaires pour faire les cours. Une chaire s'appelle EL Koursi (au pluriel El Krasi). Il y en a douze à Karaouiin : six pour les professeurs et six pour les lecteurs des Hadit (traditions du Prophète). Le koursi est formé de trois marches avec une plate-forme pour s'asseoir, les jambes repliées. Les krasi des professeurs ont un dossier élevé que n'ont pas les krasi des lecteurs de Hadit. Les professeurs de première catégorie, que l'on appelle les oulama el kebir (les grands ouléma), ont seuls le droit de monter en chaire, et ils en usent rarement et seulement lorsqu'ils ont un grand nombre d'élèves, qui les oblige à s'élever pour dominer leur auditoire. Les lecteurs de Hadit montent toujours sur le koursi. Pendant les trois mois saints : Redjeb, Chaaban et Ramadan, les cours habituels sont remplacés par des lectures des Hadit à la mosquée de Karaouiin, pendant toute la journée, depuis le matin jusqu'à l'àcha (une heure et demie après le coucher du soleil). Dans les autres mosquées, ces lectures ont lieu également depuis le moghrîb (coucher du soleil) jusqu'à l'âcha. Pendant le mois de Safar, deuxième mois de l'année, le cadi de Fez, lui-même, interprète la Hamzya du Bouciri (louanges et glorification du Prophète) à la grande mosquée de Karaouiin. Il s'asseoit pour cela sur le koursi qui est en face de la grande porte de la mosquée : les lustres de la mosquée sont allumés, et la chaire elle-même entourée d'un grand nombre de lanternes et de bougies. Les vacances et les congés des cours de l'enseignement supérieur sont les mêmes que ceux de l'enseignement primaire. Le jeudi ou le vendredi il n'y a pas de cours à proprement parler, mais une petite conférence le malin. Il y a environ trois semaines de vacances, à chaque grande fête, Aïd el Kebir, Aïd eç Çaghir, El Mouloud, et trois jours de congé à l'Achour ; de même pour les trois derniers jours du mois de Chaaban. Les étudiants font alors avec tout le monde ce que l'on appelle la Chaabana, c'est-à-dire un repas, en général dans un jardin, avec de la musique et toutes les réjouissances, pour se préparer au jeûne du Ramadan, qui suit le mois de Chaaban. Il y a congé également le jour de l'Ancera, qui est le 24 juin de l'année julienne, et où les musulmans allument des feux comme nos feux de la Saint-Jean, qui est également le 24 juin, mais de l'année grégorienne, de sorte que les deux fêtes ne correspondent plus, quoique ayant nominalement la même date. Dans le cas de décès d'un professeur, il y a trois jours de congé. S'il s'agit de la mort d'un professeur de la première catégorie, d'un alem el kebir, le congé dure sept jours. Lorsque le sultan meurt, les cours sont suspendus jusqu'à la proclamation de son successeur. Enfin, lors des fêtes du sultan des tolba, qui ont lieu généralement au mois d'avril, il y a encore un mois de vacances. Tous les ans, les étudiants nomment un sultan des tolba. On fait remonter l'origine de cette coutume à Moulay Er Rechid, c'est-à-dire au commencement de la dynastie actuelle, à la fin du dix-septième siècle. En principe, l'étudiant désigné comme sultan devrait être le plus instruit et le plus capable ; mais, comme toutes les choses marocaines, le trône des tolba est aujourd'hui mis aux enchères et est généralement acheté par un étudiant qui a quelque faveur à demander au vrai Sultan, le plus souvent l'élargissement d'un membre de sa famille emprisonné, et qui veut profiler de sa royauté éphémère pour l'obtenir. Le prix d'achat du sultanat des tolba n'est d'ailleurs pas très élevé et varie entre cent et cent cinquante douros. Tous les habitants de Fez contribuent par des dons à cette fête. Le Sultan lui-même envoie à son collègue de quelques jours tous les accessoires de la royauté, parasol, cheval, tente, escorte, etc., une petite somme d'argent de 500 mitkals (environ 200 pesetas), et des provisions de bouche. Il se rend lui-même au campement des tolba, qui est établi hors de la ville sur l'Oued Fès, non loin du palais. Le sultan des tolba profite de cette rencontre pour remettre sa supplique au véritable souverain. La fête des tolba dure entre huit et quinze jours, qui se passent en bombances. A la fin de son règne de quelques jours, le sultan des tolba s'enfuit et va se réfugier dans sa médersa pour échapper aux plaisanteries de ses anciens sujets, qui lui rappelleraient lourdement la vanité de son autorité disparue. Résumé. — En résumé, l'instruction musulmane au Maroc est exclusivement religieuse en ce qui concerne l'enseignement primaire. Quelques notions de grammaire et de droit sont données dans l'enseignement secondaire. Ces mêmes notions sont reprises et développées dans l'enseignement supérieur, avec quelques rares notions de belles-lettres et de théologie. On peut se rendre compte aisément, en examinant les programmes de cet enseignement, et la mentalité qui préside à la façon dont il est donné, que l'instruction marocaine est loin d'avoir pour but l'émancipation de l'esprit et de l'intelligence. Elle cherche au contraire à les asservir et à les maintenir cristallisés par des traditions surannées et par des pratiques minutieuses auxquelles le sentiment religieux lui-même est complètement étranger. C'est ainsi que tout ce qui touche à l'instruction publique marocaine semble avoir pour mission de maintenir le peuple dans l'abrutissement et dans la servitude, en interprétant à faux les principes d'une religion qui devait établir les bases de la communauté musulmane et qui ne sert qu'à maintenir la plus insupportable tyrannie. Il est presque inutile de parler de l'instruction des femmes : elle est pour ainsi dire nulle, et les quelques petites filles auxquelles on apprend à lire et à écrire sont des exceptions des plus rares De plus, les femmes instruites sont mal vues, et les Marocains prétendent qu'une jeune fille instruite tourne généralement mal. A vrai dire, l'homme trouve dans l'ignorance absolue de la femme un moyen commode d'affirmer sa supériorité et sa domination sur elle, et de la maintenir dans un état d'abaissement, et souvent de dégradation, qui est certainement une des principales causes de la décomposition de la société marocaine, qui se meurt d'ignorance et d'abus d'autorité. II — Enseignement israélite indigène. Cet enseignement ressemble beaucoup à l'enseignement musulman, en ce sens qu'il est essentiellement religieux et obstructionniste. On peut également le partager en enseignement primaire, secondaire et supérieur. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — Il n'y a d'écoles que dans les villes, et le local se compose généralement d'une simple chambre dans le logement du professeur. Le maître d'école primaire, appelé rabbi (au pluriel rabisim), est payé par la communauté israélite de la ville. Ses appointements ne dépassent guère soixante pesetas par mois ; les élèves lui donnent également une petite somme mensuelle variant, selon leur état de fortune, de une à cinq pesetas. Dans les villes de l'intérieur, le mobilier scolaire est le même que celui des écoles musulmanes, c'est-à-dire qu'il se compose d'une natte sur laquelle s'asseoient le maître et les élèves ; la baguette joue également un grand rôle dans les procédés scolaires. Dans les ports, et à Tanger particulièrement, on trouve dans les écoles rabbiniques des bancs ou des chaises ; mais, d'autre part, ces écoles deviennent de plus en plus rares et ne tarderont pas à disparaître devant celles de l'Alliance israélite et devant les autres établissements d'enseignement. L'école primaire israélite porte le nom de Talmud Tora. Les enfants commencent par y apprendre l'alphabet, puis on les fait épeler. On leur enseigne ensuite la Perasa, c'est-à-dire le commencement de la Bible, puis les Nebiim et les Kitoubim, c'est-à-dire les Prophètes et la Loi écrite. L'enseignement primaire s'arrête là, et ceux qui ne poussent pas leurs études plus loin ont quelques vagues notions de l'histoire juive ; ils connaissent l'alphabet hébreu, mais ne savent pas l'hébreu. Ils parlent, selon les localités, espagnol ou arabe : espagnol dans les ports en général, et jusqu'à El Kçar el Kebir ; dans les autres villes de l'intérieur, uniquement arabe avec un accent très reconnaissable. Leur alphabet hébreu leur sert à écrire en caractères hébreux et en langue espagnole ou arabe, selon la langue qu'ils parlent. Il n'est pas besoin de dire que la correspondance ainsi rédigée dans une langue imparfaitement apprise et uniquement dans sa forme la plus vulgaire, à l'aide des caractères d'une autre langue, n'a rien de littéraire. De même que chez les musulmans, les petites filles, chez les Israélites, ne vont pas à l'école, et la très grande majorité des femmes juives ne savent ni lire ni écrire. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Il consiste dans l'étude de la Guemara, qui est le développement de la Michna, recueil des lois orales, des traditions, des règlements et des discussions des sanhédrins. La Michna et la Guemara réunies composent le Talmud de Babylone, formé des soixante-trois traités de la Michna, dont trente-sept ont leur Guemara. Ces soixante-trois traités sont partagés en six divisions. L'enseignement secondaire se borne exclusivement à l'étude de la Guemara ; cette étude comporte l'obligation pour les élèves de compléter et d'approfondir celle de la langue hébraïque, qu'ils avaient commencée a l'école primaire. La plupart des élèves qui suivent les cours de renseignement secondaire passent ensuite à l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire ne les conduit en effet à rien et n'est qu'une préparation à des études complémentaires, qui permettent à ceux qui les ont faites d'aspirer aux fonctions sacerdotales. Le seul poste auquel puissent arriver les élèves de l'enseignement secondaire qui ne poussent pas leurs études plus loin est celui de maître d'école primaire. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. — Les jeunes gens qui ont suivi pendant un certain temps les cours de l'enseignement secondaire et qui connaissent suffisamment le Talmud et particulièrement sa seconde partie, la Guemara, sont admis à suivre les cours de l'enseignement supérieur. Ces cours sont exclusivement talmudiques. Les élèves assistent à des cours qui ne sont pas autre chose que des réunions de rabbins, présidées par le grand-rabbin, et où les différents articles du Talmud sont discutés, commentés et interprétés. Ce sont de véritables cours de casuistique qui, loin d'ouvrir l'intelligence des élèves, la restreignent au contraire par l'étude de cas de conscience et lui donnent cette déformation spéciale que l'on remarque également chez les docteurs musulmans. Lorsque les élèves ont une connaissance suffisante du Talmud et de ses commentaires, et qu'ils ont appris à en interpréter le texte de façon à pouvoir l'appliquer aux différents cas qui peuvent se présenter, ils peuvent être nommés rabbins, ou notaires, Sofrim, ou sacrificateurs, Souhatim. Les trois degrés de l'enseignement hébraïque se trouvent dans la plupart des villes, mais les cours d'enseignement supérieur de Tétouan, de Fez et de Marrakech sont les plus importants et les plus suivis. Il y a également un cours d'enseignement supérieur à Tanger, mais les études rabbiniques, qui commencent à être négligées un peu partout, le sont plus particulièrement dans cette ville et dans tous les ports. Malgré la résistance des rabbins, les écoles de l'Alliance Israélite ont attiré à elles la majeure partie des enfants juifs et ont créé dans la vieille immobilité des mellahs(nom donné au quartier israélite) un courant d'idées de civilisation qui augmente d'intensité tous les jours. III. — Enseignement étranger. Enseignement français. — ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE. — La première tentative de l'Alliance israélite au Maroc date de 1862, et la première école fondée a été celle de Tétouan. Après quelques difficultés suscitées par les rabbins, qui voyaient avec déplaisir l'élément européen, c'est-à-dire l'élément d'émancipation, pénétrer dans la communauté dont ils étaient jusque-là les maîtres incontestés et quelque peu tyranniques, la nouvelle institution progressa, s'agrandit, et elle compte aujourd'hui près de 800 élèves garçons. En 1868, une école de filles était ajoutée à celle des garçons ; elle compte aujourd'hui plus de 300 élèves. En 1865, l'Alliance fondait l'école de Tanger, qui compte aujourd'hui plus de 300 élèves. Une école de filles fondée en 1874 compte aujourd'hui plus de 400 élèves. En 1883, M. Salomon Benoliel était chargé de fonder à Fez une école de l'Alliance israélite. Les difficultés qu'il eut à surmonter furent considérables. Les rabbins de Fez, qui constituaient une véritable puissance, d'accord avec les autorités marocaines, firent tous leurs efforts pour empêcher ce qu'ils considéraient comme une tentative de pénétration d'idées européennes et une menace d'émancipation de la population juive de Fez, maintenue jusque-là dans un état d'ignorance et d'abaissement qui la rendait d'une exploitation facile. L'oeuvre de l'Alliance israélite à Fez était considérée comme une oeuvre absolument révolutionnaire et condamnable. A force d'abnégation et de patience, l'école fut cependant fondée, et la communauté israélite, sentant vaguement dans cette institution un instrument de délivrance, se décida, après bien des hésitations, causées par la crainte, à l'appuyer et même à lui fournir un local. Mais le sentiment réactionnaire de la population juive de Fez se manifeste encore par ce fait, qu'avec une population de plus de 10 000 habitants, supérieure à celle des Israélites de Tanger et de Tétouan, le mellah de Fez n'envoie encore aujourd'hui à l'école de l'Alliance que 200 élèves environ. Une école de filles a été fondée à Fez en 1899 ; elle a jusqu'à présent moins de 100 élèves. En 1893, le comte d'Aubigny, ministre de France, en ambassade à Fez, avait obtenu du sultan Moulay El Hassan un terrain permettant de construire pour l'Alliance israélite une école plus vaste et plus saine que l'école actuelle. Les circonstances n'ont pas encore permis d'utiliser cette concession. L'école de Mogador a été fondée en 1888 ; elle compte aujourd'hui près de 300 élèves. Cette école se trouve dans la ville et non pas au mellah. Une autre école a été fondée en 1906 dans le quartier juif. Cette école, très fréquentée, puisqu'elle compte près de 400 élèves, semble devoir son succès à ce fait que l’enseignement hébraïque y est donné à peu près seul, et qu'elle se rapproche plus d'une école de Talmud-Tora que d'une école européenne. Pas d'école de filles. L'école de Casablanca a été fondée en 1897 ; elle compte environ 250 élèves. L'école de filles a été créée en 1900 et en compte environ 150. En 1901, une école de l'Alliance israélite était fondée à Marrakech ; elle comprend une école de garçons et une école de filles. De même qu'à Fez, on éprouve à Marrakech quelque hésitation à accepter les idées nouvelles apportées par les professeurs de l'Alliance, malgré toute la prudence qu'ils mettent à les exprimer. En effet, avec une population de plus de 15 000 Juifs, l'école de garçons ne compte guère que 300 élèves et celle des filles une centaine. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que l'émancipation intellectuelle ne peut être réellement profitable que lorsqu'elle est accompagnée de certaines garanties d'existence matérielle. A quoi serviraient aux Juifs de Fez et de Marrakech, et à plus forte raison à ceux de Demnat et de Taroudant, des aspirations d'indépendance et de dignité que leur situation actuelle rend impraticables ? Incapables, dans le milieu où ils se trouvent, de les réaliser par leurs propres moyens, ils souffriraient encore davantage de l'état d'intériorité dans lequel ils sont impitoyablement maintenus, parce qu'ils s'en apercevraient mieux. L'expatriation, ou tout au moins l'exode vers les villes de la côte marocaine, est jusqu'à présent le seul remède qui soit à la disposition des Juifs de l'intérieur du Maroc pour échapper à leur état d'asservissement. Il semble donc qu'il serait pour ainsi dire plus humain de n'ouvrir leur intelligence aux bienfaits de la civilisation qu'à la condition de leur donner en même temps les garanties sociales dont le défaut est incompatible avec un certain savoir et une certaine intellectualité. La même année 1901, une école de l'Alliance israélite était également créée à Larache, comprenant une école de garçons avec plus de 100 élèves et une école de filles avec une centaine environ. En 1903, une école était fondée à Rabat: elle compte aujourd'hui plus de 80 élèves. Pas d'école de filles. En 1906 était créée l'école de Mazagan : garçons, 150 ; filles, une centaine. Une nouvelle école de filles et de garçons a été ouverte il y a peu de temps à Safi, de telle sorte qu'il se trouve actuellement des écoles de l'Alliance israélite dans tous les ports marocains, sauf dans le petit port d'Arzila, qui n'est pas ouvert au commerce. Une tentative faite pour ouvrir une école à Mékinès a échoué. Il y avait une école de l'Alliance israélite à El Kçar el Kebir il y a une vingtaine d'années ; elle a été supprimée au bout de quelques années. Les écoles de l'Alliance israélite donnent une instruction primaire plus ou moins poussée suivant les localités ; elles comportent, selon leur importance, de sept à quatre classes. On y enseigne l'histoire, la géographie, l'arithmétique, quelques notions de littérature, de physique et de chimie. Les cours sont faits en français. Dans toutes les écoles il y a des rabbins qui enseignent l'hébreu et donnent aux élèves l'instruction religieuse. L'anglais et l'espagnol sont également enseignés dans certaines écoles. Ces deux langues peuvent, en effet, être très utiles au Maroc, la première étant donné les relations commerciales considérables avec l'Angleterre, la deuxième parce que c'est la langue usitée par tous les Israélites du Nord marocain. On peut estimer à 150000 francs les dépenses annuelles occasionnées par l'entretien des écoles de l'Alliance israélite actuellement existantes au Maroc. La moitié de cette somme environ est supportée par l'Alliance israélite ; l'autre moitié est couverte tant par des subventions locales que par les mensualités payées par la majorité des élèves. L'Alliance israélite est placée au Maroc sous la protection de la légation de France, ainsi que tout son personnel. Les professeurs envoyés par l'Alliance sortent de l'Ecole normale de l'Alliance israélite à Auteuil. ALLIANCE FRANÇAISE (Ecoles franco-arabes). — L'Alliance française, fondée en 1883, a fait dès 1884, à Tanger, une tentative de constitution de comité à laquelle il n'a pas été donné suite. Ce n'est qu'en 1898 qu'un délégué de l'Alliance a été nommé et un comité régional constitué à Tanger. Ce comité, d'accord avec la légation de France, a participé au développement d'un embryon d'école arabe qui avait été peu auparavant créé à Tanger par un fonctionnaire algérien de la légation de France. Cette école franco-arabe existe encore ; elle est fréquentée exclusivement par des enfants musulmans, au nombre d'une soixantaine environ, auxquels, outre le Coran et la grammaire arabe, on enseigne le français, l'histoire, la géographie, et l'arithmétique, conformément à la méthode employée dans les écoles indigènes d'Algérie. L'école franco-arabe de Tanger a trois professeurs, plus un fakih pour le Coran. Quelques anciens élèves de cette école sont allés suivre les cours de la médersa de Tlemcen et ceux de la Faculté de médecine d'Alger. En 1899, la délégation de l'Alliance française au Maroc fondait une école à El Kçar el Kebir, à une centaine de kilomètres dans l'intérieur du pays, sur la route de Fez. Cette école a été fermée en 1904 lors de la suppression de la délégation de Tanger, fondue avec le comité régional de Tanger qui devait, d'accord avec le comité du Maroc, sous la haute direction de la légation de France, reprendre sur de nouvelles bases l'organisation d'établissements scolaires : écoles françaises et écoles franco-arabes. L'école d'El Kçar n'avait jamais eu que quelques élèves juifs, et les résultats de cette tentative avaient été assez médiocres. En 1899 également, la délégation de Tanger avait fondé à Fez même un embryon d'école franco-arabe. Un petit comité local avait été créé et quelques souscriptions furent recueillies, qui avaient permis d'organiser une salle de classe dans une pièce de la maison où se trouvait la poste française. L'Algérien chargé de la poste donnait quelques leçons le soir. C'était peu de chose, mais la tentative paraisssait d'autant plus intéressante que le cours improvisé de français était exclusivement suivi par des adultes musulmans qui témoignaient d'un véritable désir de s'instruire. Dès le commencement de 1900, les nécessités de la politique du moment, qui n'en était pas encore à la pénétration pacifique, firent fermer la petite école de Fez. Cette école fut rouverte en 1906 ; les cours étaient faits comme la première fois par l'Algérien chargé de la poste et fréquentés uniquement par des musulmans. Les résultats auraient été peut-être satisfaisants et eussent pu autoriser une subvention plus importante que celle de 50 francs par mois accordée par le comité de l'Alliance française de Tanger ; mais les événements de Casablanca obligèrent à fermer encore une fois l'école. Une nouvelle tentative a été faite depuis, et un professeur algérien va incessamment, sous les auspices de la légation de France, essayer de créer à Fez une école franco-arabe. En 1901, sur la demande des Israélites d'Arzila, (entre Tanger et Larache, sur l'Océan), la délégation de Tanger créait dans cette ville une petite école, qui ne donna pas de grands résultats et qui fut supprimée avec la délégation. En 1903, deux écoles franco-arabes avaient été créées, l'une à Rabat et l'autre à Salé, par la délégation de Tanger. Ces deux écoles disparurent également en 1904, avec la délégation de l’Alliance. En 1904, le Comité de l'Alliance française à Tanger fondait à Tétouan une école franco-arabe. Un Algérien, ancien instituteur en Algérie, interprète de l'agence consulaire, chargé de la poste française, enseigne à une trentaine d'élèves, tous musulmans, le français, l'arithmétique, un peu d'histoire et de géographie. Un fakih leur enseigne le Coran. En 1905, le Comité de l'Alliance fondait également une école à Larache. Les cours, faits au commencement par un musulman chargé de la poste française, le sont actuellement par un professeur algérien qui a fait ses études à la médersa de Tlemcen. Le programme est le même qu'à l'école de Tétouan. Les élèves sont également au nombre de trente environ, quoique la population musulmane de Larache soit très inférieure à celle de Tétouan : c'est que les habitants de Tétouan. bien que relativement plus policés que ceux des autres villes du Maroc, sont d'un fanatisme poli et méprisant peut-être plus difficile à pénétrer que la rusticité des Marocains d'une apparence moins civilisée. Une tentative d'école franco-arabe faite à Mogador en 1905 a échoué par le décès du chancelier du consulat de France de cette ville, survenu en 1907. C'était lui en effet qui assurait les cours avec une grande bonne volonté. L'école, fermée depuis deux ans, n'a pas encore été rouverte. Outre les trois écoles franco-arabes de Tanger, de Larache et de Tétouan, l'Alliance française subventionne également une petite école française mixte créée à Larache en 1908 et qui ne compte jusqu'à présent qu'une quinzaine d'élèves. De plus, les trois écoles françaises de Tanger, dont nous parlerons plus loin, reçoivent de l'Alliance française de légères subventions. Les ressources de l'Alliance française au Maroc sont des plus restreintes, et elle ne peut subvenir à ses charges que grâce au concours qui lui est apporté par la légation de France, sur les fonds du budget des oeuvres françaises au Maroc. ÉCOLES PRIMAIRES FRANÇAISES SUBVENTIONNEES PAR LA LEGATION DE FRANCE. — Elles sont, en 1909, au nombre de huit. La plus ancienne est une école de filles fondée à Tanger en 1885, qui reçoit une quarantaine d'élèves ; les autres sont : une école de garçons fondée à Tanger en 1904 ; une école de filles fondée à Tanger en 1908 ; une école mixte fondée à Casablanca en 1907 ; quatre écoles franco-arabes à Rabat, Oudjda, Casablanca et Mazagan. On annonce la prochaine création d'une école de garçons à Mogador et d'une école franco-arabe à Fez. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Un collège français a été ouvert à Tanger le 15 janvier 1909. Il s'y donne le même enseignement que dans les lycées et collèges de France. Entre les classes préparatoires, qui comprennent les petites classes jusqu'à la sixième exclusivement, et les classes secondaires, les élèves subissent un examen de passage qui tient lieu de certificat d'études secondaires élémentaires. Entre les classes secondaires, qui comprennent depuis la sixième inclusivement jusqu'à la seconde exclusivement, et les classes supérieures, un examen permet aux élèves d'obtenir le diplôme du premier degré. Les classes supérieures comprennent la seconde, la première, après laquelle les élèves passent la première partie du baccalauréat, la philosophie ou les mathématiques, après lesquelles ils passent la deuxième partie de cet examen. Le collège reçoit des externes simples, des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des pensionnaires. Des bourses et demi-bourses sont accordées après examen aux élèves, sans distinction de nationalité. L'année scolaire est de neuf mois. Elle commence le 1er octobre et se termine le 30 juin. Les élèves de toutes les nationalités et de toutes les religions sont admis au collège français, et les demi-pensionnaires musulmans et juifs reçoivent une nourriture préparée conformément aux prescriptions de leur religion. Le collège compte plus de soixante élèves. Le personnel enseignant comprend le directeur, le surveillant général, et sept professeurs (quatre Français, une dame anglo-espagnole, deux Arabes). LIGUE FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT. — L'oeuvre française de l'enseignement au Maroc ne s'est pas bornée à la création des établissements scolaires qui viennent d'être énumérés. La Ligue française de l'enseignement a fondé à Tanger, en 1905, un cercle qui compte actuellement 86 adhérents. Il est administré par un comité de dix membres, qui se réunit une fois par mois. Le cercle de Tanger a pour but de réunir toutes les personnes désireuses de contribuer personnellement à l'instruction, de développer la création de bibliothèques, de cours d'adultes et, d'une manière générale, toutes oeuvres intéressant l'instruction et l'éducation de la jeunesse. Depuis sa création, le cercle de la Ligue française de l'enseignement à Tanger a réussi à constituer une bibliothèque de deux mille volumes, qui est ouverte à tous. Il a institué depuis 1908 des cours d'adultes et des conférences qui se font à l'école primaire de garçons. Un autre cercle de la Ligue sera prochainement organisé à Mogador ; et l'on espère pouvoir créer petit à petit dans toutes les principales villes du Maroc des cercles et des bibliothèques, qui contribueront pour une large part à la pénétration intellectuelle du pays, la plus longue, sans doute, mais la plus sûre. Autres écoles européennes. — Il y a au Maroc quelques écoles espagnoles, des écoles anglaises, et, à Tanger, une école allemande fondée au commencement de 1909, au moment même de la création du collège français. ENSEIGNEMENT ESPAGNOL. — La communauté des Franciscains espagnols du Maroc entretient la plupart des écoles espagnoles. Elle possède, à Tanger, une école de garçons et une école de filles ; à Larache, une école de garçons ; à Casablanca, une école de garçons et une école de filles ; à Mazagan, une école de garçons et une école de filles ; à Mogador, une école de garçons ; à Tétouan, une école de garçons et une école de filles. L'instruction qui est donnée dans ces écoles est exclusivement catholique dans le sens clérical du mot. Une école laïque espagnole est subventionnée à Tanger par l'élément anticlérical espagnol. Ses ressources sont médiocres et lui permettent difficilement de lutter contre les établissements des Franciscains. Une petite école laïque espagnole avait été fondée, il y a une quinzaine d'années, à El Kçar el Kebir, par un républicain espagnol réfugié au Maroc, Don Eduardo Cabo Bujan de Castro. Elle était fréquentée par une vingtaine d'enfants israélites. qui n'y apprenaient guère qu'à lire et à écrire en espagnol. Fermée à la mort de son fondateur, survenue il y a cinq ou six ans, cette école a été rouverte dernièrement, et reçoit des enfants des deux sexes. ENSEIGNEMENT ANGLAIS. — Une petite école anglaise mixte réunit à Mazagan une douzaine d'enfants. Cette école n'est l'objet d'aucune subvention. A Mogador, on trouve trois écoles anglaises : une école de filles ; une école anglo-israélite de garçons, subventionnée en partie par le Board of Deputies, de Londres, et en partie par les Israélites protégés anglais de la ville ; une école anglo-israélite de filles, subventionnée par l'Anglo-Jewish Association, de Londres, pour la plus grande part, par l'Alliance israélite universelle de Paris, et par la communauté israélite de la ville. IV. — Récapitulation. Il serait impossible d'évaluer, même approximativement, le nombre des élèves musulmans et juifs qui reçoivent au Maroc l'enseignement indigène. Il faudrait pour cela faire un recensement de la population du Maroc ; cependant, en se fondant sur des appréciations qui n'ont d'ailleurs rien de positif, on peut estimer à plus de 100 000 les élèves qui suivent les cours des écoles coraniques ; un dixième à peine arrive à savoir lire et écrire très imparfaitement ; 2000 jeunes gens peut-être suivent les cours de l'enseignement secondaire indigène, et 500 à peine ceux de l'enseignement supérieur à Fez. Le nombre des enfants juifs qui suivent les cours des écoles rabbiniques peut être estimé à 5000 au plus, et les étudiants d'enseignement secondaire ou supérieur qui fournissent les rabbins des différentes classes à 100 environ. D'après les chiffres donnés par M. René Leclerc, délégué général du Comité du Maroc, et chargé par la légation de France de l'inspection des écoles françaises, pour la fin de l'année 1907, les enfants recevant une instruction européenne au Maroc étaient au nombre de 5270, répartis comme suit :
Au 15 juin 1909, en dehors des écoles de l'Alliance israélite, les statistiques fournies par M. René Leclerc comptent, y compris sept écoles franco-arabes et le collège, quatorze établissements français d'instruction, avec 715 élèves des deux sexes.
dépensés au Maroc pour y répandre l'enseignement français. Une augmentation d'une centaine de mille francs, prévue à partir de l'année 1910 au budget des oeuvres françaises au Maroc, permettra à la légation de France d'augmenter les subventions existantes et de créer de nouveaux établissements d'enseignement français.
Ed. Michaux-bellaire
|