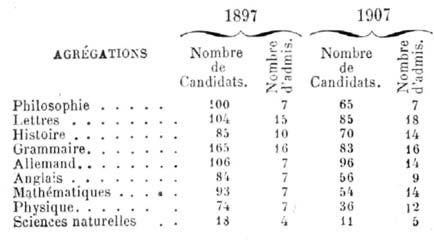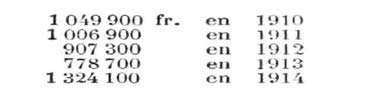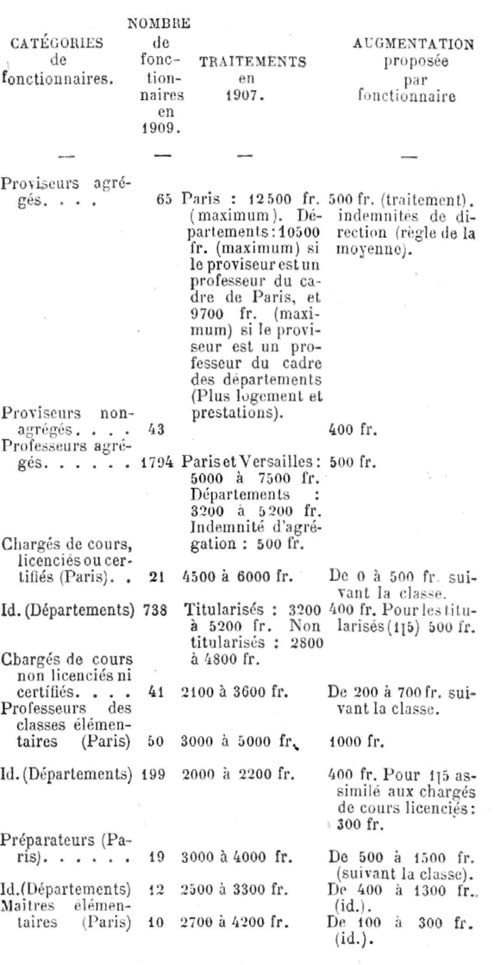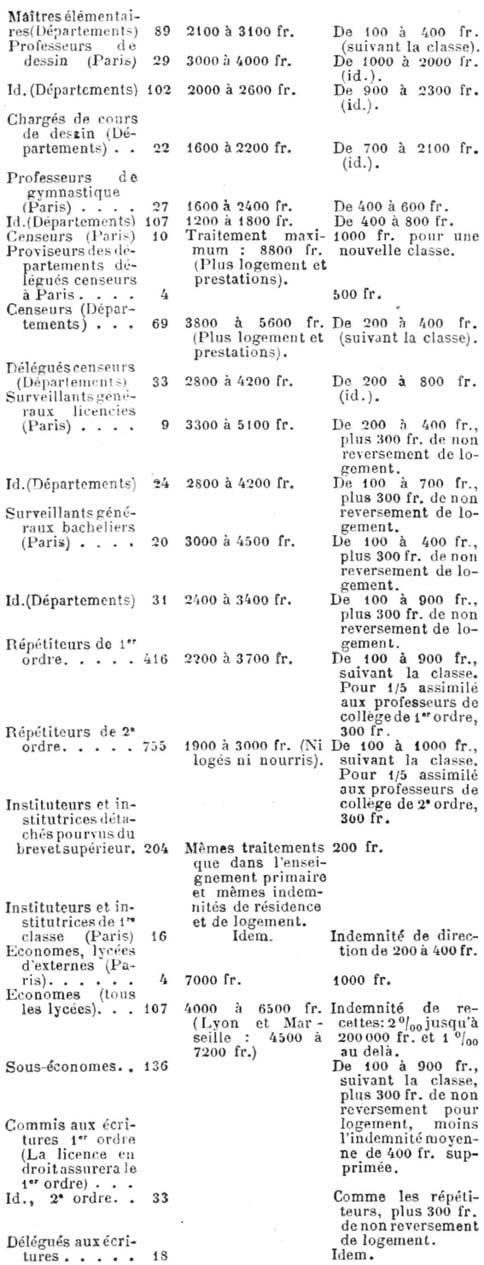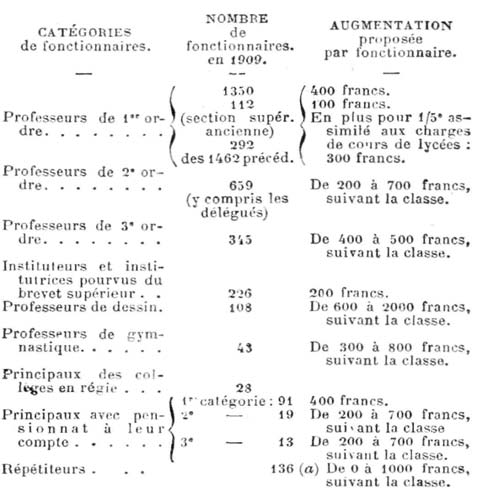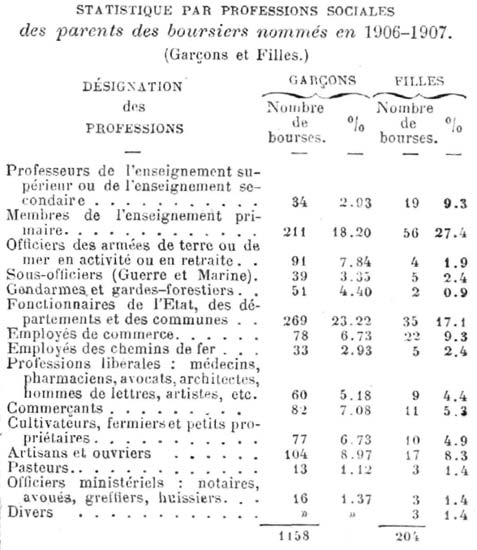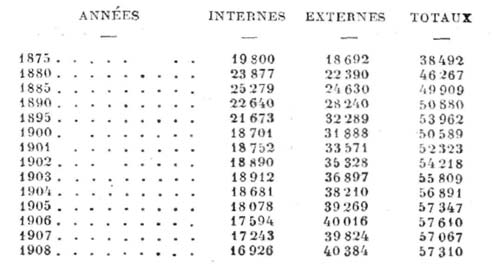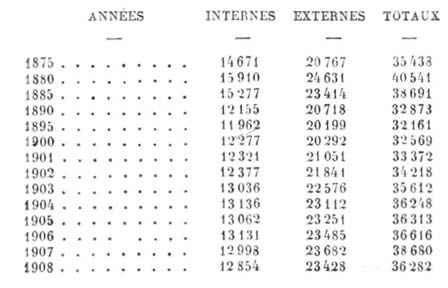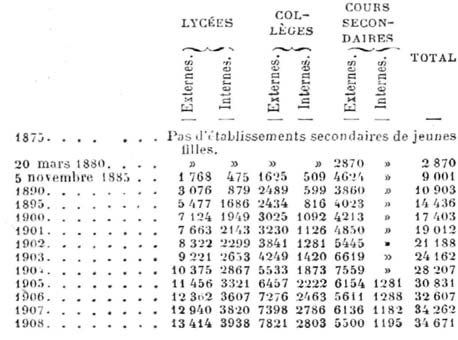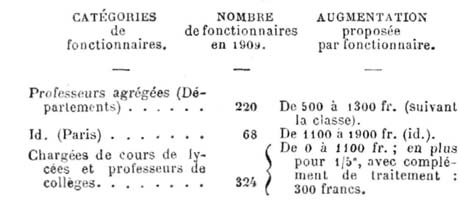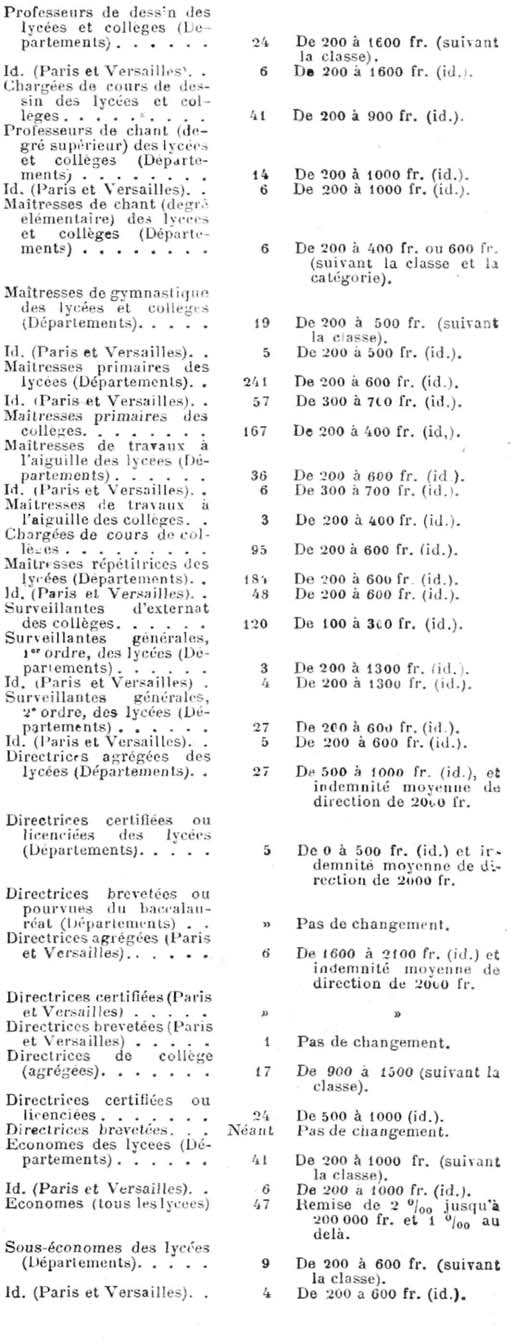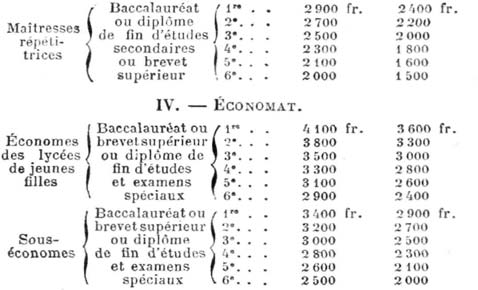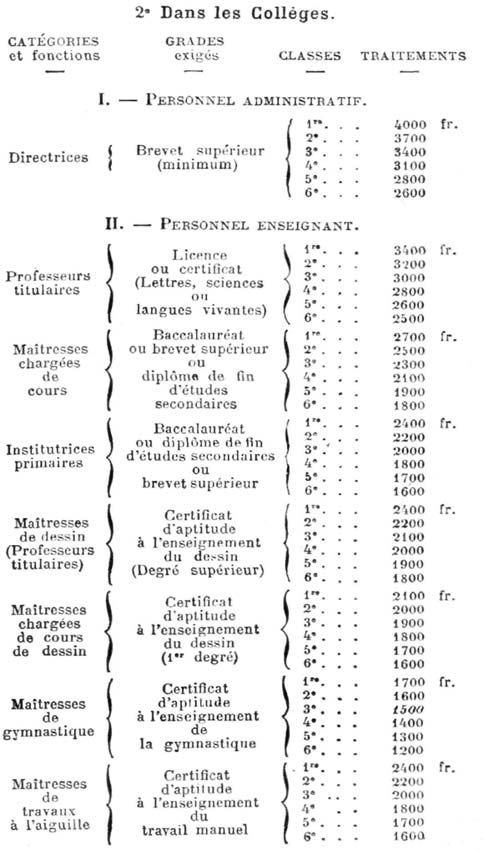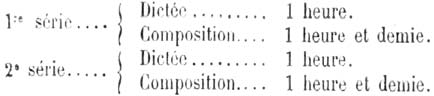|
lLycÃĐes et collÃĻgesNous divisons ce court exposÃĐ de l'histoire de l'enseignement secondaire en France en quatre sections correspondant n quatre pÃĐriodes successives. La premiÃĻre partie de l'article, qui conduit le lecteur jusqu'en 1883, a ÃĐtÃĐ ÃĐcrite, pour la premiÃĻre ÃĐdition de ce Dictionnaire, par Jules Steeg ; la seconde partie est due à la plume de son fils, M. T. Steeg, dÃĐputÃĐ, qui a ÃĐtÃĐ rapporteur du budget de l'instruction publique de 1907 à 1910. I â L'ancien rÃĐgime. Avant la RÃĐvolution française, l'enseignement secondaire ÃĐtait donnÃĐ par des ÃĐtablissements appelÃĐs collÃĻges. Primitivement ces collÃĻges ÃĐtaient des espÃĻces d'hÃītelleries oÃđ se rÃĐunissaient les jeunes gens qui suivaient les cours d'une universitÃĐ ; peu à peu ils furent soumis à une discipline rÃĐguliÃĻre, et devinrent des pensionnats oÃđ les enfants des familles riches et ceux qui se distinguaient par des aptitudes exceptionnelles venaient ÃĐtudier. â Voir CollÃĻges (sous l'ancien rÃĐgime). Outre ces collÃĻges universitaires, quelques corporations religieuses consacrÃĐes à l'enseignement avaient fondÃĐ de nombreux ÃĐtablissements du mÊme genre, et tout particuliÃĻrement les JÃĐsuites et les Oratoriens. Ces deux ordres ÃĐtaient rivaux sur ce terrain, et s'y disputaient la faveur des familles. Les JÃĐsuites l'emportaient par le nombre et la prospÃĐritÃĐ de leurs maisons d'ÃĐducation ; ils donnaient le ton à l'enseignement gÃĐnÃĐral. Le niveau des ÃĐtudes ÃĐtait assez bas. Sauf quelques ÃĐlÃĻves que l'on distinguait et que l'on cultivait avec une sollicitude toute spÃĐciale, le reste n'apprenait pas grand'chose. On en ÃĐtait demeurÃĐ, à part quelques essais dans les ÃĐcoles bientÃīt dispersÃĐes de Port Royal, et quelques tentatives peu heureuses des Oratoriens, à la vieille routine, au systÃĻme surannÃĐ des ÃĐludes presque exclusivement latines. Le grec ÃĐtait rÃĐservÃĐ Ã l'ÃĐlite ; l'histoire ancienne ÃĐtait seule ÃĐtudiÃĐe, et sans le moindre esprit critique ; la langue française ÃĐtait tenue en mÃĐdiocre estime ; les sciences mathÃĐmatiques, physiques et naturelles ÃĐtaient regardÃĐes comme de simples accessoires, et les langues vivantes à peu prÃĻs ignorÃĐes. En revanche, on poussait assez loin, surtout chez les JÃĐsuites, l'art d'ÃĐcrire en latin ; les pastiches de CicÃĐron et la mosaÃŊque des vers latins y ÃĐtaient en grand honneur. Le dÃĐveloppement de la mÃĐmoire, la lecture et l'imitation des classiques expurgÃĐs, la phrase, le ton oratoire, les bonnes maniÃĻres, l'obÃĐissance aux maîtres, l'assiduitÃĐ aux offices religieux, l'orthodoxie des doctrines, l'effacement de la volontÃĐ, le nivellement des caractÃĻres, voilà quel ÃĐtait le plan de l'ÃĐducation secondaire dans les collÃĻges de la Compagnie de JÃĐsus, qui servaient plus ou moins de modÃĻles. En habiles pÃĐdagogues, les PÃĻres avaient imaginÃĐ d'accorder une certaine place à des reprÃĐsentations thÃĐÃĒtrales ; des ÃĐlÃĻves choisis jouaient non seulement devant leurs camarades, mais devant un public assez nombreux, des piÃĻces de thÃĐÃĒtre, tragÃĐdies ou mÊme comÃĐdies, habituellement composÃĐes en latin par leurs maîtres ; les jeunes gens y prenaient goÃŧt, s'y formaient à l'aisance du ton et des allures, les parents ÃĐtaient flattÃĐs, et les maisons y gagnaient de la notoriÃĐtÃĐ et des ÃĐlÃĻves. La discipline des collÃĻges ÃĐtait rude ; peu de chose y ÃĐtait changÃĐ depuis le temps oÃđ Montaigne les appelait ÂŦ vrayes geaules de jeunesse captive Âŧ, oÃđ l'on ÂŦ corrompt l'esprit des enfans à le tenir à la gÃĐhenne Âŧ, jugement que justifiaient, pour un grand nombre de ces maisons, la hauteur des murs, l'ÃĐtroitesse des classes et des dortoirs, la tristesse des cours sans verdure, sans fleurs, sans horizon, et l'usage barbare des chÃĒtiments corporels, le pain et l'eau, la prison, le fouet (Voir Punitions). Sans doute les rÃĐgents habiles et dÃĐvouÃĐs ne manquaient pas, et les principaux se consacraient pour la plupart avec un zÃĻle absolu à leur tÃĒche. Un grand nombre d'entre eux, prÊtres, cÃĐlibataires, n'ayant d'autre famille que leurs ÃĐlÃĻves, vivaient avec eux dans l'intimitÃĐ, vivaient pour eux, et ceux des ÃĐlÃĻves qui embrassaient l'ÃĐtude avec ardeur, qui avaient du loisir, qui aimaient les lettres, faisaient d'excellentes classes et portaient les fruits d'une culture dÃĐlicate et vraiment exquise. Lorsque les JÃĐsuites furent expulsÃĐs de France, en 1762, leurs nombreux collÃĻges (il y en avait 88) ne furent pas fermÃĐs ; ils passÃĻrent en d'autres mains, et furent administrÃĐs par des bureaux (ÃĐdit de lÃĐvrier 1763). Au milieu du dix-huitiÃĻme siÃĻcle, on comptait en France, pour une population de 25 millions d'ÃĒmes, 562 collÃĻges. Par suite de la fusion de plusieurs ÃĐtablissements, Paris, qui avait eu au moyen ÃĒge vingt-huit collÃĻges, n'en avait plus que dix : celui de la Sorbonne, fondÃĐ au treiziÃĻme siÃĻcle, auquel avait ÃĐtÃĐ rÃĐuni par Richelieu celui du Plessis datant du quatorziÃĻme ; celui d'Harcourt, fondÃĐ au treiziÃĻme siÃĻcle ; ceux du Cardinal Lemoine, de Navarre, de Montaigu, de Lisicux, de la Marche, datant du quatorziÃĻme siÃĻcle ; celui des Grassins, fondÃĐ au seiziÃĻme siÃĻcle ; celui de Clermont, fondÃĐ au seiziÃĻme siÃĻcle, par les JÃĐsuites, qui lui donnÃĻrent, au siÃĻcle suivant, le nom de Louis-le-Grand ; enfin, le collÃĻge Mazarin ou des Quatre-Nations, fondÃĐ au dix-septiÃĻme siÃĻcle L'ensemble de la population scolaire de tous les collÃĻges de France vers 1789 ÃĐtait de 72 747 ÃĐlÃĻves ; ce qui donne un ÃĐlÃĻve sur 382 habitants, ou encore un ÃĐlÃĻve sur 31 enfants en ÃĒge de faire des ÃĐtudes. Cette proportion ne s'est pas beaucoup augmentÃĐe depuis lors ; elle a plutÃīt diminuÃĐ Ã certains moments. En 1843, Villemain, ministre de l'instruction publique, constatait dans les ÃĐtablissements d'enseignement secondaire un ÃĐlÃĻve sur 493 habitants, ou encore un ÃĐlÃĻve sur 35 garçons en ÃĒge de faire des ÃĐtudes. Il donnait de ce fait (rapport au roi) l'interprÃĐtation suivante : ÂŦ Cette rÃĐduction s'explique par les changements mÊmes de la sociÃĐtÃĐ, la place moins grande faite à la vie de loisir et d'ÃĐtude, la tendance beaucoup plus gÃĐnÃĐrale vers les professions industrielles et commerçantes. ÂŦ Ajoutons à ces causes diverses tous les moyens de gratuitÃĐ qui existaient avant 1789 pour l'instruction classique, de telle sorte que cette instruction, alors plus recherchÃĐe par le goÃŧt et l'habitude des classes riches, ÃĐtait en mÊme temps plus accessible aux classes moyennes ou pauvres. ÂŦ Alors tout, dans les traditions et les moeurs, secondait l'instruction classique ; tout ÃĐtait prÃĐparÃĐ pour elle et la favorisait, le nombre des bourses et des secours de toute nature, la frÃĐquentation gratuite d'une foule d'ÃĐtablissements, l'extrÊme modicitÃĐ des frais dans tous les autres. Il y avait plus de 3000 bourses, et de nombreuses remises ou rÃĐcompenses qui procuraient en outre l'ÃĐducation gratuite à plus de 7000 enfants. L'enseignement ÃĐtait donnÃĐ sans rÃĐtribution aucune dans beaucoup de collÃĻges, et spÃĐcialement dans tous les collÃĻges de Paris, depuis 1719. Âŧ Le nombre des ÃĐlÃĻves externes qui frÃĐquentaient à ce titre les anciens collÃĻges, à Paris et dans les provinces, est ÃĐvaluÃĐ Ã 30 000 ; si l'on y joint 10000 bourses et fondations particuliÃĻres, on voit que l'enseignement secondaire ÃĐtait donnÃĐ gratuitement soit en partie, soit en totalitÃĐ, à plus de 40000 enfants. Il n'en est pas moins vrai que l'ÃĐducation des collÃĻges, sous l'ancien rÃĐgime, s'adressait à l'aristocratie, n ÃĐtait destinÃĐe qu'à une ÃĐlite, avait pour objet de former une sociÃĐtÃĐ polie, lettrÃĐe, destinÃĐe aux jouissances et au luxe de la conversation ; bonne aux oisifs, aux ÃĐcrivains, elle ÃĐtait peu propre à armer, sinon la foule, du moins les hommes de travail et de volontÃĐ, pour les luttes et les difficultÃĐs de l'existence. II â La RÃĐvolution. La RÃĐvolution ayant brisÃĐ les barriÃĻres qui sÃĐparaient les classes, ouvrant aux esprits entreprenants, aux familles pauvres, à la dÃĐmocratie, une immense carriÃĻre, faisant appel à toutes les ÃĐnergies, à tous les talents, il devenait nÃĐcessaire de leur offrir une autre ÃĐducation, une instruction qui fÃŧt tout à la fois une transition entre l'ÃĐcole primaire et la culture supÃĐrieure, et une prÃĐparation plus efficace aux nÃĐcessitÃĐs de la vie nouvelle. DÃĐjà le procureur gÃĐnÃĐral au Parlement de Rennes, La Chalotais, avait exprimÃĐ des idÃĐes de rÃĐforme dans son Essai d'ÃĐducation nationale paru en 1763. Le prÃĐsident Rolland, à Paris, ÃĐnumÃĻre dans son Compte-rendu du 13 mai 1768 les sÃĐrieuses critiques qu'il croit devoir adresser à l'ÃĐducation classique de son siÃĻcle et certaines rÃĐformes qui ont pris place dans le programme moderne. Plusieurs cahiers des Etats-gÃĐnÃĐraux de 1789 ÃĐmettent des voeux qui tendent à la rÃĐforme de l'enseignement et à l'organisation d'un systÃĻme d'instruction publique ayant pour objet de former des citoyens. De nombreux plans de rÃĐforme de l'enseignement virent alors le jour, entre autres celui que Daunou prÃĐsenta à la Constituante au nom des ÂŦ instituteurs publics de l'Oratoire Âŧ. Dans le projet d'organisation de l'instruction publique prÃĐsentÃĐ par Talleyrand en 1791 au nom du ComitÃĐ de constitution, l'enseignement secondaire devait Être donnÃĐ dans des ÃĐcoles de district. On devait y enseigner les langues anciennes, une langue vivante ; Âŧ l'exposÃĐ des litres d'aprÃĻs lesquels la religion commande la croyance Âŧ ; les applications de la morale ; l'ÃĐtude dÃĐveloppÃĐe de la DÃĐclaration des droits et de l'organisation des pouvoirs ; l'histoire des peuples libres et celle des Français ÂŦ quand il en existera une Âŧ ; ÂŦ les rÃĻgles et les beautÃĐs de l'ÃĐloquence et de la poÃĐsie Âŧ ; les ÃĐlÃĐments des mathÃĐmatiques, de la physique, de la chimie, de la musique et de la peinture ; la natation, l'escrime, l'ÃĐquitation et la danse. Au nom du ComitÃĐ d'instruction publique de l'AssemblÃĐe lÃĐgislative, Condorcet prÃĐsenta en 1792 un projet de dÃĐcret dans lequel l'enseignement que nous appelons secondaire formait le troisiÃĻme degrÃĐ de l'enseignement public ; il devait se donner dans des ÃĐtablissements appelÃĐs instituts, et embrasser ÂŦ les ÃĐlÃĐments de toutes les connaissances humaines Âŧ. (Voir Condorcet.) Nous ne referons pas ici l'histoire des divers projets discutÃĐs par la Convention : celui de Condorcet, adoptÃĐ par le premier ComitÃĐ de cette assemblÃĐe ; celui de la Commission des Six ; celui de la pÃĐtition du 15 septembre 1793 et de la Commission d'ÃĐducation nationale (1er octobre): et, aprÃĻs le 9 thermidor, celui du 26 frimaire an III sur les ÃĐcoles centrales, qui devint le dÃĐcret du 7 ventÃīse an III, remaniÃĐ par celui du 3 brumaire an IV ; nous renvoyons aux articles Convention et Centrales (Ecoles). Les ÃĐcoles centrales, qui donnaient un enseignement libÃĐral et laÃŊc, ont rendu de rÃĐels services et auraient certainement contribuÃĐ Ã ÃĐlever le niveau gÃĐnÃĐral de l'instruction si elles avaient durÃĐ. Mais elles ÃĐtaient extrÊmement combattues par tous les amis de l'ancien rÃĐgime, par tous ceux qui voyaient avec peine la dÃĐmocratie s'ÃĐtablir, s'ÃĐclairer, puiser dans cette institution une sÃĻve et des forces qui l'eussent rendue invincible. On regrettait le vieux systÃĻme classique et l'internat ; on se plaignait de l'absence d'instruction religieuse, de la diminution de la part faite aux langues anciennes. La Convention avait disparu et son oeuvre ÃĐtait suspecte. On revenait volontiers aux souvenirs et aux usages du passÃĐ. En l'an VI, Roger-Martin, au nom d'une commission, prÃĐsenta au Conseil des Cinq-Cents un projet de rÃĐforme, destinÃĐ, en rÃĐduisant le nombre des ÃĐcoles centrales, à en accroître l'efficacitÃĐ et à en rendre l'accÃĻs plus facile par la crÃĐation d'ÃĐcoles secondaires, intermÃĐdiaires entre l'ÃĐcole primaire et l'ÃĐcole centrale, Ce projet n'aboutit pas (Voir Conseil des Cinq-Cents). III. â La restauration de l'ancien enseignement, de 1802 à la troisiÃĻme RÃĐpublique. Le Consulat et l'Empire. â La rÃĐaction, pleinement victorieuse aprÃĻs le coup d'Etat du 18 brumaire, poursuivit dans la mesure du possible le rÃĐtablissement des institutions de l'ancien rÃĐgime, et les ÃĐcoles centrales succombÃĻrent. Mais, devant le Tribunal et le Corps lÃĐgislatif, les orateurs chargÃĐs d'exposer les raisons qu'on allÃĐguait pour les supprimer furent contraints par l'ÃĐvidence d'en faire l'ÃĐloge. Le tribun Jard-Panvillier croyait qu'on eÃŧt pu remÃĐdier aux inconvÃĐnients signalÃĐs en ÃĐlevant un peu l'enseignement dans les ÃĐcoles primaires des villes et en le rendant plus ÃĐlÃĐmentaire dans les ÃĐcoles centrales, de maniÃĻre à ÃĐtablir une transition plus facile entre les deux institutions. Il est vrai que ce n'ÃĐtait pas là du tout ce que dÃĐsirait la rÃĐaction, plus pressÃĐe de reconstituer les anciennes distinctions et de relever les vieilles mÃĐthodes que de faire un pas en avant dans la voie ouverte par la RÃĐvolution. Le tribun Jacquemont faisait cet aveu dans son rapport : ÂŦ Le nombre des ÃĐlÃĻves que prÃĐsentaient les ÃĐcoles centrales dans ces derniÃĻres annÃĐes s'ÃĐtait considÃĐrablement augmentÃĐ. L'ordre des ÃĐtudes et la matiÃĻre de l'enseignement s'ÃĐtaient fixÃĐs, et l'administration avait pris d'elle-mÊme une marche exacte et rÃĐguliÃĻre. Âŧ C'est sur ces institutions en pleine activitÃĐ et en voie d'affermissement que Bonaparte dÃĐcida de porter la hache. IndÃĐpendantes, vivant de la vie du dÃĐpartement, animÃĐes d'un esprit dÃĐmocratique et moderne, instruments de progrÃĻs et d'affranchissement intellectuel, elles ne rÃĐpondaient pas à son idÃĐal. Roederer, orateur du gouvernement, interprÃĻte fidÃĻle de la pensÃĐe du premier consul et du parti rÃĐactionnaire, les condamnait en ces termes : ÂŦ Le systÃĻme des ÃĐcoles centrales a fait tout le contraire de ce qu'indiquait la nature des choses. Peu ou point d'enseignement littÃĐraire, partout des sciences. Elles semblaient avoir entrepris de peupler la France d'encyclopÃĐdies vivantes. Il y avait plus de sagesse dans le systÃĻme des anciens collÃĻges ; là le fond de l'instruction ÃĐtait l'ÃĐlude des langues anciennes, l'art d'exprimer ses pensÃĐes en prose, en vers. Âŧ La loi du 11 florÃĐal an X (1er mai 1802), obÃĐissant à cette inspiration, rÃĐorganisa complÃĻtement l'instruction publique. Elle divisait les ÃĐtablissements en trois catÃĐgories : 1° Les ÃĐcoles primaires, crÃĐÃĐes par les communes ; 2° Les ÃĐcoles secondaires, ÃĐtablies par les communes ou tenues par des particuliers. L'article 6 les dÃĐfinissait de la sorte : ÂŦ Toute ÃĐcole ÃĐtablie par les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la gÃĐographie, de l'histoire et des mathÃĐmatiques, sera considÃĐrÃĐe comme ÃĐcole secondaire Âŧ. C'est l'origine des collÃĻges communaux. Il ne pouvait Être ÃĐtabli d'ÃĐcole secondaire sans l'autorisation du gouvernement ; 3° Les lycÃĐes et les ÃĐcoles spÃĐciales, entretenus aux frais du TrÃĐsor public. Le Dictionnaire a donnÃĐ, à l'article Consulat, les trois premiers titres de cette loi (articles 1-8), relatifs à la division de l'instruction, aux ÃĐcoles primaires et aux ÃĐcoles dites secondaires. Nous donnons ici les six autres titres, y compris les titres V et VI relatifs aux ÃĐcoles spÃĐciales, dont l'organisation est ÃĐtroitement rattachÃĐe à celle des lycÃĐes : ÂŦ TITRE IV. â Des lycÃĐes. ÂŦ ART. 9. â Il sera ÃĐtabli des lycÃĐes pour l'enseignement des lettres et des sciences. Il y aura un lycÃĐe, au moins, par arrondissement de chaque tribunal d'appel. ÂŦ ART. 10. â On enseignera dans les lycÃĐes les langues anciennes, la rhÃĐtorique, la logique, la morale, et les ÃĐlÃĐments des sciences mathÃĐmatiques et physiques. ÂŦ Le nombre des professeurs de lycÃĐe ne sera jamais au-dessous de huit ; il pourra Être augmentÃĐ par le gouvernement, ainsi que celui des objets d'enseignement, d'aprÃĻs le nombre des ÃĐlÃĻves qui suivront les lycÃĐes. ÂŦ ART. 11. â Il y aura, dans les lycÃĐes, des maîtres d'ÃĐtudes, des maîtres de dessin, d'exercices militaires et d'arts d'agrÃĐment. ÂŦ ART. 12. â L'instruction y sera donnÃĐe : ÂŦ A des ÃĐlÃĻves que le gouvernement y placera ; ÂŦ Aux ÃĐlÃĻves des ÃĐcoles secondaires, qui y seront admis par un concours ; ÂŦ A des ÃĐlÃĻves que les parents pourront y mettre en pension ; ÂŦ A des ÃĐlÃĻves externes. ÂŦ ART. 13. â L'administration de chaque lycÃĐe sera confiÃĐe à un proviseur : il aura immÃĐdiatement sous lui un censeur des ÃĐtudes, et un procureur gÃĐrant les affaires de l'ÃĐcole. ÂŦ ART. 14. â Le proviseur, le censeur et le procureur de chaque lycÃĐe seront nommÃĐs par le premier consul : ils formeront le conseil d'administration de l'ÃĐcole. ÂŦ ART. 15. â Il y a, dans chacune des villes oÃđ sera ÃĐtabli un lycÃĐe, un bureau d'administration de cette ÃĐcole. Ce bureau sera composÃĐ du prÃĐfet du dÃĐpartement, du prÃĐsident du tribunal d'appel, du commissaire du gouvernement prÃĻs ce tribunal, du commissaire du gouvernement prÃĻs le tribunal criminel, du maire, et du proviseur. ÂŦ Dans les villes oÃđ il n'y aurait point de tribunal d'appel, le prÃĐsident du tribunal criminel fera partie du bureau d'administration du lycÃĐe. Dans celles oÃđ il n'y aurait ni tribunal d'appel, ni tribunal criminel, les membres de ce bureau seront nommÃĐs par le premier consul. ÂŦ ART. 16. â Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et plus souvent s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du lycÃĐe l'y invite. Il sera chargÃĐ de la vÃĐrification des comptes, et de la surveillance gÃĐnÃĐrale du lycÃĐe. ÂŦ Le proviseur rendra compte au bureau d'administration de l'ÃĐtat du lycÃĐe. Il y portera les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient Être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions, et par les ÃĐlÃĻves dans leur conduite. Dans le premier cas, la plainte sera communiquÃĐe au professeur contre lequel elle sera dirigÃĐe ; elle sera ensuite adressÃĐe, ainsi que la rÃĐponse, au gouvernement. Dans le cas d'inconduite et d'indiscipline, l'ÃĐlÃĻve pourra Être exclu du lycÃĐe par le bureau, à , la charge par celui-ci d'en rendre compte au gouvernement. ÂŦ ART. 17. â Il sera nommÃĐ par le premier consul trois inspecteurs gÃĐnÃĐraux des ÃĐtudes, qui visiteront une fois au moins l'annÃĐe les lycÃĐes, en arrÊteront dÃĐfinitivement la comptabilitÃĐ, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et en rendront compte au gouvernement. ÂŦ ART. 18. â AprÃĻs la premiÃĻre formation des lycÃĐes, les proviseurs, censeurs et procureurs des lycÃĐes devront Être mariÃĐs ou l'avoir ÃĐtÃĐ. Aucune femme ne pourra nÃĐanmoins demeurer dans l'enceinte des bÃĒtiments occupÃĐs par les pensionnaires. ÂŦ ART. 19. â La premiÃĻre nomination des professeurs des lycÃĐes sera faite de la maniÃĻre suivante : les trois inspecteurs gÃĐnÃĐraux des ÃĐtudes, rÃĐunis à trois membres de l'Institut national dÃĐsignÃĐs par le premier consul, parcourront les dÃĐpartements, et y examineront les citoyens qui se prÃĐsenteront pour occuper les diffÃĐrentes places de professeurs. Ils indiqueront au gouvernement, et pour chaque place, deux sujets, dont l'un sera nommÃĐ par le premier consul. ÂŦ ART. 20. â Lorsqu'il vaquera une chaire dans les lycÃĐes une fois organisÃĐs, les trois inspecteurs gÃĐnÃĐraux des ÃĐtudes prÃĐsenteront un sujet au gouvernement ; le bureau, rÃĐuni au conseil d'administration et aux professeurs des lycÃĐes, en prÃĐsentera un autre : le premier consul nommera l'un des deux candidats. ÂŦ ART. 21. â Les trois fonctionnaires chargÃĐs de l'administration et les professeurs des lycÃĐes pourront Être appelÃĐs, d'aprÃĻs le zÃĻle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycÃĐes les plus faibles dans les plus forts, des places infÃĐrieures aux supÃĐrieures cette promotion sera proposÃĐe au premier consul, sur le rapport des trois inspecteurs gÃĐnÃĐraux des ÃĐtudes. ÂŦ ART. 22. â Les lycÃĐes correspondant aux arrondissements des tribunaux d'appel devront Être entiÃĻrement organisÃĐs dans le cours de l'an XIII de la RÃĐpublique. ÂŦ A mesure que les lycÃĐes seront organisÃĐs, le gouvernement dÃĐterminera celles des ÃĐcoles centrales qui devront cesser leurs fonctions. ÂŦ TITRE V. â Des ÃĐcoles spÃĐciales. ÂŦ ART. 23. â Le dernier degrÃĐ d'instruction comprendra, dans des ÃĐcoles spÃĐciales, l'ÃĐtude complÃĻte et approfondie, ainsi que le perfectionnement, des sciences et des arts utiles. ÂŦ ART. 24. â Les ÃĐcoles spÃĐciales qui existent seront maintenues, sans prÃĐjudice des modifications que le gouvernement croira devoir dÃĐterminer pour l'ÃĐconomie et le bien du service. Quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'ÃĐcole de droit qui sera ÃĐtablie à Paris, il y sera nommÃĐ par le premier consul, entre trois candidats qui seront prÃĐsentÃĐs, le premier par une des classes de l'Institut national, le second par les inspecteurs gÃĐnÃĐraux des ÃĐludes, et le troisiÃĻme par les professeurs de l'ÃĐcole oÃđ la place sera vacante. ÂŦ ART. 25. â De nouvelles ÃĐcoles spÃĐciales seront instituÃĐes comme il suit : ÂŦ 1° Il pourra Être ÃĐtabli dix ÃĐcoles de droit : chacune d'elles aura quatre professeurs au plus ; ÂŦ 2° Il pourra Être crÃĐÃĐ trois nouvelles ÃĐcoles de mÃĐdecine, qui auront au plus chacune trois professeurs, et dont une sera spÃĐcialement consacrÃĐe à l'ÃĐlude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer ; ÂŦ 3° Il y aura quatre ÃĐcoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre professeurs dans chacune ; ÂŦ 4° Les arts mÃĐcaniques et chimiques seront enseignÃĐs dans deux ÃĐcoles spÃĐciales : il y aura trois professeurs dans chacune de ces ÃĐcoles ; ÂŦ 5° Une ÃĐcole de mathÃĐmatiques transcendantes aura trois professeurs ; ÂŦ 6° Une ÃĐcole spÃĐciale de gÃĐographie, d'histoire et d'ÃĐconomie politique sera composÃĐe de quatre professeurs ; ÂŦ 7° Outre les ÃĐcoles des arts du dessin, existant à Paris, Dijon et Toulouse, il en sera formÃĐ une quatriÃĻme avec quatre professeurs : ÂŦ 8° Les observatoires actuellement en activitÃĐ auront chacun un professeur d'astronomie ; ÂŦ 9° Il y aura, prÃĻs de plusieurs lycÃĐes, des professeurs de langues vivantes ; ÂŦ 10° Il sera nommÃĐ huit professeurs de musique et de composition. ÂŦ ART. 26. â La premiÃĻre nomination des professeurs de ces nouvelles ÃĐcoles spÃĐciales sera faite de la maniÃĻre suivante : les classes de l'Institut correspondantes aux places qu'il s'agira de remplir prÃĐsenteront un sujet au gouvernement ; les trois inspecteurs gÃĐnÃĐraux des ÃĐtudes en prÃĐsenteront un second : le premier consul choisira l'un des deux. ÂŦ AprÃĻs l'organisation des nouvelles ÃĐcoles spÃĐciales, le premier consul nommera aux places vacantes entre trois sujets qui lui seront prÃĐsentÃĐs comme il est dit à l'article 24. ÂŦ ART. 27. â Chacune ou plusieurs des nouvelles ÃĐcoles spÃĐciales seront placÃĐes prÃĻs d'un lycÃĐe, et rÃĐgies par le conseil administratif de cet ÃĐtablissement. ÂŦ TITRE VI. â De l'ÃĐcole spÃĐciale militaire. ÂŦ ART. 28. â Il sera ÃĐtabli dans une des places-fortes de la RÃĐpublique une ÃĐcole spÃĐciale militaire, destinÃĐe à enseigner à une portion des ÃĐlÃĻves sortis des lycÃĐes les ÃĐlÃĐments de l'art de la guerre. ÂŦ ART. 29. â Elle sera composÃĐe de cinq cents ÃĐlÃĻves formant un bataillon, et qui seront accoutumÃĐs au service et à la discipline militaire ; elle aura au moins dix professeurs, chargÃĐs d'enseigner toutes les parties thÃĐoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que l'histoire des guerres et des grands capitaines. ÂŦ ART. 30. â Sur les cinq cents ÃĐlÃĻves de l'ÃĐcole spÃĐciale militaire, deux cents seront pris parmi les ÃĐlÃĻves nationaux des lycÃĐes, en proportion de leur nombre dans chacune de ces ÃĐcoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes, d'aprÃĻs l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs ÃĐtudes. Chaque annÃĐe il y sera admis cent des premiers, et cent cinquante des seconds : ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la RÃĐpublique dans l'ÃĐcole spÃĐciale militaire: ces deux annÃĐes leur seront comptÃĐes pour temps de service. ÂŦ Le gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talents des ÃĐlÃĻves de l'ÃĐcole spÃĐciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armÃĐe qui sont à sa nomination. ÂŦ ART. 31. â L'ÃĐcole spÃĐciale militaire aura un rÃĐgime diffÃĐrent de celui des lycÃĐes et des autres ÃĐcoles spÃĐciales, et une administration particuliÃĻre ; elle sera comprise dans les attributions du ministre de la guerre. Les professeurs en seront immÃĐdiatement nommÃĐs par le premier consul. ÂŦ TITRE VII â Des ÃĐlÃĻves nationaux. ÂŦ ART. 32. â Il sera entretenu, aux frais de la RÃĐpublique, six mille quatre cents ÃĐlÃĻves pensionnaires dans les lycÃĐes et dans les ÃĐcoles spÃĐciales. ÂŦ ART. 33. â Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront choisis par le gouvernement parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires civils, judiciaires, administratifs ou municipaux qui auront bien servi la RÃĐpublique ; et, pendant dix ans seulement, parmi les enfants des citoyens des dÃĐpartements rÃĐunis à la France, quoiqu'ils n'aient ÃĐtÃĐ ni militaires ni fonctionnaires publics. ÂŦ Ces deux mille quatre cents ÃĐlÃĻves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et ÃĐcrire. ÂŦ ART. 34. â Les quatre mille autres seront pris dans un nombre double d'ÃĐlÃĻves des ÃĐcoles secondaires, qui seront prÃĐsentÃĐs au gouvernement d'aprÃĻs un examen et un concours. ÂŦ Chaque dÃĐpartement fournira un nombre de ces derniers ÃĐlÃĻves proportionnÃĐ Ã sa population. ÂŦ ART. 35. â Les ÃĐlÃĻves entretenus dans les lycÃĐes ne pourront y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs ÃĐtudes, ils subiront un examen d'aprÃĻs lequel un cinquiÃĻme d'entre eux sera placÃĐ dans les diverses ÃĐcoles spÃĐciales, suivant les dispositions de ces ÃĐlÃĻves, pour y Être entretenus, de deux à quatre annÃĐes, aux frais de la RÃĐpublique. ÂŦART. 36. â Le nombre des ÃĐlÃĻves nationaux placÃĐs prÃĻs des lycÃĐes pourra Être distribuÃĐ inÃĐgalement par le gouvernement dans chacune de ces ÃĐcoles suivant les convenances de la localitÃĐ. ÂŦ TITRE VIII. â Des pensions nationales, et de leur emploi. ÂŦ ART. 37. â Le terme moyen des pensions sera de sept cents francs. Elles seront fixÃĐes pour chaque lycÃĐe par le gouvernement, et serviront tant aux dÃĐpenses de nourriture et d'entretien des ÃĐlÃĻves nationaux qu'au traitement des fonctionnaires et professeurs, et autres dÃĐpenses des lycÃĐes. ÂŦ ART. 38. â Le prix des pensions payÃĐes par les parents qui placeront leurs enfants dans les lycÃĐes ne pourra excÃĐder celui qui aura ÃĐtÃĐ fixÃĐ par le gouvernement pour chacune de ces ÃĐcoles. ÂŦ Les ÃĐlÃĻves externes des lycÃĐes et des ÃĐcoles spÃĐciales paieront une rÃĐtribution, qui sera proposÃĐe, pour chaque lycÃĐe, par son bureau d'administration, et confirmÃĐe par le gouvernement. ÂŦ ART. 39. â Le gouvernement arrÊtera, d'aprÃĻs le nombre des ÃĐlÃĻves nationaux qu'il placera dans chaque lycÃĐe, et d'aprÃĻs le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prÃĐlevÃĐe sur le produit de ces pensions. Il en sera de mÊme de la portion supplÃĐtive de traitement, qui devra Être fixÃĐe par le gouvernement d'aprÃĻs le nombre des pensionnaires et des ÃĐlÃĻves externes de chaque lycÃĐe. ÂŦ Les proviseurs des lycÃĐes sont exceptÃĐs de la derniÃĻre disposition ; ils recevront du gouvernement un supplÃĐment annuel et proportionnÃĐ Ã leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction. ÂŦ TITRE IX. â Dispositions gÃĐnÃĐrales. ÂŦ ART. 40. â Les bÃĒtiments des lycÃĐes seront entretenus aux frais des villes oÃđ ils seront ÃĐtablis. ÂŦ ART. 41. â Aucun ÃĐtablissement ne pourra prendre dÃĐsormais les noms de lycÃĐe et d'institut. L'Institut national des sciences et des arts sera le seul ÃĐtablissement public qui portera ce dernier nom. ÂŦ ART. 42. â Il sera formÃĐ, sur les traitements des fonctionnaires et professeurs des lycÃĐes et des ÃĐcoles spÃĐciales, un fonds de retenue qui n'excÃĐdera pas le vingtiÃĻme de ces traitements. Ce fonds sera affectÃĐ Ã des retraites, qui seront accordÃĐes aprÃĻs vingt ans de service, et rÃĐglÃĐes en raison de l'anciennetÃĐ. Ces retraites pourront aussi Être accordÃĐes pour cause d'infirmitÃĐs, sans que dans ce cas les vingt annÃĐes d'exercice soient obligÃĐes. ÂŦ ART. 43. â Le gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers eu faveur des ÃĐcoles ou de tout autre ÃĐtablissement d'instruction publique. Le nom des donateurs sera inscrit à perpÃĐtuitÃĐ dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquÃĐes. ÂŦ ART. 44. â Toutes les dispositions de la loi du 3 brumaire an IV qui sont contraires à la prÃĐsente loi sont abrogÃĐes. Âŧ En exÃĐcution de la loi du 11 florÃĐal an X, un arrÊtÃĐ consulaire du 19 frimaire an XI (10 dÃĐcembre 1802) dÃĐveloppa le plan d'enseignement, dont le premier article disait : ÂŦ On enseignera essentiellement dans les lycÃĐes le latin et les mathÃĐmatiques Âŧ. Il devait y avoir six classes pour l'ÃĐtude du latin (comprenant l'histoire et la gÃĐographie comme annexes), et six classes parallÃĻles pour l'ÃĐtude des mathÃĐmatiques (comprenant comme annexes les sciences physiques et naturelles), mais de maniÃĻre que les ÃĐlevÃĐs d'un talent et d'une application ordinaire pussent faire deux classes par an. Au faîte de ces deux sÃĐries figurait un cours bisannuel de belles-lettres et de mathÃĐmatiques ÂŦ transcendantes Âŧ, qui reprÃĐsentait l'enseignement actuel des facultÃĐs. (Cournot, Des Institutions d'instruction publique en France, 1864.) Un autre arrÊtÃĐ, du 21 prairial an XI (10 juin 1803), rÃĐgla l'administration et le rÃĐgime intÃĐrieur des lycÃĐes, fixa le costume des ÃĐlÃĻves, et dÃĐtermina minutieusement tout ce qui concernait la discipline, les communications avec le dehors, les congÃĐs, les examens et les prix, etc. L'arrÊtÃĐ du 15 brumaire an XII (7 novembre 1803) divisa les lycÃĐes en trois classes, et fixa les traitements des fonctionnaires et des professeurs attachÃĐs à ces ÃĐtablissements. Dans les lycÃĐes de la derniÃĻre classe, le traitement du proviseur ÃĐtait de 3000 francs, celui du censeur et celui du professeur de premiÃĻre de 1500 francs, celui du professeur de seconde de 1200, celui du professeur de troisiÃĻme de 1000 francs, celui d'un maître d'ÃĐtude de 700 francs ; à Paris, les traitements ÃĐtaient respectivement de 5000 francs (proviseur), 3000 (censeur), 3000, 2500, 2000 (professeurs de premiÃĻre, de seconde et de troisiÃĻme) et 1200 francs (maîtres d'ÃĐtude). Pour les ÃĐcoles secondaires communales, l'arrÊtÃĐ du 30 frimaire an XI (21 dÃĐcembre 1802) fixa les conditions auxquelles les communes et les particuliers pourraient obtenir la concession gratuite de locaux ; l'arrÊtÃĐ du 19 vendÃĐmiaire an XII (12 octobre 1803) rÃĐgla l'administration, le plan d'ÃĐtudes et le rÃĐgime intÃĐrieur de ces ÃĐtablissements. Ce n'ÃĐtait là qu'un dÃĐbut. Cette organisation, encore trop lÃĒche et trop indÃĐpendante, ne pouvait suffire au mouvement de concentration à outrance que le maître de la France voulait imprimer à toutes les institutions. Devenu empereur, NapolÃĐon rÃĐsolut de prendre et de garder seul dans sa main toute-puissante l'instruction du pays, comme il tenait dÃĐjà l'armÃĐe, l'administration et le culte. Il voulait s'assurer le gouvernement des esprits par l'ÃĐducation comme il espÃĐrait l'avoir dÃĐjà par la religion, et il rÊvait un clergÃĐ d'enseignement comme il venait de crÃĐer un clergÃĐ concordataire. Il a longtemps hÃĐsitÃĐ, pour lui confier la jeunesse, entre le personnel ecclÃĐsiastique, dÃĐjà constituÃĐ, enrÃĐgimentÃĐ, assoupli, et un personnel laÃŊque à crÃĐer. Le premier ÃĐtait mieux façonnÃĐ Ã l'obÃĐissance, mais n'obÃĐirait pas qu'à lui seul ; le second pouvait Être fondu, formÃĐ, pÃĐtri à son grÃĐ par ses propres mains. Il se dÃĐcida pour ce dernier parti, rÃĐsolut d'ÃĐcarter les anciennes corporations qui offraient leurs services, qui trouvaient dans son entourage des dÃĐfenseurs zÃĐlÃĐs. Il organisa un corps spÃĐcial, dont les membres devaient contracter des obligations civiles qui les sÃĐparaient momentanÃĐment de la sociÃĐtÃĐ, les constituaient en une sorte de congrÃĐgation laÃŊque, à laquelle revenait exclusivement la charge de l'enseignement dans la France entiÃĻre. A l'avenir, â ainsi l'avait dÃĐcidÃĐ l'empereur, â les proviseurs et les censeurs des lycÃĐes, les principaux et rÃĐgents des collÃĻges, ainsi que les maîtres d'ÃĐtude de ces ÃĐcoles, allaient Être astreints au cÃĐlibat et à la vie commune. Le dÃĐcret qui organisait l'UniversitÃĐ impÃĐriale ne fut promulguÃĐ que le 17 mars 1808. Fontanes fut nommÃĐ grand-maître de la nouvelle institution. C'est lui qui se chargea d'expliquer à diverses reprises à tous les fonctionnaires de l'enseignement l'esprit de la nouvelle lÃĐgislation. ÂŦ Dieu et l'empereur, disait-il dans sa circulaire aux recteurs le 15 janvier 1810, voilà les deux noms qu'il faut graver dans le coeur des enfants ; c'est à cette double pensÃĐe que doit se rapporter tout le systÃĻme de l'ÃĐducation nationale. Âŧ Et dans sa circulaire aux recteurs du 4 avril 1811 il dit : ÂŦ L'UniversitÃĐ n'a pas seulement pour objet de former des orateurs et des savants ; avant tout, elle doit à l'empereur des sujets fidÃĻles et dÃĐvouÃĐs Âŧ. Nous voilà loin de Condorcet, de Romme et de Lakanal ! Dans son plan d'ÃĐtudes, l'UniversitÃĐ impÃĐriale se rapproche encore plus que la loi de 1802 de l'ancien type classique. Le rÃĻglement du 19 septembre 1809 distingue deux annÃĐes de grammaire (cinquiÃĻme et quatriÃĻme), deux annÃĐes d'humanitÃĐs (troisiÃĻme et seconde) et une de rhÃĐtorique, à laquelle s'ajouta bientÃīt celle de philosophie, destinÃĐe d'abord aux lycÃĐes des chefs lieux d'acadÃĐmie, et qui fut installÃĐe peu à peu dans tous les lycÃĐes. L'ÃĐtude du grec commençait avec la quatriÃĻme, celle des mathÃĐmatiques avec la troisiÃĻme. AprÃĻs la rhÃĐtorique, ceux des ÃĐlÃĻves qui se proposaient de se consacrer aux sciences suivaient une classe ÂŦ spÃĐciale Âŧ de mathÃĐmatiques. Un arrÊtÃĐ du 27 mars 1810 institua les classes prÃĐparatoires aux annÃĐes de grammaire, la septiÃĻme et la sixiÃĻme. Ainsi se trouvÃĻrentorganisÃĐes les trois divisions qui subsistent encore : la division ÃĐlÃĐmentaire, la division de grammaire et la division supÃĐrieure. Un dÃĐcret du 15 novembre 1811 porta le nombre des lycÃĐes à cent, chiffre correspondant aux agrandissements qu'avait reçus le territoire français ; les locaux des lycÃĐes devaient Être arrangÃĐs de façon à ce que les lycÃĐes existants pussent contenir 300 ÃĐlÃĻves, les lycÃĐes nouveaux au moins 200. Mais ce dÃĐcret ne fut pas mis à exÃĐcution. Les institutions particuliÃĻres placÃĐes dans les villes oÃđ existait un lycÃĐe ou un collÃĻge ne pouvaient, dit ce mÊme dÃĐcret, enseigner que les premiers ÃĐlÃĐments, et leurs ÃĐlÃĻves devaient suivre, pour les autres classes, le lycÃĐe ou le collÃĻge ; la mÊme obligation ÃĐtait imposÃĐe aux ÃĐlÃĻves des ÃĐcoles secondaires ecclÃĐsiastiques. Les institutions et pensions autorisÃĐes ÃĐtaient tenues de payer à l'UniversitÃĐ un impÃīt ÃĐquivalent au vingtiÃĻme de la rÃĐtribution de leurs ÃĐlÃĻves. Le certificat d'ÃĐtudes, obligeant à faire dans un lycÃĐe les classes de rhÃĐtorique ou de philosophie, achevait de constituer le monopole universitaire et contribuait à amener, de grÃĐ ou de force, des ÃĐlÃĻves dans les classes des lycÃĐes. En 1809, il existait dans les lycÃĐes de France 9068 ÃĐlÃĻves qui se rÃĐpartissaient ainsi : 2141 externes, 4199 boursiers, 1728 pensionnaires. En 1813, on compte 14492 ÃĐlÃĻves : le progrÃĻs est sensible. Quant aux collÃĻges communaux, oÃđ l'instruction ÃĐtait de quelques degrÃĐs infÃĐrieure, ils comptaient 18 507 ÃĐlÃĻves en 1809 et 26 495 en 1813. Ils ÃĐtaient plus prÃĻs des familles, ils coÃŧtaient moins cher, ils donnaient un enseignement plus restreint et probablement plus appropriÃĐ aux nÃĐcessitÃĐs locales. La Restauration et la monarchie de Juillet. â La Restauration n'osa pas dÃĐtruire l'UniversitÃĐ, et Fontanes fut mÊme priÃĐ tout d'abord d'en garder la direction. NÃĐanmoins l'ordonnance du 17 fÃĐvrier 1815 supprima la charge de grand-maître, et remplaça l'UniversitÃĐ unique par dix sept universitÃĐs distinctes ; les lycÃĐes reçurent le nom de collÃĻges royaux. Durant les Cent-Jours, l'UniversitÃĐ impÃĐriale fut rÃĐtablie sur l'ancien pied, avec LacÃĐpÃĻde, puis Lebrun, connue grands-maîtres. AprÃĻs Waterloo, l'ordonnance du 15 aoÃŧt 1815, qui remplaça celle du 17 fÃĐvrier, admit provisoirement la conservation des acadÃĐmies de l'ancienne UniversitÃĐ impÃĐriale, et plaça à la tÊte du corps universitaire une Commission, la Commission de l'instruction publique. En 1820, la Commission lut transformÃĐe en Conseil royal, et CorbiÃĻre, prÃĐsident de ce Conseil, contresigna l'ordonnance du 27 fÃĐvrier 1821, qui livrait l'enseignement public à la ÂŦ CongrÃĐgation Âŧ, et disait : ÂŦ Les bases de l'ÃĐducation des collÃĻges sont la religion, la monarchie, la lÃĐgitimitÃĐ et la charte. L'enseignement des sciences sera sÃĐparÃĐ de celui des lettres. Le cours de philosophie des collÃĻges durera deux ans. Les leçons ne pourront Être donnÃĐes qu'en latin. Âŧ On se mÃĐfiait des sciences et de la philosophie ; on sÃĐquestrait les unes, on les tenait en dehors des humanitÃĐs ; on enfermait l'autre dans les formes de la scolastique, on l'enseignait dans une langue morte qui ne risquait pas d'enflammer les jeunes gens. En 1822, la charge de grand-maître fut rÃĐtablie, et l'abbÃĐ Frayssinous y fut nommÃĐ. Cette annÃĐe-là , l'Ecole normale fut supprimÃĐe. En 1824, une ordonnance augmenta les pouvoirs du grand-maître, et peu aprÃĻs celui-ci reçut le titre de ministre des affaires ecclÃĐsiastiques et de l'instruction publique. En 1828, la domination de la ÂŦ CongrÃĐgation Âŧ ayant ÃĐtÃĐ ÃĐbranlÃĐe par les ÃĐlections de 1827, l'instruction publique fut sÃĐparÃĐe des affaires ecclÃĐsiastiques ; le ministre de l'instruction publique, grand-maître de l'UniversitÃĐ, fut M. de Vatimesnil. Celui-ci fit signer à Charles X l'ordonnance du 26 mars 1829: elle exigeait que les maîtres d'ÃĐtude des collÃĻges royaux fussent tous bacheliers ÃĻs lettres, que les proviseurs et censeurs fussent licenciÃĐs, soit des sciences, soit des lettres. C'ÃĐtait relever le niveau de l'administration. Elle prescrivait, de plus, dans son art. 17, que les mesures nÃĐcessaires fussent prises : 1° pour que l'ÃĐtude des langues vivantes, eu ÃĐgard aux besoins des localitÃĐs, fît partie de l'enseignement dans les collÃĻges royaux ; 2° pour que dans ces mÊmes collÃĻges l'ÃĐtude de l'histoire ne se terminÃĒt que dans la classe de rhÃĐtorique ; 3° pour que la philosophie fÃŧt enseignÃĐe en français. La monarchie de Juillet, issue d'un mouvement libÃĐral, s'appliqua activement à dÃĐvelopper toutes les institutions d'instruction publique. Ce qui caractÃĐrise cette ÃĐpoque, c'est la lutte trÃĻs vive que l'UniversitÃĐ eut à soutenir contre les assauts rÃĐitÃĐrÃĐs du parti catholique, qui rÃĐclamait la libertÃĐ de l'enseignement pour ÃĐtablir, au moyen des ÃĐcoles ecclÃĐsiastiques, une concurrence aux collÃĻges royaux et communaux (Voir LibertÃĐ de l'enseignement). Plusieurs projets de loi sur cette matiÃĻre furent prÃĐsentÃĐs ou discutÃĐs, qui n'aboutirent pas. Le rÃĐgime intÃĐrieur des collÃĻges ne subit, pendant toute cette pÃĐriode, aucune modification importante. Aussi peut-il Être utile de s'y arrÊter un instant et d'examiner quelle ÃĐtait alors la situation de l'enseignement secondaire en France. Villemain, ministre de l'instruction publique, adressa le 3 mars 1843 un rapport au roi sur cet enseignement. C'ÃĐtait la premiÃĻre fois qu'un ÃĐtat gÃĐnÃĐral de situation ÃĐtait dressÃĐ. En 1808, NapolÃĐon avait ordonnÃĐ qu'on lui prÃĐsentÃĒt et mÊme qu'on imprimÃĒt chaque annÃĐe un rapport annuel sur ce sujet ; mais le rapport de Villemain fut le premier travail de cette nature ; et, bien qu'un dÃĐcret du roi eÃŧt ordonnÃĐ que pareil travail fÃŧt dressÃĐ Ã l'avenir tous les cinq ans, il n'y en a eu depuis que deux autres, l'un de Duruy en 1865, l'autre de Bardoux en 1876. ÂŦ L'instruction secondaire, disait Villemain, embrasse les ÃĐtudes de langues anciennes, de lettres, de sciences mathÃĐmatiques et physiques, qui doivent prÃĐparer aux professions savantes, aux grands travaux intellectuels, aux principaux emplois de la sociÃĐtÃĐ. Elle s'adresse particuliÃĻrement à ceux que les sacrifices de leurs familles, ou la libÃĐralitÃĐ de l'Etat et des villes, mettent à mÊme d'appliquer à l'ÃĐtude non seulement toute leur enfance, mais quelques annÃĐes de la jeunesse qui, dans d'autres destinations, sont occupÃĐes dÃĐjà par un travail rÃĐtribuÃĐ. Presque toujours cette instruction attire à elle les enfants que distinguent d'heureuses dispositions ; elle est souvent la seule fortune qu'un homme qui a servi longtemps l'Etat, qu'un officier parvenu lentement aux grades les plus honorables, laisse aux hÃĐritiers de son nom. Elle est, dans notre sociÃĐtÃĐ si favorable à l'ÃĐgalitÃĐ des droits, la base mÊme de cette ÃĐgalitÃĐ, par la concurrence qu'elle prÃĐpare et renouvelle sans cesse, entre le mÃĐrite, pouvant s'ÃĐlever à tout, et la fortune, obligÃĐe de se recommander elle-mÊme par le travail et le savoir. Âŧ Il est intÃĐressant d'entendre l'un des principaux reprÃĐsentants de l'UniversitÃĐ de France, l'un de ceux qui ont le mieux personnifiÃĐ l'esprit et les mÃĐthodes de l'enseignement classique, s'expliquer sur le systÃĻme qui a ÃĐtÃĐ la base de l'instruction secondaire pendant une pÃĐriode de prÃĻs d'un demi-siÃĻcle. La citation est un peu longue, mais elle donne une peinture si exacte et si complÃĻte des ÃĐtudes de collÃĻge par lesquelles ont passÃĐ tant de gÃĐnÃĐrations, qu'il vaut la peine de la faire : ÂŦ Au fond et sur le point principal, c'est l'ancien systÃĻme de Port-Royal et de l'universitÃĐ de Paris, le systÃĻme qui depuis deux siÃĻcles a formÃĐ, pour la magistrature et les affaires, tant d'hommes capables et d'esprits ÃĐclairÃĐs. La crÃĐation de l'UniversitÃĐ, dÃĻs 1808, fut un retour à ce systÃĻme ; et malgrÃĐ des modifications nombreuses et diverses, c'est le caractÃĻre qui prÃĐvaut encore aujourd'hui, et qui s'est mÊme fortifiÃĐ dans ces derniÃĻres annÃĐes. Seulement, à cÃītÃĐ de cette ÃĐtude dominante des tangues anciennes, particuliÃĻrement propre à exercer et mÃŧrir l'esprit, on a fortifiÃĐ l'enseignement historique, et maintenu pour les mathÃĐmatiques des cours diversement graduÃĐs, les uns prÃĐparatoires, les autres dÃĐveloppÃĐs et complets. L'ÃĐtude des langues vivantes a pris, en mÊme temps, une forme plus rÃĐguliÃĻre, qui s'unit aux ÃĐtudes classiques, au lieu d'en distraire. ÂŦ Les maîtres profitent de toutes les occasions qui se prÃĐsentent pour rappeler aux ÃĐlÃĻves ce qu'ils doivent à Dieu, à leurs parents, au Roi et à leur pays (Statut des collÃĻges royaux et communaux). ÂŦ Dans les classes infÃĐrieures, presque toujours prÃĐcÃĐdÃĐes de classes ÃĐlÃĐmentaires, l'enseignement comprend des ÃĐtudes de grammaire française, latine et grecque, des exercices de mÃĐmoire, des explications d'auteurs, des essais de traduction, des notions de calcul, des leçons sur l'histoire sainte, sur l'histoire ancienne, sur l'histoire romaine et 3ur la gÃĐographie qui s'y rapporte. ÂŦ L'ÃĐtude des langues modernes commence en quatriÃĻme. ÂŦ La troisiÃĻme et la seconde sont presque exclusivement consacrÃĐes à cette ÃĐtude des langues anciennes qui, par le travail de l'explication et de la traduction, devient un exercice perpÃĐtuel de raisonnement, une ÃĐpreuve continue d'exactitude et de sagacitÃĐ. ÂŦ La part trop considÃĐrable faite, il y a quelques annÃĐes, dans ces classes, à la gÃĐomÃĐtrie, est retranchÃĐe, sans que, toutefois, pour le plus grand nombre des ÃĐlÃĻves, les notions ÃĐlÃĐmentaires de cette science soient interrompues. Les ÃĐtudes historiques, rÃĐparties dans un ordre mÃĐthodique, donnent appui à l'instruction littÃĐraire, qui fait le fond de ces cours. ÂŦ Le caractÃĻre de cette instruction est dÃĐterminÃĐ par le nombre et le choix des modÃĻles. Ce sont quelques courts chefs-d'oeuvre de l'antiquitÃĐ grecque et latine. Quelques fragments des PÃĻres grecs s'y mÊlent à des textes de DÃĐmosthÃĻne et de Platon. Le gÃĐnie de Home, exprimÃĐ par ses grands historiens, se retrouve encore dÃĐcrit et expliquÃĐ par Bossuet. Les premiÃĻres leçons de goÃŧt sont empruntÃĐes à FÃĐnelon. Nos classiques français y paraissent dans une proportion plus grande qu'autrefois. ÂŦ Le cours de rhÃĐtorique achÃĻve cette suite de lectures, en y ajoutant le travail de la composition. Dans ce cours, prolongÃĐ pendant deux annÃĐes par quelques ÃĐlÃĻves, à de fortes ÃĐtudes d'antiquitÃĐ et à la mÃĐditation assidue des modÃĻles les plus purs du gÃĐnie français, se joint aujourd'hui une ÃĐtude spÃĐciale de l'histoire de France. ÂŦ L'annÃĐe de philosophie donne à l'intelligence plus exercÃĐe des ÃĐlÃĻves un nouveau travail de rÃĐflexion. Le programme de ce cours embrasse, avec les rÃĻgles de la logique, tous les grands principes de psychologie, de morale et de thÃĐodicÃĐe. Quelques ouvrages de Platon, d'Aristote et de CicÃĐron. Parmi les modernes, à partir de Bacon jusqu'à Reid, les principaux ouvrages qui ont marquÃĐ l'effort, le progrÃĻs., Descartes, Malebranche, Arnaud, Bossuet et FÃĐnelon ; Clarke, Buffon, Locke, Leibnitz, Euler. ÂŦ Une partie de l'annÃĐe de philosophie est appliquÃĐe à des ÃĐtudes de mathÃĐmatiques, de physique, de chimie et d'histoire naturelle. Cette variÃĐtÃĐ d'objets ne permet pas une ÃĐtude approfondie de chacun, mais elle donne de tous une connaissance sommaire, suffisante pour former cette instruction gÃĐnÃĐrale qui convient aux hommes ÃĐclairÃĐs de notre temps. ÂŦ Ceux qui ont besoin de pÃĐnÃĐtrer plus avant trouvent, dans une seconde annÃĐe consacrÃĐe tout entiÃĻre aux mathÃĐmatiques et à la physique, une prÃĐparation complÃĻte au programme de l'Ecole polytechnique. ÂŦ Pour les autres ÃĐlÃĻves, destinÃĐs soit à des professions de la sociÃĐtÃĐ dans lesquelles l'instruction classique n'est pas nÃĐcessaire, soit à des services publics oÃđ on est admis trop jeune pour y porter cette instruction, les classes de lettres et de philosophie sont remplacÃĐes par un enseignement plus court, qui a ÃĐgalement pour objet de former le jugement et le langage. Âŧ En 1843, le nombre des collÃĻges royaux ÃĐtait de 46 ; il y avait 36 lycÃĐes en 1812. L'augmentation n'avait donc ÃĐtÃĐ que de dix en trente annÃĐes. Dans la premiÃĻre pensÃĐe de Bonaparte (loi du 11 florÃĐal an X), la crÃĐation des lycÃĐes entraînait pour le TrÃĐsor une charge de 4 millions reprÃĐsentÃĐe par 6400 bourses entiÃĻres. Cette charge a baissÃĐ peu à peu par suite de la diminution des bourses ; la dÃĐpense de l'Etat n'ÃĐtait plus, à la fin de l'empire, que de 1 900 000 francs. En 1843 elle ÃĐtait de 1 940 477 francs. L'ensemble des ressources des collÃĻges royaux se composait de leurs revenus propres, de la subvention fixe votÃĐe au budget pour les traitements et pour les bourses, de crÃĐdits pour les bourses allouÃĐes par les communes ou les dÃĐpartements, des rÃĐtributions des internes et des externes. Le total des recettes des 46 collÃĻges royaux en 1842 ÃĐtait de 8 600 000 francs. Le personnel des collÃĻges se partageait en deux sortes de fonctions principales, et il n'y a rien de changÃĐ Ã cet ÃĐgard : les fonctions d'administration ou de direction, et les fonctions de l'enseignement. Le proviseur gouverne l'ÃĐtablissement, est responsable de tout, et a sous ses ordres, pour la gestion matÃĐrielle, un ÃĐconome choisi d'aprÃĻs des conditions dÃĐterminÃĐes d'aptitude (ordonnance du 1" novembre 1837), obligÃĐ au dÃĐpÃīt d'un cautionnement, et comptable envers la Cour des comptes. Sous l'autoritÃĐ du proviseur, le censeur est plus spÃĐcialement chargÃĐ de la surveillance des ÃĐtudes et de la discipline ; il a, pour l'aider, un surveillant gÃĐnÃĐral. Le personnel enseignant ÃĐtait ainsi constituÃĐ : L'aumÃīnier ; les professeurs en nombre ÃĐgal au nombre des classes ou subdivisions ; ils ÃĐtaient partagÃĐs en trois ordres : 1° Professeurs de philosophie, rhÃĐtorique, physique et mathÃĐmatiques spÃĐciales ; 2° Professeurs d'histoire et d'humanitÃĐs ; 3° Professeurs de mathÃĐmatiques ÃĐlÃĐmentaires et de grammaire. Il faut ajouter, mais à un rang qui ÃĐtait tout à fait secondaire, les professeurs de langues vivantes, puis ceux de dessin, de musique, etc. Les fonctions de maîtres d'ÃĐtude tiennent à la fois de l'administration et de l'enseignement. A partir de 1830, la rÃĻgle des grades, jusqu'alors assez flottante, est devenue absolument obligatoire. Aucun emploi n'a ÃĐtÃĐ accordÃĐ depuis lors dans l'UniversitÃĐ sans la condition prÃĐalable d'un diplÃīme correspondant. Sur 1216 fonctionnaires de l'administration ou de l'enseignement dans les 46 collÃĻges royaux, en 1843, 324 ÃĐtaient licenciÃĐs ÃĻs lettres, 52 docteurs ÃĻs lettres, 116 licenciÃĐs ÃĻs sciences, 27 docteurs ÃĻs sciences, 385 agrÃĐgÃĐs ; les autres, bacheliers travaillant à obtenir la licence. A cÃītÃĐ des lycÃĐes, la loi du 11 florÃĐal an X avait, comme nous l'avons dit, placÃĐ les ÃĐcoles secondaires. Un assez grand nombre de ces ÃĐcoles furent ÃĐtablies par les communes dans les bÃĒtiments d'anciens collÃĻges supprimÃĐs aprÃĻs 1792. Elles ÃĐtaient placÃĐes sous l'inspection des prÃĐfets. Le ministre de l'intÃĐrieur en nommait les directeurs et les principaux fonctionnaires. A la crÃĐation de l'UniversitÃĐ, elles entrÃĻrent dans le cadre de cet ÃĐtablissement : le dÃĐcret du 17 mars 1808 leur donnait le nom de collÃĻges. On les appela collÃĻges communaux, lorsque les lycÃĐes prirent le nom de collÃĻges royaux. Le nombre de ces ÃĐtablissements avait peu variÃĐ de 1812 à 1842 ; il avait plutÃīt baissÃĐ dans cette pÃĐriode : de 337 il ÃĐtait tombÃĐ Ã 312. Cela tenait en partie à ce que, avant 1830, la dotation pouvait Être portÃĐe d'office au budget des villes, tandis que depuis elle est devenue facultative. Il faut ajouter, nÃĐanmoins, que le nombre des ÃĐlÃĻves y avait augmentÃĐ. L'autoritÃĐ publique surveillait la direction des collÃĻges communaux comme celle des collÃĻges royaux. Elle en nommait tous les fonctionnaires. Un bureau d'administration, composÃĐ de membres du conseil municipal et d'autres notables, siÃĐgeait prÃĻs de chaque collÃĻge communal, dressait le budget, veillait au bien-Être des ÃĐlÃĻves, indiquait les amÃĐliorations nÃĐcessaires. Les bÃĒtiments devaient Être fournis et entretenus par les communes. Elles pouvaient administrer leurs collÃĻges en rÃĐgie à leur compte ; elles ÃĐtaient aussi autorisÃĐes à cÃĐder la gestion du pensionnat au principal à ses risques et pÃĐrils ; c'ÃĐtait le mode le plus habituel. Les collÃĻges communaux ÃĐtaient divisÃĐs en deux ordres : 1° Ceux de plein exercice ; 2° Ceux qui offraient la partie infÃĐrieure de l'enseignement classique et les connaissances prÃĐparatoires qui pouvaient suffire aux professions oÃđ cet enseignement n'ÃĐtait pas exigÃĐ. L'ordonnance du 29 janvier 1839 ÃĐtablit un minimum pour les traitements, qui jusque-là n'avaient rien de fixe ni d'uniforme. Ce minimum ÃĐtait de 2400 francs pour la fonction la plus ÃĐlevÃĐe, de 1400 pour la moindre dans les collÃĻges de plein exercice. Or, ce minimum, en 1843, n'ÃĐtait atteint que par 235 fonctionnaires sur 1370. Dans les collÃĻges de second ordre, il ÃĐtait fixÃĐ de 1200 à 2000 francs, et là n'ÃĐtait atteint par aucun fonctionnaire. Le nombre entier des fonctionnaires en 1843, dans les collÃĻges communaux, ÃĐtait de 2538 (sur lesquels 165 ecclÃĐsiastiques soit comme principaux, soit comme rÃĐgents). La moyenne du traitement pour chacun n'excÃĐdait pas 1200 francs. Cette modicitÃĐ des traitements ne nuisait pas au zÃĻle des maîtres universitaires ; l'ensemble des ÃĐtudes ÃĐtait bon, le niveau s'ÃĐlevait, le progrÃĻs ÃĐtait sensible. Le nombre des ÃĐlÃĻves des collÃĻges communaux, qui ÃĐtait de 18 554 en 1816, ÃĐtait montÃĐ Ã 22 969 en 1833 et à 26 584 en 1842. L'augmentation se produisait ÃĐgalement dans les collÃĻges royaux à la mÊme ÃĐpoque, ils comptaient une population scolaire de 18697 ÃĐlÃĻves, dont 8030 pensionnaires et 10 667 externes. Cette prospÃĐritÃĐ dÃĐsolait le parti clÃĐrical. De 1848 à 1870. â La rÃĐaction, triomphante en 1850, profita de son succÃĻs pour porter à l'UniversitÃĐ des coups qu'elle crut dÃĐcisifs. La loi de 1850 ÃĐtablissait victorieusement l'enseignement congrÃĐganiste, sans garantie d'aucun genre, à cÃītÃĐ, en face, au-dessus de l'enseignement universitaire. Non seulement les ennemis de l'UniversitÃĐ lui crÃĐÃĻrent une concurrence redoutable par toutes les ressources d'argent, d'influence, de sÃĐduction et d'intimidation dont ils disposaient, mais encore ils pÃĐnÃĐtrÃĻrent dans la place, s'installÃĻrent dans ses conseils, cherchÃĻrent à bouleverser ses mÃĐthodes. Fortoul, ministre de l'instruction publique de 1851 à 1856, s'est signalÃĐ par diverses mesures qui ont profondÃĐment atteint le rÃĐgime universitaire. C'est à lui qu'est dÃŧ le dÃĐcret du 10 avril 1852, dont la principale disposition consistait en ceci : Les lycÃĐes (c'est le nom que les collÃĻges royaux avaient repris en 1848, et qu'ils ont gardÃĐ depuis lors) devaient comprendre dÃĐsormais deux divisions : 1° Celle de grammaire, commune à tous les ÃĐlÃĻves jusqu'à la quatriÃĻme inclusivement ; 2° La division supÃĐrieure, partagÃĐe en deux enseignements distincts, les lettres et les sciences. C'est ce qu'on a appelÃĐ la bifurcation. En sortant de la classe de quatriÃĻme, les ÃĐlÃĻves ÃĐtaient appelÃĐs à faire un choix entre les lettres et les sciences, à dÃĐcider de l'orientation de leur vie, à choisir leur carriÃĻre, à rompre à peu prÃĻs entiÃĻrement avec l'une ou l'autre branche de l'enseignement public. Sans doute, on essayait bien de conserver çà et là quelque classe commune aux ÃĐlÃĻves de lettres et de sciences ; mais l'essai ne fut pas heureux, le niveau ÃĐtait trop diffÃĐrent, et chaque section en ÃĐtait arrivÃĐe vite à mÃĐpriser les ÃĐtudes de l'autre section. Les sciences n'y gagnÃĻrent pas ce que les lettres y perdirent ; les mauvais ÃĐlÃĻves, les paresseux, les ÃĐtourdis, fatiguÃĐs de la grammaire, des langues, se hÃĒtaient d'opter pour un changement dont ils espÃĐraient plus d'agrÃĐment ou moins de travail ; ils nÃĐgligeaient mÊme leurs ÃĐludes classiques dans la division de grammaire, supposant qu'elles ÃĐtaient bien inutiles en vue de l'ÃĐtude des sciences. Il y eut des hÃĐsitations, des regrets, des retours de la part des ÃĐlÃĻves ou des parents, les uns et les autres incapables de prononcer sur les aptitudes et l'avenir des enfants d'une façon prÃĐmaturÃĐe et dÃĐcisive. L'esprit des prÃĐtendus rÃĐformateurs de cette triste ÃĐpoque se manifeste clairement dans le rapport du ministre : ÂŦ Les discussions historiques et philosophiques, disait-il, conviennent peu à des enfants. Lorsque l'intelligence n'est pas formÃĐe, ces recherches intempestives ne produisent que la vanitÃĐ et le doute ; il est temps de couper dans sa racine un mal qui a compromis l'enseignement public et a excitÃĐ les justes alarmes des familles. Âŧ Il faut noter qu'il s'agissait ici des exercices des plus hautes classes, destinÃĐes à des jeunes gens de seize à dix-neuf ans. En consÃĐquence de ces principes, la philosophie ÃĐtait supprimÃĐe et remplacÃĐe par une annÃĐe de logique, ayant simplement pour objet ÂŦ l'exposition des opÃĐrations de l'entendement et l'application des principes gÃĐnÃĐraux de l'art de penser à l'ÃĐtude des sciences et des lettres Âŧ. On redescendait au-dessous de la Restauration et de M. de Vatimesnil. En revanche, les professeurs des lycÃĐes recevaient l'ordre formel et sans rÃĐplique d'avoir à raser leurs moustaches et à ne jamais faire leurs leçons sans robe. Le ministÃĻre de Rouland, de 1856 à 1863, ne changea presque rien à cet ÃĐtat de choses. Il fallut arriver au ministÃĻre vraiment rÃĐparateur de Victor Duruy pour entrer dans une ÃĻre de rÃĐformes. Membre ÃĐminent de l'UniversitÃĐ, Duruy savait aussi bien que personne le mal que ses prÃĐdÃĐcesseurs avaient fait, et il s'est appliquÃĐ, avec un zÃĻle digne d'ÃĐloges, à relever les ÃĐtudes, à perfectionner les programmes, à donner aux lycÃĐes et aux collÃĻges une vie nouvelle. A peine arrivÃĐ au pouvoir, il supprimait ou du moins retardait la bifurcation : par le dÃĐcret du 2 septembre 1863, il rÃĐtablissait pour les ÃĐlÃĻves de troisiÃĻme la communautÃĐ des ÃĐtudes littÃĐraires et scientifiques et reportait dans la classe de seconde le point de sÃĐparation. Un an aprÃĻs, le dÃĐcret du 4 dÃĐcembre 1864 supprimait les classes dites seconde scientifique, rhÃĐtorique scientifique et philosophie scientifique. L'organisation normale des lycÃĐes devait Être à l'avenir : 1° les classes ordinaires d'humanitÃĐs, avec un enseignement scientifique plus fort, ayant pour sanction le baccalaurÃĐat ÃĻs lettres ; 2° ces mÊmes classes, suivies d'une classe de mathÃĐmatiques ÃĐlÃĐmentaires, conduisant au baccalaurÃĐat ÃĻs sciences. Quant à ceux des ÃĐlÃĻves qui voulaient interrompre, avant la fin, leurs ÃĐtudes d'humanitÃĐs, ils devaient trouver, dans une classe de mathÃĐmatiques prÃĐparatoires, les ÃĐtudes littÃĐraires que rÃĐclament le baccalaurÃĐat ÃĻs sciences et les examens d'admission aux grandes ÃĐcoles. DÃĻs les premiers jours de son ministÃĻre, M. Duruy avait rÃĐtabli l'agrÃĐgation de philosophie et rouvert la classe de philosophie clans les lycÃĐes et collÃĻges. De plus, il instituait, dans cette mÊme classe de philosophie un cours nouveau d'histoire contemporaine, qui devait s'ÃĐtendre de 1789 jusqu'à nos jours. Innovation hardie qu'il justifiait ainsi dans une circulaire aux recteurs : ÂŦ Il faut que ceux qui, dans quelques annÃĐes, feront les affaires du pays, sachent de quelle maniÃĻre ce pays a vÃĐcu jusqu'à prÃĐsent. Notre sociÃĐtÃĐ actuelle, avec son organisation et ses besoins, date de la RÃĐvolution, et pour la bien comprendre, comme pour la bien servir, il faut la bien connaître. ÂŦ J'ai introduit dans l'histoire des idÃĐes et des ÃĐvÃĐnements de ce siÃĻcle quelques notions d'ÃĐconomie politique. Depuis un siÃĻcle que les ÃĐconomistes sont à l'oeuvre, ils ont mis en lumiÃĻre un certain nombre de vÃĐritÃĐs que personne ne conteste plus, et dont l'ÃĐducation doit dÃĐjà s'emparer, au profit de nos ÃĐlÃĻves et du pays. ÂŦ GrÃĒce à cet enseignement, nos ÃĐlÃĻves, en sortant du lycÃĐe, ne tomberont plus dans l'inconnu. Nous leur aurons montrÃĐ le terrain oÃđ, jusqu'à cette heure, ils marchaient sans guide, et nous lÃĐs aurons mis en ÃĐtat de comprendre les ÃĐvÃĐnements au milieu desquels la vie sÃĐrieuse vient les surprendre. Jeter un jeune homme dans la citÃĐ sans lui avoir rien dit de l'organisation et des nÃĐcessitÃĐs qu'il y rencontre, c'est comme si l'on jetait dans la bataille un chasseur à pied avec l'armement des francs-archers de Charles VII. Âŧ Une place plus importante fut accordÃĐe aux langues vivantes, assez dÃĐlaissÃĐes jusque-là . Au lieu de les retarder jusqu'à l'ÃĒge de quatorze et quinze ans, on les commença avec les jeunes enfants, ÂŦ dont les organes plus souples se prÊtent à rendre tous les sons, et dont l'esprit encore peu exigeant retient les mots plus aisÃĐment que les idÃĐes Âŧ. On donna une place aux langues vivantes dans les compositions du concours gÃĐnÃĐral et dans l'examen du baccalaurÃĐat, ce qui ÃĐtait l'un des moyens les plus efficaces de les arracher au discrÃĐdit dans lequel elles ÃĐtaient tombÃĐes. Enfin le dÃĐcret du 27 novembre 1863 ÃĐtablit une agrÃĐgation spÃĐciale des langues vivantes. Tant d'efforts furent couronnÃĐs de succÃĻs. Le nombre des ÃĐlÃĻves croissait tous les ans. A la rentrÃĐe des classes d'octobre 1868, la population scolaire dans les lycÃĐes et collÃĻges de la France s'ÃĐtait accrue sur l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente de 283b ÃĐlÃĻves, dont 1695 pour les lycÃĐes et 1140 pour les collÃĻges. Le nombre total des ÃĐlÃĻves ÃĐtait de 71 594 pour 81 lycÃĐes (soit 20 de plus qu'en 1848) et 251 collÃĻges. Le niveau des ÃĐtudes montait ÃĐgalement. Duruy raconte quelque part qu'il a fait faire, en 1864, un examen des compositions des laurÃĐats du grand concours de la Sorbonne depuis 1830. La ÂŦ courbe gÃĐomÃĐtrique du mouvement des ÃĐtudes Âŧ durant cette sÃĐrie d'annÃĐes a donnÃĐ le rÃĐsultat suivant : de 1830 à 1840, oscillation sans caractÃĻre dÃĐterminÃĐ ; de 1841 à 1851, marche ascensionnelle ; de 1852 à 1859, dÃĐcadence gÃĐnÃĐrale dans les sciences aussi bien que dans les lettres, sauf pour une facultÃĐ, l'histoire. A partir de 1859, la courbe abaissÃĐe se relÃĻve, et l'on commence à regagner une partie du terrain perdu. C'est le moment oÃđ l'on se relÃĒche des prescriptions Fortoul ; les rÃĐformes du ministÃĻre Duruy ont fortement contribuÃĐ Ã faire remonter la pente. Enseignement secondaire spÃĐcial. â L'enseignement secondaire spÃĐcial, qui prit une si grande place dans les collÃĻges et dans plusieurs lycÃĐes, dont quelques-uns lui ÃĐtaient mÊme entiÃĻrement consacrÃĐs, doit son origine lÃĐgale et son organisation à Duruy. DÃĐjà , le 28 dÃĐcembre 1846, M. de Salvandy chargeait la facultÃĐ des sciences de Paris de constater l'ÃĐtat de l'enseignement scientifique dans les ÃĐtablissements universitaires et de lui faire connaître ÂŦ quels complÃĐments cet enseignement devrait recevoir pour conduire le pays en avant, selon ses instincts, dans toutes les voies de l'industrie, du travail et de la science Âŧ. La commission choisie insista sur la nÃĐcessitÃĐ de donner à l'enseignement des sciences une direction plus pratique, de diminuer la part faite aux subtilitÃĐs des mathÃĐmatiques et d'accroître la part de l'ÃĐlÃĐment scientifique dans le baccalaurÃĐat ÃĻs lettres. Dans un arrÊtÃĐ du 5 mars 1847, le ministre essayait de faire droit à ces observations. ÂŦ Il faudrait, disait-il, dans les collÃĻges royaux et communaux, sous le nom d'enseignement spÃĐcial, un cours triennal, distinct de l'enseignement littÃĐraire et parallÃĻle à cet enseignement, oÃđ les ÃĐlÃĻves seraient admis aprÃĻs la quatriÃĻme. Âŧ On essaya aux collÃĻges Charlemagne et Bourbon ; mais, peu à peu, ces cours d'enseignement spÃĐcial finirent par ressembler aux cours de français dÃĐjà annexÃĐs à la plupart des collÃĻges de province. L'idÃĐe fut reprise par Duruy. Il conçut le projet de prÃĐciser l'enseignement professionnel, vaguement ÃĐbauchÃĐ en 1829 et en 1847, ou plutÃīt d'organiser dans les lycÃĐes et dans les collÃĻges un enseignement nouveau, non intermÃĐdiaire entre l'ÃĐcole primaire et l'instruction secondaire et destinÃĐ Ã faire passer les esprits de l'une à l'autre, mais supÃĐrieur à l'ÃĐcole primaire et parallÃĻle à l'instruction classique. Ce n'ÃĐtait autre chose que l'enseignement primaire supÃĐrieur, tel que l'avait conçu M. Guizot, mais non pas livrÃĐ au hasard, aux caprices ou aux ressources des communes, sans secours, sans unitÃĐ et sans guide. De fait, on sait de quelle façon incomplÃĻte, incohÃĐrente, insuffisante cet enseignement primaire supÃĐrieur s'ÃĐtait ÃĐtabli dans notre pays. Alors que les Realschulen ont eu en Allemagne un si complet succÃĻs et ont rendu de si grands services, nos ÃĐcoles primaires supÃĐrieures, inscrites dans la loi du 28 juin 1833, passÃĐes sous silence par la loi de 1850, ÃĐtaient restÃĐes, sauf de trÃĻs rares exceptions, à l'ÃĐtat de projet et d'espÃĐrance. Duruy pensa qu'il fallait introduire cet enseignement dans les ÃĐtablissements d'Etat dÃĐjà existants, lui donner la cohÃĐsion et l'unitÃĐ, profiter des locaux, de l'administration, des ressources dÃĐjà disponibles. Tel fut l'objet de la loi du 21 juin 1865 : Voir Lois scolaires, p. 1087. L'article 8 spÃĐcifie expressÃĐment que la nouvelle loi ne fait pas obstacle à ce que les ÃĐcoles primaires supÃĐrieures, ÃĐtablies en vertu de la loi de 1833, continuent d'exister. Cet article ÃĐtait d'autant plus nÃĐcessaire que ces deux genres d'ÃĐtablissement n'ont au fond qu'un seul et mÊme enseignement ÂŦ Cette loi, disait Duruy dans un de ses discours, permettra d'organiser enfin le mode d'instruction propre à un temps oÃđ la science transforme incessamment l'agriculture, l'industrie, le commerce, et que rÃĐclamait cette foule qui, pour mieux exÃĐcuter les travaux des champs, du comptoir ou de l'usine, veut aller plus loin que l'ÃĐcole primaire, sans aller aussi haut que le lycÃĐe. Âŧ Dans l'instruction aux recteurs, relative à l'organisation du nouvel enseignement, il faisait ces remarques à propos des programmes : ÂŦ Lorsqu'un ÃĐlÃĻve entre au lycÃĐe, c'est pour en suivre successivement toutes les classes. Nous sommes donc assurÃĐs de son attention et de son travail pour sept ou huit ans, et nous disposons nos mÃĐthodes en consÃĐquence. Presque tous les fruits de l'enseignement classique seraient perdus pour celui qui n'achÃĻverait pas le cours entier des ÃĐtudes du lycÃĐe. Mais l'enseignement spÃĐcial a ÃĐtÃĐ instituÃĐ en faveur des enfants qui ne peuvent disposer d'un assez gros capital de temps et d'argent. Beaucoup n'iront pas jusqu'à la fin des cours ; quelques-uns mÊme n'y resteront qu'une annÃĐe ou deux. Il a donc fallu distribuer les matiÃĻres de cet enseignement de telle sorte que chaque annÃĐe d'ÃĐtudes formÃĒt un tout complet en soi, et que les plus indispensables fussent placÃĐes dans les premiers cours. Les ÃĐludes des diverses annÃĐes consacrÃĐes à cet enseignement formeront ainsi comme un ensemble de cercles concentriques d'un rayon plus grand à chaque cours nouveau. Âŧ L'enseignement littÃĐraire occupait plus de place dans les premiÃĻres annÃĐes, tandis que l'importance des ÃĐtudes scientifiques allait croissant avec l'ÃĒge des ÃĐlÃĻves ; le dessin prenait quatre heures par semaine dans les trois premiÃĻres annÃĐes et six dans les deux derniÃĻres ; la durÃĐe commune des classes ÃĐtait rÃĐduite à une heure, afin de n'ÃĐpuiser ni les forces des maîtres ni l'attention des ÃĐlÃĻves (elle ÃĐtait gÃĐnÃĐralement de deux heures dans l'enseignement classique) ; enfin, les programmes reprÃĐsentaient si bien l'enseignement primaire supÃĐrieur, que le ministre dÃĐclarait les avoir dÃĐveloppÃĐs de maniÃĻre à pouvoir servir de sommaires dans les cours supÃĐrieurs des classes d'adultes. De plus, il recommandait qu'on habituÃĒt les ÃĐlÃĻves à manier quelques outils, ÂŦ non pas en vue de leur apprendre un mÃĐtier, mais afin que leur main, exercÃĐe à tenir le marteau ou la lime, fÃŧt prÊte pour les travaux de l'apprentissage, comme leur esprit pour ceux du bureau ou du laboratoire Âŧ. Si l'ÃĐcole primaire supÃĐrieure n'avait pas prospÃĐrÃĐ, c'est que tout lui manquait, locaux, ressources, direction et maîtres spÃĐciaux. Pour fournir des professeurs, sans lesquels la nouvelle crÃĐation fÃŧt restÃĐe lettre morte, le ministre fonda l'ÃĐcole normale de Cluny (Voir Cluny), institua un brevet de sortie, et crÃĐa mÊme une agrÃĐgation spÃĐciale, ÂŦ afin que est ordre d'enseignement eÃŧt, comme tous les autres, son couronnement Âŧ (DÃĐcret du 28 mars 1866). Un dÃĐcret du 25 septembre 1872 assimila plus tard les professeurs agrÃĐgÃĐs de l'enseignement spÃĐcial aux chargÃĐs de cours de l'enseignement classique. En 1868, l'ÃĐtablissement de Cluny renfermait dÃĐjà 170 ÃĐlÃĻves-maîtres et 300 jeunes ÃĐlÃĻves dans le collÃĻge annexÃĐ. Une troisiÃĻme annÃĐe d'ÃĐtudes, destinÃĐe spÃĐcialement aux candidats à l'agrÃĐgation, comprenait 24 ÃĐlÃĻves. IndÃĐpendamment des brevets de capacitÃĐ dÃĐcernÃĐs aux ÃĐlÃĻves de Cluny, les jurys d'examen dÃĐlivrÃĻrent, dans les sessions de cette mÊme annÃĐe, le certificat d'ÃĐtudes à 123 candidats sur 160, et le brevet de capacitÃĐ Ã 16 sur 40. Au concours pour l'agrÃĐgation spÃĐciale de 1869, neuf ÃĐlÃĻves de Cluny obtinrent le litre d'agrÃĐgÃĐ: parmi les concurrents se trouvaient des ÃĐlÃĻves de l'Ãcole centrale. A la rentrÃĐe de 1868, l'enseignement spÃĐcial comptait dans les lycÃĐes 7034 ÃĐlÃĻves, soit 650 de plus que l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente, et dans les collÃĻges communaux 11 429, soit plus du tiers de leur population totale. En ajoutant la population scolaire des lycÃĐes à celle des collÃĻges, on trouve que 18 463 ÃĐlÃĻves, ou plus du quart de la totalitÃĐ, suivaient alors les cours de l'enseignement spÃĐcial. Le lycÃĐe de Mont-de-Marsan, consacrÃĐ exclusivement à cet ordre d'enseignement, devenait insuffisant pour le nombre d'ÃĐlÃĻves qui affluaient ; il fallut lui donner comme succursale le collÃĻge communal de Saint-Sever. Plusieurs collÃĻges se modifiÃĻrent dans le mÊme sens. Le voeu du ministre ÃĐtait que la plupart des villes en vinssent à transformer peu à peu leurs collÃĻges en ÃĐtablissements d'enseignement secondaire spÃĐcial : ÂŦ Ce changement, disait-il, est la seule voie de salut pour le plus grand nombre de nos collÃĻges communaux. Savez-vous ce qu'ils coÃŧtent annuellement? â Plus de onze millions. â Ce qu'ils rapportent? â 253 bacheliers ÃĻs lettres!Âŧ La statistique officielle de l'enseignement secondaire faite en 1876, dix ans aprÃĻs la loi Duruy, constata que l'enseignement secondaire spÃĐcial, ÃĐtait organisÃĐ dans tous les lycÃĐes, sauf cinq de la ville de Paris, qu'il y ÃĐtait donnÃĐ par 325 maîtres, dont 65 professeurs titulaires (presque tous agrÃĐgÃĐs), 140 chargÃĐs de cours, et 120 maîtres ÃĐlÃĐmentaires (parmi lesquels 69 instituteurs). Il comptait 8696 ÃĐlÃĻves sur les 40 995 ÃĐlÃĻves que possÃĐdaient les 81 lycÃĐes au 31 dÃĐcembre 1876. Depuis la premiÃĻre organisation, en 1865, l'enseignement secondaire spÃĐcial avait gagnÃĐ 3694 ÃĐlÃĻves, soit en moyenne 71 par lycÃĐe. Dans les 248 collÃĻges oÃđ il ÃĐtait organisÃĐ en 1876, il comprenait 527 chaires, ce qui, en y ajoutant les leçons des principaux et des maîtres d'ÃĐludes, donnait un total de 647 professeurs, dont les traitements variaient de 400 à 2500 francs. Parmi ces professeurs, on remarquait 12 licenciÃĐs, 107 bacheliers, 68 brevetÃĐs de Cluny, 34 brevetÃĐs de l'enseignement spÃĐcial, et 347 instituteurs. Les ÃĐlÃĻves de cet enseignement dans les collÃĻges ÃĐtaient au nombre de 14 012, sur une population scolaire de 38236, soit une augmentation de 2132 ÃĐlÃĻves de l'enseignement spÃĐcial depuis 1865. L'enseignement secondaire spÃĐcial fut complÃĐtÃĐ et amÃĐliorÃĐ dans les annÃĐes suivantes, en particulier par le dÃĐcret du 4 aoÃŧt 1881 et par le nouveau plan d'ÃĐtudes du 28 juillet 1882. Voici comment le sous-secrÃĐtaire d'Etat à l'instruction publique, M. EugÃĻne Durand, rÃĐsumait ce plan dans un discours prononcÃĐ le 4 novembre 1883, à Tourcoing, pour l'inauguration du nouveau lycÃĐe consacrÃĐ exclusivement à cet ordre d'instruction : ÂŦ L'enseignement secondaire spÃĐcial comprend aujourd'hui trois cycles. Le premier correspond aux classes ÃĐlÃĐmentaires de l'enseignement classique, et se rÃĐsume, pour ceux qui ont jusque-là suivi l'ÃĐcole primaire, en une seule annÃĐe de prÃĐparation particuliÃĻre. C'est là la pÃĐriode d'initiation. Avec le deuxiÃĻme cycle commence, sous le nom de cours moyen, l'enseignement spÃĐcial proprement dit, que, sous le nom de cours supÃĐrieur, complÃĐtera et fortifiera ensuite le troisiÃĻme cycle. ÂŦ Le cours moyen comprendra trois annÃĐes ; il suffira à ceux que pressent les nÃĐcessitÃĐs de la vie et qu'appellent immÃĐdiatement les professions agricoles, commerciales et industrielles. Le cours supÃĐrieur sera de deux annÃĐes ; il sera suivi par ceux qui ont l'ambition d'une culture intellectuelle plus ÃĐlevÃĐe, et ses programmes seront assez riches pour former des esprits cultivÃĐs et solides. L'un et l'autre auront d'ailleurs leur sanction. Ils seront couronnÃĐs, le premier par un certificat d'ÃĐtudes qui aura sa valeur, car il sera la preuve d'ÃĐtudes sÃĐrieuses suivies avec fruit ; le second, par un diplÃīme de bachelier, par le baccalaurÃĐat de l'enseignement secondaire spÃĐcial, qui sera, dans la plupart des cas, l'ÃĐquivalent du diplÃīme de bachelier ÃĻs sciences, et qui ne lardera pas à Être aussi recherchÃĐ que lui. Âŧ En rÃĐalitÃĐ, ce baccalaurÃĐat de l'enseignement spÃĐcial ne fut jamais recherchÃĐ : la clientÃĻle de cet enseignement ne visait pas aux diplÃīmes. Elle allait chercher dans les lycÃĐes et collÃĻges qui lui ÃĐtaient ouverts des connaissances pratiques et immÃĐdiatement utilisables : rudiments de français, de langues ÃĐtrangÃĻres, de calcul, de comptabilitÃĐ, de gÃĐographie, es cours infÃĐrieur et moyen ÃĐtaient surpeuplÃĐs, le cours supÃĐrieur dÃĐsert. Introduit dans les lycÃĐes à dÃĐfaut d'ÃĐcoles primaires supÃĐrieures capables de le donner, cet enseignement, qui ne fut jamais secondaire, mais utilitaire, commercial, professionnel, devait disparaître et disparut le jour oÃđ les ÃĐcoles primaires supÃĐrieures, les ÃĐcoles professionnelles, les ÃĐcoles d'industrie et de commerce furent sÃĐrieusement organisÃĐes. L'ÃĐcole normale de Cluny fut alors supprimÃĐe, et les professeurs agrÃĐgÃĐs d'enseignement spÃĐcial assimilÃĐs aux agrÃĐgÃĐs de l'enseignement secondaire classique (DÃĐcret du 16 juillet 1887). Classes ÃĐlÃĐmentaires des lycÃĐes et collÃĻges. â L'enseignement primaire trouva aussi sa place dans les lycÃĐes et collÃĻges : ÂŦ C'est la classe primaire, disait M. Bardoux, qui fournit au recrutement de l'enseignement classique et de l'enseignement spÃĐcialÂŧ. Dans les lycÃĐes, elle reçut le nom de neuviÃĻme. La statistique officielle indiquait pour cette classe 4799 ÃĐlÃĻves et 191 maîtres, dont 2 licenciÃĐs, 18 bacheliers, soit ÃĻs lettres, soit ÃĻs sciences, et 165 instituteurs. A la plupart des collÃĻges communaux se trouvait ÃĐgalement annexÃĐe une classe primaire ; elle comptait, en 187b, 9232 ÃĐlÃĻves et 356 maîtres, dont les traitements varient de 300 à 2300 francs. Dans le nombre, on en remarquait 309 avec le brevet d'instituteur, contre 11 bacheliers seulement. En retardant le dÃĐbut des ÃĐtudes latines jusqu'à la sixiÃĻme, le plan d'ÃĐtudes du 2 aoÃŧt 1880 (Voir plus loin) a assimilÃĐ complÃĻtement les classes de neuviÃĻme, de huitiÃĻme et de septiÃĻme aux classes primaires ; l'enseignement qui doit s'y donner est absolument conforme au programme des" ÃĐcoles primaires publiques, en sorte que dÃĐsormais un ÃĐlÃĻve sortant de l'ÃĐcole primaire communale peut, s'il a commencÃĐ les langues vivantes, entrer de plain pied dans la classe de sixiÃĻme du lycÃĐe, sans qu'il existe aucune diffÃĐrence de prÃĐparation entre lui et ceux de ses camarades qui ont suivi les classes ÃĐlÃĐmentaires d'un ÃĐtablissement secondaire. IV. â La troisiÃĻme RÃĐpublique. Le projet de rÃĐforme de Jules Simon. â Lorsque Jules Simon devint ministre de l'instruction publique, il entreprit de rÃĐformer et d'amÃĐliorer l'enseignement classique. Il commença par quelques rÃĻglements indispensables sur la gymnastique, les langues vivantes, l'histoire et la gÃĐographie. On lui demandait, de diffÃĐrents cÃītÃĐs, d'aller plus loin, de faire des rÃĐformes profondes. ÂŦ Je rÃĐsiste, disait-il, à ces priÃĻres et à mes dÃĐsirs, parce qu'en matiÃĻre d'enseignement il vaut mieux procÃĐder par des amÃĐliorations successives ; c'est là surtout qu'il faut agir à coup sÃŧr, et qu'il n'est plus permis de risquer des expÃĐriences. Âŧ Dans une circulaire du 27 septembre 1872 aux proviseurs, Jules Simon exposa les principales rÃĐformes qui lui paraissent praticables. Il voulait des rÃĐunions pÃĐriodiques de professeurs, au moins une fois par mois, sous la prÃĐsidence du proviseur ou du censeur, avec la constitution d'un conseil ÃĐlu, devant exercer des fonctions analogues à celles du conseil de l'ordre des avocats. Le ministre insistait sur la nÃĐcessitÃĐ du dÃĐveloppement des exercices gymnastiques et militaires, d'ÃĐquitation, d'escrime, de natation, les longues promenades avec but instructif et exercices de topographie. Il voulait que les leçons de gÃĐographie allassent du connu à l'inconnu, des environs immÃĐdiats de la commune au dÃĐpartement et au monde, et fussent accompagnÃĐes sans cesse de confection de cartes. Il s'ÃĐtendait surtout sur les modifications urgentes à apporter dans l'enseignement du latin et du grec. Un grand nombre d'ÃĐtudes complÃĐmentaires, disait-il, ont fini par dÃĐvelopper le programme au point d'en faire une vÃĐritable encyclopÃĐdie. Un ÃĐlÃĻve qui possÃĐderait cet ensemble de connaissances serait un savant au sortir du collÃĻge. Mais en surchargeant les enfants de travail outre mesure, on nuit ÃĐgalement à leur santÃĐ et à leur progrÃĻs. Or toutes les ÃĐtudes nouvelles qui ont ÃĐtÃĐ introduites sont nÃĐcessaires ; on ne peut en omettre aucune. Ce serait un crime que de supprimer l'ÃĐtude des langues anciennes ; il ne reste donc qu'à la modifier. Le principe de la rÃĐforme à faire, ajoutait le ministre, sera celui-ci : on apprend les langues vivantes pour les parler, et les langues mortes pour les lire. Le vers latin, le thÃĻme, la dissertation latine, le discours latin, ont pour but principal d'enseigner à ÃĐcrire et à parler le latin ; la lecture, l'explication des auteurs, la traduction à haute voix et la version ÃĐcrite ont pour but principal d'enseigner à lire le latin. De ces deux ordres d'exercices, les premiers sont à supprimer ou à restreindre ; les seconds sont à dÃĐvelopper. De là dÃĐcoule la suppression complÃĻte des vers latins, la diminution de moitiÃĐ du temps donnÃĐ jusqu'alors aux thÃĻmes et aux compositions en langue latine, et en gÃĐnÃĐral à tous les devoirs ÃĐcrits. Ce temps gagnÃĐ sera employÃĐ Ã la lecture et à l'explication des auteurs grecs et latins et à une ÃĐtude plus sÃĐrieuse du français. Les compositions françaises devront moins porter sur les sujets qui encouragent à traiter des lieux communs ; des lettres, des rÃĐcits, des jugements sur un ÃĐvÃĐnement ou sur un livre seront prÃĐfÃĐrÃĐs à des sujets de discours de pure rhÃĐtorique. Ces rÃĐformes parurent trop hardies au Conseil supÃĐrieur reconstituÃĐ par la loi de 1873. Le doyen de la facultÃĐ des lettres de Paris, Patin, proposa de rÃĐtablir les vers latins ainsi que le thÃĻme latin pour les classes de quatriÃĻme, de troisiÃĻme et de seconde ; il en fut de mÊme pour le thÃĻme grec. En conformitÃĐ avec ces vues, et tout en tenant compte d'un certain nombre d'amÃĐliorations reconnues nÃĐcessaires, un arrÊtÃĐ ministÃĐriel (signÃĐ de M. de Cumont), en date du 23 juillet 1874, fixait le nouveau plan d'ÃĐtudes et le plan des programmes d'examen, ainsi qu'un tableau de l'emploi du temps. Un dÃĐcret du mÊme mois divisait les examens du baccalaurÃĐat ÃĻs lettres en deux sÃĐries d'ÃĐpreuves qui ne pouvaient Être subies qu'à un an d'intervalle, et qui assuraient un degrÃĐ supÃĐrieur de prÃĐparation et de maturitÃĐ. Plusieurs annÃĐes s'ÃĐcoulÃĻrent pendant lesquelles les luttes ardentes de la politique dÃĐtournÃĻrent l'attention des rÃĐformes scolaires. Le triomphe incontestÃĐ du parti rÃĐpublicain fut le signal de nouveaux efforts et de nouveaux progrÃĻs dans le domaine de l'instruction publique. L'annÃĐe 1880 vit la rÃĐorganisation du Conseil supÃĐrieur sur la base de l'ÃĐlection et l'adoption d'un nouveau plan d'ÃĐtudes pour les lycÃĐes et collÃĻges, plus conforme aux rÃĐclamations et aux exigences de la sociÃĐtÃĐ moderne. Le nouveau Conseil supÃĐrieur, prÃĐsidÃĐ par Jules Ferry, s'inspirant des idÃĐes ÃĐmises non seulement par Victor Duruy et Jules Simon, mais par un grand nombre de professeurs et de publicistes ÃĐminents, arrÊta toute une sÃĐrie de mesures et de programmes" qui portent la date du 2 aoÃŧt 1880. La reforme de 1880. â Ce nouveau plan ne fait plus commencer l'ÃĐtude du latin qu'à partir dÃĐ la sixiÃĻme et l'ÃĐtude du grec à partir de la quatriÃĻme. Il donne à l'ÃĐtude de la langue française et des sciences physiques et naturelles une trÃĻs grande place dans les premiÃĻres annÃĐes ; il rÃĐduit, pendant toute la durÃĐe des ÃĐtudes, les exercices ÃĐcrits, qu'il remplace le plus possible par des exercices oraux ; il diminue et supprime graduellement les compositions latines ; il abolit l'exercice du vers latin, qu'il rend facultatif pour quelques sujets d'ÃĐlite ; il donne un dÃĐveloppement considÃĐrable à l'ÃĐtude de l'histoire moderne et particuliÃĻrement de l'histoire de France ; il accorde autant de temps à l'ÃĐtude des langues vivantes qu'à celle des sciences ou qu'à celle de l'histoire. La physique, la chimie, la botanique, la minÃĐralogie, la gÃĐologie sont enseignÃĐes dans les classes de lettres depuis la huitiÃĻme jusqu'à la quatriÃĻme inclusivement, avec quelques notions d'arithmÃĐtique. De la troisiÃĻme à la philosophie, il s'y joint des ÃĐtudes mathÃĐmatiques plus sÃĐrieuses, arithmÃĐtique, gÃĐomÃĐtrie, algÃĻbre, cosmographie, etc. Le Conseil supÃĐrieur a rÃĐsumÃĐ dans une instruction de quelques pages les principes des nouvelles mÃĐthodes. Dans tout le cours des ÃĐtudes et dÃĻs les premiÃĻres classes, l'enseignement aura pour objet de dÃĐvelopper le jugement de l'enfant en mÊme temps que sa mÃĐmoire et de l'exercer à exprimer sa pensÃĐe. Il faudra mettre aux mains de l'ÃĐlÃĻve, pour chaque pÃĐriode et pour chaque langue, une grammaire proportionnÃĐe à son ÃĒge et à ses connaissances. On mettra fin à l'abus des analyses grammaticales ÃĐcrites et en gÃĐnÃĐral de tous les devoirs ÃĐcrits qui peuvent Être remplacÃĐs par des exercices oraux. L'ÃĐtude des rÃĻgles sera rÃĐduite à l'indispensable, et pour le latin et le grec, comme pour le français, on fera sortir successivement les rÃĻgles des textes, au lieu de n'aborder les textes qu'aprÃĻs avoir ÃĐpuisÃĐ le formulaire des rÃĻgles abstraites. On ira des textes aux rÃĻgles, de l'exemple à la formule. Le thÃĻme oral fait en classe devra Être associÃĐ au thÃĻme ÃĐcrit fait par l'ÃĐlÃĻve isolÃĐment. L'explication approfondie des textes prendra la plus grande place dans les ÃĐtudes littÃĐraires ; le mot à mot ÃĐcrit disparaîtra. Les compositions latines seront courtes, rares, sur des sujets variÃĐs. Les compositions françaises ne seront plus uniquement des narrations, des discours ou des lettres ; tous les sujets propres à entretenir l'habitude de la rÃĐflexion, à former le goÃŧt, à fortifier le jugement, seront utilement employÃĐs aux exercices de la classe. On restreindra sensiblement l'usage des dictionnaires ; l'usage de bonnes traductions françaises sera admis pour l'ÃĐtude des auteurs. L'ÃĐtude de la mÃĐtrique latine et française remplacera le vers latin. L'enseignement de l'histoire doit tendre à dÃĐvelopper la connaissance des institutions, des moeurs et des usages ; l'histoire de France en particulier devra mettre en lumiÃĻre le dÃĐveloppement gÃĐnÃĐral des institutions d'oÃđ est sortie la sociÃĐtÃĐ moderne ; elle devra inspirer le respect et l'attachement pour les principes sur lesquels cette sociÃĐtÃĐ est fondÃĐe. Tel est l'esprit gÃĐnÃĐral du nouvel enseignement. Jules Ferry y a joint des prescriptions de dÃĐtail pour mÃĐnager la transition, pour s'assurer que professeurs et ÃĐlÃĻves ne soient pas surchargÃĐs outre mesure ; il veut des professeurs spÃĐciaux d'histoire et de sciences dans les classes de grammaire ; il demande que les classes trop nombreuses soient dÃĐdoublÃĐes ; le but auquel il veut tendre est qu'un professeur n'ait jamais plus de trente ÃĐlÃĻves sous sa direction. Le vrai flÃĐau des lycÃĐes et collÃĻges, ce sont les ÃĐlÃĻves qui suivent machinalement et comme fatalement la sÃĐrie des classes, non d'aprÃĻs leurs progrÃĻs, mais uniquement d'aprÃĻs leur ÃĒge. Afin de remÃĐdier à ce mal, des examens pour le passage d'une classe à l'autre dans les lycÃĐes avaient ÃĐtÃĐ ÃĐtablis par le statut du 4 septembre 1821. En vain ont-ils ÃĐtÃĐ rappelÃĐs et prescrits de nouveau par des arrÊtÃĐs et des circulaires en 1838, 1852, 1855, 1857 : on n'en tenait nul compte. Jules Simon y ÃĐtait revenu et v avait insistÃĐ vivement en 1872: ÂŦ Ces examens, disait-il, ont à mes yeux une importance capitale. Les enfants qui remplissent les derniers bancs, et qui, faute de prÃĐparation antÃĐrieure, ne comprennent pas ce qui se dit devant eux, dÃĐtournent lâattention de leurs camarades, dÃĐcouragent le professeur. PrÃĐvenu à temps, un pÃĻre renoncerait à pousser son fils jusqu'au baccalaurÃĐat ; il le mettrait dans l'industrie, dans le commerce, et ne s'ÃĐpuiserait pas en sacrifices pour prÃĐparer à la sociÃĐtÃĐ le pire des parasites, un ignorant prÃĐsomptueux. J'entends donc qu'à la suite du dernier examen public, les ÃĐlÃĻves reconnus incapables soient maintenus dans la classe infÃĐrieure ou impitoyablement exclus du lycÃĐe. Âŧ Objurgations sans effet. La routine, la complaisance furent plus fortes. Jules Ferry dut à son tour revenir à la charge. Il le fit dans sa circulaire du 28 septembre 1880 : ÂŦ Les professeurs se plaignent gÃĐnÃĐralement d'avoir à subir des ÃĐlÃĻves mal prÃĐparÃĐs, hors d'ÃĐtat de suivre avec fruit les exercices de la classe, et qui sont un embarras pour le maître, un mauvais exemple pour leurs camarades. Au moment oÃđ de sÃĐrieux efforts sont tentÃĐs pour coordonner et restaurer renseignement classique, il est plus nÃĐcessaire que jamais que les familles soient exactement renseignÃĐes sur les vÃĐritables intÃĐrÊts de leurs enfants. Les examens de passage devront avoir lieu dans la semaine qui suivra la rentrÃĐe ; tous les ÃĐlÃĻves y seront soumis. Le proviseur dÃĐcidera de l'admission ou du rejet d'aprÃĻs l'ensemble des notes. Sous aucun prÃĐtexte, il ne devra consentir à placer l'ÃĐlÃĻve dans un cours dont il ne tirerait aucun profit et oÃđ il ne pourrait qu'entraver la marche rÃĐguliÃĻre de l'enseignement. Âŧ Les examens de passage, sÃĐrieusement pratiquÃĐs, rendent de rÃĐels services à l'enseignement des lycÃĐes et collÃĻges ; ils stimulent les enfants ; ils dÃĐgagent les classes d'un ÃĐlÃĐment de gÊne et d'affaiblissement, en dirigeant vers de nouvelles voies les esprits qu'on aurait voulu contraindre à suivre malgrÃĐ eux un enseignement qui ne leur convient pas. Discipline. â Les punitions comme les rÃĐcompenses jouent un rÃīle important dans la vie des lycÃĐes et collÃĻges. L'article 74 du dÃĐcret du 15 novembre 1811 interdit toute punition corporelle, et soumet à des peines disciplinaires tout professeur qui, sous prÃĐtexte de punitions, se permettrait de frapper un enfant. AprÃĻs quelques tÃĒtonnements, les moyens de discipline et d'encouragement employÃĐs dans Tes lycÃĐes ont ÃĐtÃĐ rÃĐglÃĐs par l'arrÊtÃĐ du 7 avril 1854. Les punitions admises par cet arrÊtÃĐ sont au nombre de huit, savoir : 1° la mauvaise note ; 2° la retenue avec tÃĒche extraordinaire (appelÃĐe pensum) pendant une partie de la rÃĐcrÃĐation ; 3° la retenue avec tÃĒche extraordinaire pendant une partie du temps destinÃĐ Ã la promenade ; 4° l'exclusion momentanÃĐe de la classe ou de l'ÃĐtude, avec renvoi devant le proviseur (ces quatre punitions peuvent Être prononcÃĐes par le censeur, les professeurs, les surveillants gÃĐnÃĐraux et les maîtres rÃĐpÃĐtiteurs ; â les quatre suivantes ne peuvent l'Être que par le proviseur) ; 5° privation de sortie chez les parents ; 6° mise à l'ordre du jour du lycÃĐe ; 7° arrÊts avec tÃĒche extraordinaire dans un lieu isole, sous la surveillance d'un maître ; 8° exclusion du lycÃĐe ; elle ne devient dÃĐfinitive qu'aprÃĻs l'approbation du recteur, et, pour les boursiers, du ministre. La salle d'arrÊt devait, selon les instructions ministÃĐrielles, Être suffisamment ÃĐclairÃĐe et chauffÃĐe, et facile à surveiller ; il n'en ÃĐtait gÃĐnÃĐralement pas ainsi ; cette punition, appelÃĐe aussi sÃĐquestre, se faisait le plus souvent dans quelque coin torride ou glacÃĐ, grenier ou cabinet sans air, mal surveillÃĐ, et ne produisait guÃĻre que de mauvais effets. Jules Ferry l'a supprimÃĐe en 1883. Quant aux retenues et pensums, ils sont peut-Être distribuÃĐs avec trop de prodigalitÃĐ par un certain nombre de maîtres, peu prÃĐoccupÃĐs de l'effet physique et moral de ces punitions, infligÃĐes parfois à des enfants simplement ÃĐtourdis et remuants, à qui le manque de jeu et d'exercice rend un triste service. M. Duvaux, ancien professeur de l'UniversitÃĐ, ÃĐcrivait aux proviseurs, pendant qu'il ÃĐtait ministre, en novembre 1882 : ÂŦ Je voudrais que les punitions, rÃĐduites aujourd'hui à un simple travail manuel, empruntassent à la lecture des auteurs quelque chose de son intÃĐrÊt et de son utilitÃĐ. Sans doute il est commode à un maître de se dÃĐbarrasser d'un ÃĐlÃĻve turbulent ou paresseux, en le consignant à la porte de sa classe avec quelques centaines de lignes à copier. Mais, pour lâÃĐlÃĻve, quel en est le rÃĐsultat? Une perte de temps considÃĐrable, beaucoup d'ennui, peut-Être un irrÃĐmÃĐdiable dÃĐgoÃŧt pour des ÃĐtudes qu'il faudrait lui faire aimer. Mieux vaudrait cent fois rendre à leurs familles les enfants reconnus incapables de l'application nÃĐcessaire aux ÃĐtudes secondaires, et traiter les autres par des remÃĻdes plus rationnels. Il convient du moins de rechercher si des traductions, des analyses d'auteurs, soigneusement surveillÃĐes par les professeurs, c'est-à -dire des travaux qui mettent en jeu l'intelligence, ne remplaceraient pas avec avantage le vulgaire pensum dont on a trop abusÃĐ. Âŧ En somme, les meilleurs maîtres sont ceux qui ont le moins besoin de recourir aux punitions. Ils savent inspirer à leurs ÃĐlÃĻves le dÃĐsir de bien faire, le goÃŧt de l'ÃĐtude, le respect du professeur, et la crainte de l'affliger. Les rÃĐcompenses, qui sont l'autre face de la discipline, sont instituÃĐes de la façon suivante : 1° bonne note ; 2° mise à l'ordre du jour de la classe ou de l'ÃĐtude ; 3° satisfecit (ou exemption) de trois ordres ; 4° sortie de faveur ; 5° prix accordÃĐ en ÃĐchange d'un certain nombre de satisfecit ; 6" mise à l'ordre du jour du parloir ; 7° prix dÃĐcernÃĐs à la distribution solennelle de la fin de l'annÃĐe scolaire. Il va sans dire que certaines de ces punitions et de ces rÃĐcompenses ne s'adressent qu'aux pensionnaires ; les externes ne les connaissent pas. Ces deux catÃĐgories d'ÃĐlÃĻves sont bien distinctes, ne se mÊlent jamais ; ils ont des places sÃĐparÃĐes dans les classes, ne se voient plus une fois la classe finie, sauf ceux des externes qui, sous le nom d'externes surveillÃĐs ou de demi-pensionnaires, prennent part à l'ÃĐtude, à certains repas et à certaines rÃĐcrÃĐations. L'emploi du temps est rigoureusement fixÃĐ, pour les internes, du rÃĐveil au sommeil et du dimanche au samedi ; une discipline exacte, sous la surveillance incessante des maîtres d'ÃĐtude, prescrit le moment de chaque travail, celui des devoirs, celui des leçons, celui du silence, celui des jeux, celui de la promenade, celui du lever, celui du coucher, et mÃĻne l'enfant comme par la main, depuis le jour oÃđ il entre tout petit jusqu'à celui oÃđ il sort presque un homme. On peut ÃĐlever des critiques contre ce systÃĻme ; il est bien difficile de le supprimer aussi longtemps que subsistera le rÃĐgime des grands internats, imposÃĐ aux lycÃĐes et collÃĻges par les traditions, les moeurs et les nÃĐcessitÃĐs. Paris a des lycÃĐes d'externes, Charlemagne et Condorcet ; on a dÃŧ y introduire le rÃĐgime de l'externat surveillÃĐ ; de plus, ils sont entourÃĐs de grandes ou petites institutions privÃĐes qui sont des internats, dont les familles ne peuvent ou ne savent pas se passer. Il ne faut pas croire que l'Etat entretienne ses internats dans une pensÃĐe de lucre, et qu'il en tire un bÃĐnÃĐfice. Duruy calculait, dans son rapport de 1867, que le prix moyen de la pension payÃĐe par les internes des lycÃĐes ÃĐtait de 739 francs (soit une augmentation de 34 francs seulement sur 1842, malgrÃĐ le renchÃĐrissement gÃĐnÃĐral proportionnellement plus ÃĐlevÃĐ). Or la dÃĐpense moyenne pour chaque ÃĐlÃĻve interne ÃĐtait de 829 francs, d'oÃđ une insuffisance de 90 francs par ÃĐlÃĻve, ce qui reprÃĐsentait un dÃĐficit annuel de un million et demi que l'Etat devait fournir. Ce qui dÃĐcide les villes et l'Etat à conserver leurs internats, c'est la conviction justifiÃĐe que leur brusque suppression remplirait aussitÃīt les pensions ecclÃĐsiastiques, ou ÂŦ susciterait immÃĐdiatement la plus honteuse et la plus dangereuse des industries, qui s'empresserait d'offrir aux familles des asiles oÃđ se compromettraient le succÃĻs des ÃĐtudes, la santÃĐ des ÃĐlÃĻves, et, ce qui est plus grave, leur moralitÃĐ Âŧ. (Jules Simon, La rÃĐforme de l'enseignement secondaire.) Institutions privÃĐes. â Les institutions privÃĐes, tenues en tutelle par la lÃĐgislation impÃĐriale et incorporÃĐes de force à l'UniversitÃĐ, ÃĐtaient comme des satellites ou des auxiliaires des lycÃĐes et des collÃĻges. Peu à peu, grÃĒce surtout aux persistants efforts du parti clÃĐrical en faveur de la libertÃĐ d'enseignement, elles avaient vu leur lien se relÃĒcher de fait, mais non encore lÃĐgalement. ÂŦ Avant 1850, dit M. GrÃĐard (Rapport de 1879 sur les lycÃĐes et collÃĻges de Paris), l'enseignement secondaire libre comprenait deux catÃĐgories d'ÃĐtablissements distincts suivant les titres des maîtres qui les dirigeaient, suivant le degrÃĐ d'instruction recherchÃĐ par les ÃĐlÃĻves qui les frÃĐquentaient. Pour Être chef d'institution, il fallait possÃĐder au moins le baccalaurÃĐat ÃĻs lettres et le baccalaurÃĐat ÃĻs sciences. Le diplÃīme de bachelier ÃĻs lettres ne donnait que le droit de tenir pension. Les institutions entretenaient auprÃĻs des collÃĻges, surtout des collÃĻges d'externes, de fortes pÃĐpiniÃĻres d'ÃĐlÃĻves. En outre, grÃĒce à leur prospÃĐritÃĐ matÃĐrielle, les chefs d'ÃĐtablissement pouvaient faire de notables sacrifices pour mettre l'ÃĐducation classique à la portÃĐe des familles de modeste aisance. Sur les 1016 ÃĐtablissements secondaires privÃĐs qui existaient en 1842 en France, il y avait 102 institutions (dont 23 de plein exercice) avec 8859 ÃĐlÃĻves, et 914 pensions avec 34336 ÃĐlÃĻves, dont 11311 ÃĐlÃĻves primaires : 40 institutions envoyaient des ÃĐlÃĻves à un collÃĻge royal ou communal ; 233 pensions envoyaient des ÃĐlÃĻves à un collÃĻge royal, et 62 en envoyaient à un collÃĻge communal ; 40 institutions et 120 pensions avaient pour chefs des ecclÃĐsiastiques. La loi de 1850, qui semblait faite pour favoriser ces ÃĐtablissements, ne fut rÃĐellement utile qu'aux maisons ecclÃĐsiastiques. Les autres dÃĐclinÃĻrent et une grande partie succomba. La statistique officielle de 1866 dit : ÂŦ Pendant les onze annÃĐes qui se sont ÃĐcoulÃĐes de 1854 à 1865, on a perdu 168 maisons laÃŊques, et l'on a eu en plus 22 maisons ecclÃĐsiastiques Âŧ. La statistique officielle de 1876 constate une situation analogue : ÂŦ Pendant les onze annÃĐes qui se sont ÃĐcoulÃĐes de 1865 à 1876, 163 maisons laÃŊques ont disparu, et il y a eu en plus 31 ÃĐtablissements ecclÃĐsiastiques. Âŧ Pendant cette derniÃĻre pÃĐriode, la population scolaire a diminuÃĐ, dans les ÃĐtablissements laÃŊques, de 11 760 ÃĐlÃĻves, dont 6039 internes et 5721 externes ; elle s'est accrue à peu prÃĻs du mÊme nombre dans les maisons ecclÃĐsiastiques, c'est-à -dire de 11 919 ÃĐlÃĻves, dont 9543 internes et 2376 externes. Ces chiffres ont certainement une valeur. Il faut ajouter que le nombre total des ÃĐlÃĻves qui frÃĐquentent les ÃĐtablissements secondaires privÃĐs n'a augmentÃĐ dans ces onze annÃĐes-là que de 159, tandis que, pour le mÊme temps, les ÃĐtablissements publics d'enseignement secondaire, lycÃĐes et collÃĻges, ont eu un accroissement de 13563 ÃĐlÃĻves. Ce chiffre aussi est significatif. Dans nos 85 lycÃĐes, nous avions, en 1882, 48313 ÃĐlÃĻves, et 41 344 dans nos 267 collÃĻges communaux, soit en tout 89657 ÃĐlÃĻves. L'enseignement secondaire libre, à la mÊme ÃĐpoque, comptait 72373 ÃĐlÃĻves, rÃĐpartis ainsi : 371 maisons laÃŊques, 25917 ; 331 maisons ecclÃĐsiastiques, 46456. De 1876 à 1882, l'enseignement secondaire libre a perdu 5692 ÃĐlÃĻves, appartenant presque tous aux maisons laÃŊques ; les maisons ecclÃĐsiastiques n'en ont, dans cet intervalle, perdu que 360. Dans le mÊme temps, les lycÃĐes et les collÃĻges ont gagnÃĐ prÃĻs de 10 000 ÃĐlÃĻves. On voit que la progression est constante. [JULES STEEG.] La rÃĐforme de 1890. â Les exercices physiques. â La discipline. â M. LÃĐon Bourgeois, ministre de l'instruction publique, a ÃĐnoncÃĐ nettement tes principes de cette rÃĐforme si heureuse, à laquelle son nom reste attachÃĐ : ÂŦ Deux idÃĐes gÃĐnÃĐrales me paraissent dominer et rÃĐsumer l'oeuvre du Conseil supÃĐrieur : au point de vue de l'enseignement, simplifier, coordonner, graduer, de maniÃĻre à proportionner exactement la matiÃĻre enseignÃĐe à la puissance d'assimilation de l'ÃĐlÃĻve, en visant la formation de l'esprit plutÃīt que l'accumulation du savoir. Au point de vue de la discipline et de l'ÃĐducation, unir et solidariser les forces disciplinaires de chaque ÃĐtablissement, fortifier par là l'autoritÃĐ de tous et de chacun, afin de pouvoir se relÃĒcher sans danger sur le nombre et la rigueur des punitions ; obtenir ainsi de l'enfant qu'il obÃĐisse, non plus a la crainte du chÃĒtiment, mais au sentiment spontanÃĐ du devoir devenu la condition mÊme de la santÃĐ de son esprit. C'est avec ces principes aussi justes que fÃĐconds que nous formerons la jeunesse aux moeurs de la libertÃĐ. Âŧ (Discours prononcÃĐ le 2 mai 1890 à la rÃĐception du haut personnel de l'UniversitÃĐ et des reprÃĐsentants des diffÃĐrents services.) Ajoutons que les exercices physiques, trop longtemps nÃĐgligÃĐs, prenaient enfin dans la vie scolaire la place qui leur est due. On rÃĐduisait les heures de classe et d'ÃĐtudes ; on voulait bannir des heures de rÃĐcrÃĐation ÂŦ l'oisivetÃĐ languissante Âŧ, cette forme de l'ennui, aussi prÃĐjudiciable à l'esprit qu'au corps. Les partisans â trÃĻs nombreux â de l'ancien rÃĐgime s'alarmÃĻrent. Le niveau des ÃĐtudes n'allait-il pas baisser brusquement? Les exercices physiques qu'un enthousiasme excessif et de premiÃĻre heure mettait au premier plan, ne nuiraient-ils pas aux exercices scolaires? L'autoritÃĐ dÃĐsarmÃĐe des maîtres se montrerait-elle capable de rÃĐsister à une indiscipline croissante ? L'ancien arsenal des punitions n'ÃĐtait-il pas rigoureusement nÃĐcessaire? Sur tous ces points, M. LÃĐon Bourgeois apporta à la tribune du SÃĐnat (19 juin 1890) des renseignements trÃĻs rassurants : ÂŦ Les exercices physiques ont pris dans ces derniers temps un certain dÃĐveloppement extÃĐrieur et je ne sais quoi d'un peu thÃĐÃĒtral qui alarme quelques esprits. On s'est complu à voir dans ces luttes et dans ces concours comme une rÃĐsurrection des nobles jeux olympiques. S'il y a eu quelques exagÃĐrations relatives dans ces manifestations extÃĐrieures, l'esprit des familles aura ÃĐtÃĐ frappÃĐ, les parents dorÃĐnavant n'hÃĐsiteront plus à l'aire pratiquer à leurs enfants ces exercices physiques qui, si on ne les avait pas montrÃĐs au dehors, seraient peut-Être mort-nÃĐs dans nos lycÃĐes. L'inspection gÃĐnÃĐrale vient de constater que les ÃĐtudes sont loin d'avoir souffert du dÃĐveloppement donnÃĐ Ã l'ÃĐducation physique. Âŧ Et le ministre ÃĐtayait cette apprÃĐciation, dont l'optimisme pouvait paraître un peu suspect, de preuves surabondantes. Quant à la discipline nouvelle, ajoutait-il, elle donne dÃĐjà les meilleurs rÃĐsultats : ÂŦ Il est certain qu'on demande aujourd'hui une discipline moins ÃĐtroite, plus souple, plus humaine, plus maternelle, a dit tout à l'heure M. Chalamet ; je ne vais pas jusque-là : plus paternelle, simplement ; â je crois que c'est le mot juste. Il existe entre les maîtres et les ÃĐlÃĻves des rapports diffÃĐrents de ceux qui existaient autrefois, des rapports plus cordiaux et, pour ainsi dire, de confiance rÃĐciproque ; et cette confiance a tournÃĐ, je l'affirme, au profit de l'ordre vÃĐritable, de l'ordre qui est obtenu par le consentement rÃĐflÃĐchi de ceux qui l'observent et qui, par consÃĐquent, ne se dÃĐtruit pas facilement, parce qu'il est fondÃĐ dans les consciences mÊmes. Cet ordre-là existe dans nos ÃĐtablissements universitaires, et je puis ajouter qu'il ne m'est pas encore parvenu de preuve qu'il ait ÃĐtÃĐ sÃĐrieusement troublÃĐ sur un point quelconque dans notre UniversitÃĐ. Âŧ Tous ceux qui doutaient alors de l'efficacitÃĐ de la discipline nouvelle, substituant l'ÃĐducation de la volontÃĐ et du caractÃĻre à la rÃĐpression impitoyable des fautes les plus futiles, sont aujourd'hui convertis, Pour se rendre compte de l'importance et de l'excellence de celle rÃĐforme de 1890, il faut avoir connu la grÊle de punitions â pensums, arrÊts pendant les rÃĐcrÃĐations, retenues de promenade, consigne du dimanche, sÃĐquestre â qui s'abattait sur les ÃĐlÃĻves et notamment sur les internes à la moindre peccadille. Les meilleurs ÃĐlÃĻves, ceux dont les professeurs se dÃĐclaraient absolument satisfaits, ÃĐtaient souvent, dans l'internat, les plus punis. Car il ÃĐtait dÃĐfendu de parler dans les rangs, au rÃĐfectoire. Ne pas respecter cette loi du silence, de l'ordre dans les rangs, exposait à des punitions qui n'en finissaient plus, attendu qu'une heure d'arrÊts mal faits en entraînait deux autres qui s'achevaient rarement sans encombre, je veux dire sans retenue de promenade. EnervÃĐs par cette sÃĐvÃĐritÃĐ sans raison, perdant patience, des premiers de classe attiraient sur leur tÊte toutes les foudres administratives, tandis que de pacifiques cancres, dont la seule vertu ÃĐtait de rester aussi muets au rÃĐfectoire qu'en classe, passaient pour de bons esprits, de charmants enfants, dociles, disciplinÃĐs, joie des maîtres d'ÃĐtude et consolation des proviseurs. Les autres ÃĐtaient de ÂŦ fortes tÊtes Âŧ qu'il fallait à tout prix mater ou exclure. ExagÃĐration ? Non pas. Un seul fait permettra d'en juger : Il y avait, par jour, une heure un quart de rÃĐcrÃĐations ; et la moindre hÃĐsitation à se lever le matin, au dernier coup du roulement de cinq heures, ÃĐtait punie d'une heure d'arrÊts. ÂŦ La vieille UniversitÃĐ, â dÃĐclarait, au lendemain de la rÃĐforme, M. de Chaumont, principal du collÃĻge de Nantua, â vient d'avoir son 89. Ce que veut l'UniversitÃĐ moderne, ce que nous voulons tous, c'est que les collÃĻges ne soient plus des casernes dÃĐtestÃĐes des mÃĻres. A quel ÃĐtrange spectacle â je dis ÃĐtrange par comparaison avec l'ancien rÃĐgime â n'assistons-nous pas? Aujourd'hui, sans avoir à encourir la grÊle des pensums, l'averse des retenues, on parle sur les rangs. Aujourd'hui vous vous rendez en classe, gais et expansifs comme de jeunes intelligences qui vont recevoir leur nourriture spirituelle. Aujourd'hui vos repas sont ÃĐgayÃĐs par une libre conversation. Âŧ La rÃĐforme de 1890 maintint, pour les professeurs, le droit de punir, dont ils n'abusaient certes pas : la discipline de la classe formait, à cet ÃĐgard, un saisissant contraste avec celle de l'ÃĐtude. Mais les rÃĐpÃĐtiteurs devaient, à l'avenir, proposer au proviseur les punitions jugÃĐes par eux indispensables. C'en ÃĐtait fait du pouvoir sans contrÃīle, de la vigilante et cruelle tyrannie qu'ils avaient si longtemps exercÃĐs. On se demande, maintenant que le temps a passÃĐ, que la rÃĐforme bÃĐnie est entrÃĐe pour toujours dans les moeurs universitaires, par quelle aberration on avait pu laisser jusqu'alors les ÃĐlÃĻves à l'entiÃĻre discrÃĐtion de rÃĐpÃĐtiteurs si mal recrutÃĐs, si infÃĐrieurs, nous le verrons plus loin, à ceux d'aujourd'hui. EspÃĐrait-on par là compenser tout ce qui leur manquait d'autoritÃĐ personnelle? Les maîtres actuels savent s'imposer, comme le demandait en 1890 M. LÃĐon Bourgeois, pat-leur valeur, leur ascendant moral, et il n'en est pas un qui souhaite qu'on rÃĐtablisse, à leur intention, l'ancien arsenal des punitions, tout ce systÃĻme de rÃĐpression brutale qui a laissÃĐ dans beaucoup d'hommes de cette gÃĐnÃĐration, non seulement le souvenir de mauvais et injustes jours, mais encore, il faut l'avouer, une tare ineffaçable de la volontÃĐ. Henri Marion lui-mÊme (L'Education dans l'UniversitÃĐ) n'est-il pas obligÃĐ d'accepter en partie ce grave reproche, à notre avis mÃĐritÃĐ par l'ancienne discipline: qu'aprÃĻs des annÃĐes de ce rÃĐgime, le lycÃĐen ÂŦ est devenu ou bien le rÃĐsignÃĐ qui accepte en aveugle toute autoritÃĐ, ou bien le rÃĐvoltÃĐ pour qui le terme dÃĐfendu au lycÃĐe ou l'acte rÃĐprimÃĐ par le rÃĻglement devient la chose à dire ou la chose à faire. Il confondra ÃĐternellement l'habitude puÃĐrile de la rÃĐvolte avec le noble et viril emploi de la libertÃĐ. Il n'est pas un seul administrÃĐ français qui ne soit ou un rÃĐvoltÃĐ Ã outrance ou un rÃĐsignÃĐ Ã l'excÃĻs. Âŧ Si tous les administrÃĐs français ne sont pas rÃĐellement taillÃĐs sur ce modÃĻle, c'est que la vie s'est chargÃĐe de leur donner â souvent à leurs dÃĐpens â une ÃĐducation du caractÃĻre, une mentalitÃĐ d'hommes libres qu'ils n'avaient pas reçue du lycÃĐe. Il est certain que l'ancien caporalisme universitaire, par son systÃĻme mÃĐcanique de punitions, par le soin que mettait l'autoritÃĐ Ã ne jamais expliquer et faire accepter librement ses ordres, ne tendait à rien de moins qu'à annihiler ou à exaspÃĐrer l'indÃĐpendance naturelle et jusqu'à un certain point lÃĐgitime des ÃĐlÃĻves. De là ces rÃĐvoltes qui, de temps à autre, faisaient trembler l'administration et qui restaient cÃĐlÃĻbres dans les fastes scolaires de l'ÃĐtablissement. A cet indÃĐniable ÃĐtat de guerre, la rÃĐforme de 1890 a fait, selon la profonde parole du ministre, succÃĐder l'ÃĐtat de paix : ÂŦ Le travail n'a pas souffert, le bon ordre n'a pas ÃĐtÃĐ compromis, l'autoritÃĐ ne s'est pas trouvÃĐe en pÃĐril. Elle s'est exercÃĐe avec plus de rÃĐserve ; elle a ÃĐtÃĐ acceptÃĐe avec plus de dÃĐfÃĐrence. C'est bien un ÃĐtat de paix qui rÃĻgne dans nos lycÃĐes. Âŧ L'UniversitÃĐ sentait tellement la nÃĐcessitÃĐ de cette rÃĐforme qu'en dÃĐpit de ÂŦ la rÃĐpugnance naturelle des grandes corporations à se rÃĐformer elles-mÊmes Âŧ, ce sont des universitaires qui, dans la Commission gÃĐnÃĐrale des rÃĐformes et dans la sous-commission de discipline, ont ÃĐtÃĐ les collaborateurs dÃĐvouÃĐs et convaincus du ministre. En retour de la confiance qu'il lui a tÃĐmoignÃĐe et de l'immense service qu'il lui a rendu en 1890, l'UniversitÃĐ garde à M. LÃĐon Bourgeois une profonde reconnaissance. La rÃĐforme de 1891. â L'enseignement secondaire moderne. â Une commission rÃĐunie le 31 mars 1886 par RenÃĐ Goblet, ministre de l'instruction publique, et dans laquelle il avait tenu à faire entrer des reprÃĐsentants du commerce et de l'industrie, avait adoptÃĐ diverses propositions qui toutes dÃĐcoulaient de la premiÃĻre, ainsi conçue : ÂŦ Le nouvel enseignement sera gÃĐnÃĐral et classique ; il devra Être organisÃĐ de maniÃĻre à rÃĐpondre aux besoins nouveaux de la sociÃĐtÃĐ moderne et à attirer vers les ÃĐtudes secondaires françaises les jeunes gens qui n'ont ni le goÃŧt ni le loisir de se livrer à l'ÃĐtude des langues mortes. Âŧ Le ministre avait proposÃĐ d'appeler ce nouvel enseignement, qui devait remplacer l'enseignement secondaire spÃĐcial, ÂŦ Enseignement classique français Âŧ. Mais le Conseil supÃĐrieur n'adopta pas ce nom! (Voir Goblet.) En 1890, le ministÃĻre proposait de conserver le vieux nom de spÃĐcial, en y joignant le mot de ÂŦ classique Âŧ. Le Conseil supÃĐrieur, sur la demande des partisans des langues anciennes, ÃĐcarta le mot classique et adopta le titre de moderne. Une Note sur l'ensemble du projet de rÃĐorganisation de l'enseignement secondaire spÃĐcial exposait les raisons et le plan de cet enseignement nouveau. Il suffira d'en rappeler les passages essentiels, d'autant que cet enseignement n'offre plus aujourd'hui qu'un intÃĐrÊt tout rÃĐtrospectif. A bien des ÃĐgards, cependant, cet enseignement ÂŦ moderne Âŧ de 1891 se retrouvera, transformÃĐ encore, dans les lycÃĐes et collÃĻges soumis au rÃĐgime de 1902. ÂŦ On a souvent, â dit la Note, â au sein du Conseil supÃĐrieur, posÃĐ Ã l'administration cette question : Qu'est ce que l'enseignement spÃĐcial ? Est-ce un enseignement libÃĐral et classique? Est-ce un enseignement pratique et professionnel? Jusqu'à ce jour, il n'a pas ÃĐtÃĐ possible de rÃĐpondre catÃĐgoriquement à cette question. ÂŦ Est-ce un enseignement pratique et professionnel? Mais, en ce cas, pourquoi lui avoir donnÃĐ des programmes identiques sur tant de points à ceux de l'enseignement classique? Pourquoi un cours d'ÃĐtudes de six annÃĐes? Pourquoi un baccalaurÃĐat au moins aussi difficile que le baccalaurÃĐat ÃĻs sciences et donnant accÃĻs, comme celui-ci, aux grandes administrations publiques, à l'Ecole de Saint-Cyr, à l'Ecole polytechnique, a la licence, à l'Ecole normale supÃĐrieure? ÂŦ Est-ce au contraire un enseignement classique? Mais alors pourquoi ce nom de spÃĐcial, ces certificats spÃĐciaux, ces maîtres spÃĐciaux? Toutes choses qui semblent faites pour dÃĐterminer une orientation spÃĐciale. ÂŦ Ce caractÃĻre persistant d'ambiguÃŊtÃĐ n'est de la faute de personne : il vient des choses mÊmes ; il rÃĐsulte de l'origine premiÃĻre de l'enseignement spÃĐcial, des circonstances au milieu desquelles il s'est dÃĐveloppÃĐ, des besoins distincts auxquels il a dÃŧ, jusqu'à prÃĐsent, pourvoir simultanÃĐment. ÂŦ Or le parti à prendre est indiquÃĐ et en quelque sorte imposÃĐ par les conditions mÊmes dans lesquelles l'enseignement spÃĐcial se trouve placÃĐ, par le sens de son ÃĐvolution depuis son origine. AppelÃĐ Ã fonctionner à cÃītÃĐ de l'enseignement classique qui se trouve, de longue date, en possession du prestige et de l'autoritÃĐ, perpÃĐtuellement comparÃĐ Ã l'enseignement classique par les ÃĐlÃĻves, par les maîtres, par l'administration, par les familles, il semble s'abaisser au-dessous de cet enseignement dans la mesure mÊme oÃđ il s'en distingue. Dans nos lycÃĐes et collÃĻges, l'enseignement spÃĐcial n'a jamais ÃĐtÃĐ, il ne peut pas Être rÃĐellement, spÃĐcial, pratique, professionnel. Un tel enseignement ne peut avoir foi en lui-mÊme et rester lui que s'il est chez lui. PlacÃĐ prÃĻs de l'enseignement classique, l'attraction de celui-ci le fera fatalement dÃĐvier. ÂŦ C'est pourquoi toute l'ÃĐvolution de l'enseignement spÃĐcial s'est accomplie dans le sons de l'enseignement classique. ÂŦ De là ces remaniements profonds qu'on a dÃŧ faire subir aux programmes de 1886. Ainsi on a mis fin à cette disposition du plan d'ÃĐtudes en une sÃĐrie de cercles concentriques dont le but ÃĐtait de permettre aux ÃĐlÃĻves de quitter le collÃĻge aprÃĻs une ou deux ou trois annÃĐes d'ÃĐtudes, en emportant nÃĐanmoins un bagage de connaissances ÂŦ formant un tout complet Âŧ en soiÂŧ, avantage trop compensÃĐ par des inconvÃĐnients sur lesquels il est inutile d'insister, aujourd'hui qu'on les a bien reconnus. â Les exercices d'atelier, destinÃĐs à habituer les ÃĐlÃĻves à manier quelques outils, ont ÃĐtÃĐ rÃĐservÃĐs aux ÃĐcoles d'apprentissage, aux ÃĐcoles d'arts et mÃĐtiers. â On a prolonge la durÃĐe normale des ÃĐludes, qui, de quatre ans, a ÃĐtÃĐ portÃĐe à cinq, puis à six. Les ÃĐtudes littÃĐraires ont ÃĐtÃĐ renforcÃĐes et ont reçu pour couronnement un cours de philosophie scientifique et morale. â Les programmes scientifiques ont cessÃĐ d'Être orientÃĐs vers les applications, et, en donnant à la thÃĐorie la place qui lui revient, on a renoncÃĐ Ã la facultÃĐ de les varier selon les besoins de chaque rÃĐgion, de chaque localitÃĐ, ce qui n'a de raison d'Être que pour l'enseignement professionnel. Âŧ A mesure que l'enseignement spÃĐcial abandonnait ainsi la partie de sa tÃĒche à laquelle il se sentait apparemment inhabile, un enseignement nouveau, rÃĐguliÃĻrement instituÃĐ Ã cette fin par le lÃĐgislateur, s'en est saisi et en a fait sa tÃĒche propre. L'enseignement primaire supÃĐrieur se dÃĐveloppe de jour en jour. Le nombre de ses ÃĐlÃĻves augmente. De 20 000 en 1884, il s'ÃĐlÃĻve à 25 824 en 1889, tandis que celui de l'enseignement spÃĐcial descend de 23 267 en 1884 à 22 164 en 1889. Mais est-il possible de constituer, avec des ÃĐtudes de français, de langues vivantes et de sciences, c'est-à -dire sans grec ni latin, un enseignement classique? ÂŦ On entend, ce me semble, gÃĐnÃĐralement par enseignement classique, un enseignement qui, n'ÃĐtant ni rÃĐtrÃĐci, ni ÃĐcourtÃĐ par des nÃĐcessitÃĐs pressantes de carriÃĻre ou de mÃĐtier, s'ÃĐtudie à parfaire, avec le loisir voulu, l'ÃĐducation de l'esprit qui le reçoit. Par suite, cet enseignement est justement appelÃĐ libÃĐral et dÃĐsintÃĐressÃĐ. Or, quand on a renoncÃĐ au grec et au latin, a-t-on encore à sa disposition une matiÃĻre d'enseignement qui puisse constituer le programme suffisant d'une telle ÃĐducation? Il est permis de faire observer que le nom de classique n'a jamais ÃĐtÃĐ contestÃĐ au baccalaurÃĐat ÃĻs sciences, ni aux ÃĐtudes faites dans les classes de mathÃĐmatiques prÃĐparatoires, ÃĐlÃĐmentaires et spÃĐciales. Âŧ La raison en est que ÂŦ si les sciences, comme d'ailleurs les langues et l'histoire, peuvent s'enseigner d'une maniÃĻre qui n'a rien de classique, enseignÃĐes d'une autre façon elles constituent, au contraire, un ÃĐlÃĐment incomplet sans doute, mais essentiel, d'une ÃĐducation classique Âŧ. Pour la complÃĐter, on fait appel aux langues vivantes, qui offrent des textes, des exercices d'une haute valeur et d'une rÃĐelle efficacitÃĐ, à la condition toutefois de ne pas les enseigner uniquement en vue de la pratique. ÂŦ Il est bien vrai qu'on propose d'enseigner ces langues, au moins au dÃĐbut, principalement par la pratiquÃĐ, et, sous ce rapport, la mÃĐthode mÊme d'enseignement est fort infÃĐrieure, comme discipline, à la mÃĐthode traditionnelle de l'enseignement grÃĐco-latin. Mais par contre on espÃĻre que, par cette mÃĐthode plus facile, l'ÃĐlÃĻve arrivera à les savoir et à s'en servir, rÃĐsultat que, jusqu'à ce jour, on n'atteint guÃĻre pour le latin et le grec par les mÃĐthodes classiques. Âŧ La consÃĐquence nÃĐcessaire de cette rÃĐorganisation ÃĐtait la suppression de l'agrÃĐgation d'enseignement spÃĐcial. Pour ÃĐlever le niveau d'un enseignement, il faut spÃĐcialiser les professeurs ; or ce qu'on demandait aux professeurs de l'enseignement spÃĐcial, surtout de l'ordre des lettres, c'ÃĐtait de suffire aux enseignements les plus divers (grammaire, littÃĐrature, histoire ancienne et moderne, gÃĐographie, philosophie, morale, lÃĐgislation ÃĐconomie politique). Les deux principales matiÃĻres de l'enseignement secondaire moderne ÃĐtaient le français et les langues vivantes. L'histoire disposait d'une heure et demie par semaine pendant toute la durÃĐe des ÃĐtudes (six annÃĐes). La gÃĐographie avait le mÊme nombre d heures. Les sciences n'avaient qu'une part restreinte dans toutes les classes, sauf la derniÃĻre annÃĐe oÃđ les ÃĐlÃĻves pouvaient opter pour la PremiÃĻre-lettres ou la PremiÃĻre-sciences. ÂŦ En somme le nouvel enseignement moderne reproduisait à peu prÃĻs, â avec une classe en moins, la rhÃĐtorique, â le plan de l'ancien enseignement classique, en remplaçant le latin et le grec par l'allemand et l'anglais. En premiÃĻre la philosophie ÃĐtait un peu resserrÃĐe par l'histoire de la civilisation, le droit et l'ÃĐconomie. Âŧ (Ch. Seignobos.) La rÃĐforme de 1902. â M. Georges Leygues, ministre de l'instruction publique, ÃĐcrivait, en janvier 1902, à M. Ribot, prÃĐsident de la Commission de l'enseignement de la Chambre des dÃĐputÃĐs : ÂŦ L'enquÊte que vous avez dirigÃĐe, au cours de laquelle vous avez recueilli les dÃĐpositions des hommes les plus ÃĐminents de toutes les professions et de tous les partis, et qui est, sans contredit, l'une des plus complÃĻtes et des plus fructueuses que nous ayons enregistrÃĐes, les travaux de la Commission parlementaire et de ses rapporteurs, les travaux du Conseil supÃĐrieur de l'instruction publique et de mon administration, les ÃĐludes poursuivies dans le CongrÃĻs des professeurs, dans l'UniversitÃĐ et hors de l'UniversitÃĐ, par les hommes que passionnent ces hauts problÃĻmes, tant de bonnes volontÃĐs, l'accumulation de documents si prÃĐcieux, un si immense effort, ne peuvent Être perdusÂŧ. Celte longue enquÊte devait en effet aboutir à la vaste rÃĐforme de 1902, qui a modifiÃĐ profondÃĐment le plan des ÃĐtudes et, par suite, le rÃĐgime ÃĐconomique des lycÃĐes, le provisorat, la prÃĐparation des professeurs, le rÃĐpÃĐtitorat. Principe de la rÃĐforme. â Il a paru nÃĐcessaire de moderniser l'enseignement secondaire pour lui permettre de rÃĐpondre aux besoins rÃĐels de la nation, aux exigences nouvelles des sociÃĐtÃĐs modernes. ÂŦ Dans un pays comme la France, oÃđ la population professionnelle et active (industriels, nÃĐgociants, agriculteurs) reprÃĐsente 40 % de la population totale, 18 millions d'individus sur 38 millions d'habitants, oÃđ le capital industriel s'ÃĐlÃĻve a 96 milliards 700 millions de francs, oÃđ le capital agricole atteint 78 milliards de francs ; oÃđ les exportations se sont chiffrÃĐes, en 1900, à plus de 4 milliards de francs, l'UniversitÃĐ ne peut se contenter de prÃĐparer les jeunes gens qui lui sont confiÃĐs aux carriÃĻres libÃĐrales, aux grandes ÃĐcoles, au professorat ; elle doit les prÃĐparer aussi à la vie ÃĐconomique, à l'action. Âŧ Est-ce bien l'enseignement secondaire, dont le but essentiel est la culture gÃĐnÃĐrale de l'esprit, qui doit rÃĐpondre à ces besoins ÃĐvidents? La Commission d'enquÊte et le ministre se sont trouvÃĐs d'accord pour croire que l'enseignement pouvait rester secondaire tout en donnant ÂŦ à l'ÃĐlÃĻve l'instruction la plus utile en vue de sa carriÃĻre future Âŧ. ÂŦ Il faut donner aux ÃĐlÃĻves le moyen de choisir l'enseignement le mieux appropriÃĐ Ã leurs aptitudes, à leurs vocations prÃĐsumÃĐes et aux nÃĐcessitÃĐs ÃĐconomiques des rÃĐgions oÃđ ils vivent, sans prÃĐjudice d'ailleurs pour ce fonds commun de connaissances gÃĐnÃĐrales qui caractÃĐrise l'enseignement secondaire et qui assure l'unitÃĐ de cet enseignement. Âŧ Mais plus encore que ces connaissances gÃĐnÃĐrales, dont les ÃĐlÃĻves, plus utilitaires que l'enseignement qu'ils reçoivent, pourraient peut-Être se dÃĐsintÃĐresser, les lycÃĐes et collÃĻges sont appelÃĐs à donner une mÃĐthode, une tournure d'esprit, une discipline mentale qui leur est propre et qui est aussi indispensable ÂŦ à l'ÃĐlite ÃĐclairÃĐe et libÃĐrale, à l'aristocratie de l'esprit Âŧ qu' ÂŦ à l'ÃĐtat-major et aux cadres de l'armÃĐe du travail Âŧ. Le plan d'ÃĐtudes. â Par dÃĐcret du 31 mai 1902, les ÃĐlÃĻves, aprÃĻs quatre annÃĐes d'ÃĐtudes primaires et ÃĐlÃĐmentaires, faites au lycÃĐe ou ailleurs, entrent dans le premier cycle des ÃĐtudes secondaires. Ils peuvent alors choisir entre l'enseignement sans grec ni latin et l'enseignement avec latin. A ceux qui commencent (en sixiÃĻme) l'ÃĐtude du latin, est rÃĐservÃĐ, ultÃĐrieurement, un cours facultatif de grec (quatriÃĻme et troisiÃĻme) Trois catÃĐgories d'ÃĐlÃĻves sortent donc du premier cycle : la premiÃĻre a fait du latin et du grec, la seconde du latin sans grec, la troisiÃĻme n'a fait ni latin ni grec, ÃĐtudes remplacÃĐes pour elle par celle des sciences. Il semble donc, à premiÃĻre vue, que le second cycle doit comporter trois sections! Or il y en a quatre : 1° La Section A (Latin-Grec), pour les ÃĐlÃĻves qui ont commencÃĐ et qui poursuivront l'ÃĐtude des deux langues classiques ; â 2° et 3° Parmi les ÃĐlÃĻves qui ont commencÃĐ le latin, il en est qui dÃĐsirent le continuer et qui complÃĐteront leur programme, les uns par des langues vivantes, les autres par des sciences. De là , deux sections r Section B (Latin-Langues vivantes) ; Section G (Latin-Sciences) ; 4° Ceux qui renoncent au latin vont rejoindre les ÃĐlÃĻves qui sortent du premier cycle sans latin ni grec et dorÃĐnavant leur programme commun se composera de sciences et de langues vivantes : Section E (Sciences-Langues vivantes) Le second cycle a une durÃĐe de trois ans (classes de seconde, de premiÃĻre, de mathÃĐmatiques ou de philosophie). Le baccalaurÃĐat reste divisÃĐ en deux parties, sÃĐparÃĐes par un an au moins d'intervalle. A la fin de la classe de premiÃĻre se passe la premiÃĻre partie, dont les quatre sÃĐries d'ÃĐpreuves correspondent aux matiÃĻres enseignÃĐes dans les quatre sections A, B, C, D. L'annÃĐe suivante, les ÃĐlÃĻves achÃĻvent leurs ÃĐludes secondaires dans la classe de mathÃĐmatiques ou de philosophie, selon leurs prÃĐfÃĐrences ou leurs aptitudes, sans Être gÊnÃĐs, comme autrefois, par les prÃĐrogatives diffÃĐrentes attachÃĐes aux diplÃīmes de bachelier ÃĻs lettres et de bachelier ÃĻs sciences. Il n'y a plus, sous deux formes, qu'un seul baccalaurÃĐat qui confÃĻre à tous les bacheliers les mÊmes droits, N'oublions pas qu' ÂŦ une sortie est mÃĐnagÃĐe, en cours de route, aux plus pressÃĐs ou aux moins capables Âŧ. Le premier cycle ne conduit pas nÃĐcessairement au second. Il se suffit à lui-mÊme. L'ÃĐlÃĻve peut quitter le lycÃĐe à la fin de la troisiÃĻme, car il a appris ÂŦ autre chose que des commencements et emporte un bagage de connaissances, modeste sans doute, mais formant un ensemble complet en soi et utilisable Âŧ. L'article 5 du dÃĐcret spÃĐcifie qu'un certificat d'ÃĐtudes secondaires du premier degrÃĐ pourra Être dÃĐlivrÃĐ Ã , l'ÃĐlÃĻve en raison des notes obtenues pendant ses quatre annÃĐes d'ÃĐtudes, aprÃĻs dÃĐlibÃĐration de ses professeurs. On peut prÃĐvoir encore que des ÃĐlÃĻves, sortant du premier cycle, dÃĐsireront continuer leurs ÃĐtudes au lycÃĐe, sans se prÃĐoccuper du baccalaurÃĐat. Une cinquiÃĻme section, dite section nouvelle, leur est immÃĐdiatement offerte. Il sera instituÃĐ dans un certain nombre d'ÃĐtablissements publics, à l'issue du premier cycle, un cours d'ÃĐtudes dont l'objet principal sera l'ÃĐtude des langues vivantes et l'ÃĐtude des sciences spÃĐcialement en vue des applications Ce cours d'ÃĐtudes aura une durÃĐe de deux ans. Il sera appropriÃĐ aux besoins des diverses rÃĐgions. Le programme en sera prÃĐparÃĐ par les Conseils acadÃĐmiques et arrÊtÃĐ par le ministre de l'instruction publique. A l'issue de ce cours et à la suite d'un examen public subi sur le programme ÃĐtabli comme il est prÃĐvu ci-dessus, un certificat pourra Être dÃĐlivrÃĐ, sur lequel seront portÃĐes, avec le nom de l'acadÃĐmie oÃđ l'examen a ÃĐtÃĐ passÃĐ, les matiÃĻres de cet examen et les notes obtenues (article 7 du dÃĐcret). Non seulement le ministre souhaite la crÃĐation de cette section nouvelle partout oÃđ il sera possible, mais encore, dans son arrÊtÃĐ du 31 mai 1902, il appelle la crÃĐation de ÂŦ nouveaux enseignements Âŧ, qui pourront Être crÃĐÃĐs par les recteurs, aprÃĻs avis des assemblÃĐes de professeurs et des conseils d'administration, dans les lycÃĐes autonomes. La rÃĐforme ÃĐconomique. L'autonomie. â Il ne peut Être question d'une autonomie absolue, tous les ÃĐtablissements publics devant appliquer les mÊmes programmes, prÃĐparer aux mÊmes examens, aux mÊmes concours. Mais, pour rÃĐpondre aux besoins rÃĐgionaux, chaque administration collÃĐgiale doit jouir d'une certaine indÃĐpendance morale et ÃĐconomique. L'Etat n'a pas à faire les frais de ces expÃĐriences locales. La rÃĐforme de 1902 a donc sÃĐparÃĐ les budgets de l'internat et de l'externat. L'Etat, qui n'a jamais prÃĐtendu tirer profit de l'enseignement qu'il donne, verse une subvention fixe à l'externat et demande à l'internat de se suffire à lui-mÊme. Pendant les premiÃĻres annÃĐes d'application de la rÃĐforme et par mesure transitoire, l'Etat a continuÃĐ de verser et il verse encore les subventions nÃĐcessaires à l'internat d'un certain nombre d'ÃĐtablissements (734 560 francs en 1908 â 656 560 en 1909). Mais en principe cette aide est provisoire. Les lycÃĐes autonomes ont à la fois la charge et les bÃĐnÃĐfices de leur internat. Les bonis rÃĐalisÃĐs, tant sur l'externat que sur l'internat, leur appartiennent et constituent la caisse oÃđ ils peuvent puiser pour crÃĐer les chaires et fonder les enseignements indispensables. Le rÃĐgime de l'autonomie semble appelÃĐ Ã donner des rÃĐsultats financiers satisfaisants. La situation, qui se liquidait en 1901 par un dÃĐficit de 258 041 fr. se prÃĐsente en 1906 avec un boni global de 560 795 francs. En 1908 le boni global de l'externat est de 181 987 fr. : 79 lycÃĐes sont en boni, 29 en dÃĐficit (de 158 107 fr.) ; celui de l'internat est de 333 918 fr. : 101 lycÃĐes sont en boni, 7 en dÃĐficit (de 4 013 fr.). Le provisorat. â Le budget de l'internat est dressÃĐ par le proviseur et arrÊtÃĐ par le conseil d'administration pour Être proposÃĐ Ã l'approbation du recteur. La responsabilitÃĐ du proviseur est donc ÃĐtendue ; sa situation, devenue plus importante, plus dÃĐlicate, ÂŦ devra Être relevÃĐe, son autoritÃĐ renforcÃĐe Âŧ. En fait, on a relevÃĐ sensiblement le traitement des proviseurs, mais il semble qu'on ait surtout songÃĐ Ã remÃĐdier aux erreurs possibles de leur administration en les classant comme professeurs et en leur allouant une indemnitÃĐ de direction de 2000 à 4000 francs. Le proviseur est donc aujourd'hui un professeur dÃĐlÃĐguÃĐ dans des fonctions administratives et dont la dÃĐlÃĐgation peut Être trÃĻs simplement rapportÃĐe (dÃĐcrets du 31 mai et du 7 aoÃŧt 1902). Pour l'aider dans sa lourde tÃĒche, la rÃĐforme de 1902 a placÃĐ auprÃĻs de lui un conseil d'administration dont il doit prendre l'avis pour la crÃĐation des chaires, l'amÃĐlioration du matÃĐriel, la fondation des cours spÃĐciaux. ComposÃĐ de membres de droit : le prÃĐfet, prÃĐsident, l'inspecteur d'acadÃĐmie, Je maire, le proviseur, auxquels le ministre adjoint des notables, commerçants, industriels, prÃĐsidents d'associations d'anciens ÃĐlÃĻves, etc., ce conseil, depuis 1902, n'ÃĐtait mis au courant des questions concernant le lycÃĐe que par le proviseur. Force lui ÃĐtait donc de prendre des dÃĐcisions dans des circonstances importantes, dans les cas de suppression de chaires notamment, sans connaître l'avis et les raisons des professeurs, dont la compÃĐtence en matiÃĻre d'enseignement n'est pas nÃĐgligeable et devrait toujours Être consultÃĐe. En 1909, on a fait droit, dans une certaine mesure, aux rÃĐclamations des professeurs sur ce point. Ils voulaient pouvoir ÃĐlire leur reprÃĐsentant au conseil. Le ministre s'est rÃĐservÃĐ de nommer l'un d'entre eux sur la proposition du recteur. Il faut espÃĐrer que le choix des recteurs se portera toujours sur un professeur particuliÃĻrerement estimÃĐ de ses collÃĻgues et faisant partie de l'Association amicale du lycÃĐe. Mais lors mÊme que cette mesure ne serait pas modifiÃĐe dans l'avenir, elle aurait encore besoin d'Être complÃĐtÃĐe. Aujourd'hui que le rÃīle des rÃĐpÃĐtiteurs et des professeurs-adjoints est nettement dÃĐfini, on ne voit pas pourquoi les uns et les autres n'apporteraient pas, eux aussi, le concours de leur expÃĐrience et de leur zÃĻle à la direction d'un ÃĐtablissement dont la prospÃĐritÃĐ offre pour eux un intÃĐrÊt matÃĐriel et moral de premier ordre. Le professorat. â L'enseignement est donnÃĐ : 1° Par des professeurs titulaires reçus au concours des diffÃĐrents ordres d'agrÃĐgation (mathÃĐmatiques, physique, sciences naturelles, â philosophie, histoire, lettres, grammaire, langues vivantes), du certificat d'aptitude à l'enseignement des classes ÃĐlÃĐmentaires, et du certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin. Le titre d'agrÃĐgÃĐ est confÃĐrÃĐ aux candidats qui ont subi deux catÃĐgories d'ÃĐpreuves, des ÃĐpreuves scientifiques devant les FacultÃĐs et lâEcole normale supÃĐrieure, sanctionnÃĐes par un certificat d'ÃĐtudes supÃĐrieures, â des ÃĐpreuves professionnelles (dissertations, leçons, explications de textes) devant des jurys d'agrÃĐgation nommÃĐs par le ministre. Ces jurys, qui ne se prÃĐoccupaient auparavant que de l'ÃĐtendue et de la profondeur des connaissances acquises, doivent tenir le plus grand compte des qualitÃĐs de professeur, des aptitudes pÃĐdagogiques des candidats. L'Ecole normale supÃĐrieure est rÃĐorganisÃĐe. Depuis longtemps son enseignement faisait double emploi avec celui de l'universitÃĐ de Paris. Le petit nombre de ses professeurs obligeait mÊme les normaliens à suivre assidÃŧment les cours de la FacultÃĐ. La rÃĐforme de 1902 Ta cependant maintenue ; mais elle ne doit plus Être qu'un ÂŦ Institut pÃĐdagogique Âŧ. Ses ÃĐlÃĻves reçoivent la prÃĐparation professionnelle en commun avec les ÃĐtudiants de la Sorbonne candidats à l'agrÃĐgation. Ils sont nommÃĐs à la suite d'un concours auquel se prÃĐsentent tous les candidats à l'Ecole normale et aux bourses de licence. Une liste est dressÃĐe des candidats admis. Les premiers entrent à l'Ecole normale, les autres sont rÃĐpartis comme boursiers de licence entre les facultÃĐs de province. (En 1909, dans la section des lettres, les 3b premiers d'une liste de 75 noms ont ÃĐtÃĐ nommÃĐs ÃĐlÃĻves de l'Ecole normale supÃĐrieure.) Tous les candidats à l'agrÃĐgation sont tenus de faire un stage dans les lycÃĐes (pendant trois mois, à raison de deux classes par semaine â ou pendant six semaines, à raison de quatre classes). L'obligation de ce stage est excellente, en principe. Les ÃĐtudiants ne peuvent que trouver profit à ces premiers essais d'enseignement sous la direction trÃĻs bienveillante de maîtres expÃĐrimentÃĐs. Mais, dans la pratique, elle se heurte à des difficultÃĐs, surtout dans les classes oÃđ le temps est dÃĐjà trÃĻs mesurÃĐ pour traiter toutes les questions d'un programme, dont il est impossible de rien nÃĐgliger sans compromettre le succÃĻs des ÃĐlÃĻves aux examens de fin d'annÃĐe ; 2° Par des professeurs titulaires non agrÃĐgÃĐs, choisis parmi les chargÃĐs de cours rÃĐunissant certaines conditions de mÃĐrite et d'anciennetÃĐ (Loi de finances du 22 avril 1905) ; 3° Par des professeurs chargÃĐs de cours, pourvus du titre de licenciÃĐ ou du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes. Les chargÃĐs de cours licenciÃĐs sont recrutÃĐs parmi les meilleurs professeurs des collÃĻges. Remarquons que les chargÃĐs de cours actuellement en exercice n'ont pas tous cette provenance. Pendant longtemps, le nombre relativement restreint des agrÃĐgÃĐs a nÃĐcessairement entraînÃĐ la nomination comme chargÃĐs de cours d'admissibles à l'agrÃĐgation, d'anciens ÃĐlÃĻves de l'Ecole normale, d'anciens boursiers de licence recommandÃĐs aux recteurs par les universitÃĐs qui les avaient prÃĐparÃĐs, etc. ; 4° Par les anciens rÃĐpÃĐtiteurs que la rÃĐforme de 1902 a promus aux fonctions et au titre de professeurs adjoints. Le professorat adjoint. â En 1902, la Commission parlementaire et le ministre ne pouvaient manquer d'Être frappÃĐs de ÂŦ la disconvenance [qui existait] entre les titres requis des rÃĐpÃĐtiteurs et leurs fonctions actuelles Âŧ. Les rÃĐpÃĐtiteurs bacheliers et licenciÃĐs ÃĐtaient toujours astreints aux anciennes besognes de surveillance d'internat que remplissaient jadis les maîtres d'ÃĐtude. Or quelle comparaison ÃĐtablir entre ces rÃĐpÃĐtiteurs intelligents, instruits, d'une tenue irrÃĐprochable, d'une parfaite dignitÃĐ de vie, et leurs malheureux prÃĐdÃĐcesseurs, dÃĐpourvus trop souvent de tout titre universitaire, humble personnel laissÃĐ Ã l'entiÃĻre discrÃĐtion des proviseurs et des principaux, surveillants qu'il fallait surveiller, et que prÃĐposait à la garde matÃĐrielle des internes la confiance inquiÃĻte et trop avertie des administrations collÃĐgiales? DÃĻs lors, comment refuser de mieux adapter les fonctions aux titres et à la valeur de ce personnel nouveau que la diffusion de l'enseignement supÃĐrieur avait insensiblement substituÃĐ Ã l'ancien, pour le plus grand bien de l'UniversitÃĐ? M. LÃĐon Bourgeois ne s'inspirait-il pas de la rÃĐalitÃĐ la plus vraie quand il disait à la Commission parlementaire : ÂŦ Nous avons mis en deux catÃĐgories distinctes le professeur et le rÃĐpÃĐtiteur. Chacun d'eux, prÃĐcisÃĐment à cause de cette sÃĐparation rÃĐglementaire, considÃĻre l'autre, je me garderai bien de dire comme un ennemi, mais comme une personne inconnue, ÃĐtrangÃĻre, n'ayant rien à faire dans son service à lui. Ne devraient-ils pas, au contraire, se considÃĐrer comme des collÃĻgues ÃĐtroitement associÃĐs pour l'ÃĐducation des enfants? J'admettrais que le professeur pÃŧt et dÃŧt mÊme, dans certains cas, prendre des enfants en dehors de la classe et les faire travailler ; j'admettrais aussi que les rÃĐpÃĐtiteurs pussent contribuer à l'enseignement pour certaines parties ; je les chargerais de cours complÃĐmentaires. Pourquoi ne feraient-ils pas des cours de langues vivantes, de sciences ÃĐlÃĐmentaires, etc., s'ils possÃĻdent les licences correspondantes? Âŧ Il y a, dans ce corps de rÃĐpÃĐtiteurs, dÃĐclarait le ministre, ÂŦ un fonds de bon vouloir, d'intelligence et de savoir qui s'use dans l'inaction et que nous devons mieux utiliser Âŧ. Sans doute, certaines satisfactions avaient dÃĐjà ÃĐtÃĐ accordÃĐes aux rÃĐpÃĐtiteurs. Depuis quinze ans ils ÃĐtaient nommÃĐs par le ministre ; on leur avait donnÃĐ des garanties au point de vue de la discipline, du service exigible et de l'externement aprÃĻs un certain temps de service. Tour le traitement et pour la retraite, on leur promettait de les assimiler aux professeurs de collÃĻge du mÊme ordre. On voulait donc faire de la carriÃĻre du rÃĐpÃĐtitorat une carriÃĻre ÃĐquivalant à celle des professeurs de collÃĻge. Mais, matÃĐriellement ÃĐquivalente, elle demeurait, moralement, trÃĻs infÃĐrieure, confinÃĐe dans la surveillance des dortoirs, des rÃĐcrÃĐations, des promenades. Etait-il cependant nÃĐcessaire d'aller plus loin? Ne suffisait-il pas de rappeler aux rÃĐpÃĐtiteurs que le rÃĐpÃĐtitorat n'ÃĐtait pas une carriÃĻre, que les rÃĐpÃĐtiteurs licenciÃĐs et bacheliers seraient appelÃĐs, sur leur demande, aux chaires vacantes des collÃĻges? Ces chaires de collÃĻge, n'est-ce pas ce qu'on leur offre, aujourd'hui, comme rÃĐcompense d'un stage maximum de dix ans dans le professorat-adjoint des lycÃĐes? Mais n'anticipons pas. Le 14 fÃĐvrier 1902, la Chambre ratifia de son vote la proposition du ministre, dÃĐjà adoptÃĐe par la Commission de l'enseignement : ÂŦ Les rÃĐpÃĐtiteurs actuellement en activitÃĐ peuvent Être promus aux fonctions et au titre de professeurs-adjoints Âŧ. Cette rÃĐforme a suscitÃĐ bien des polÃĐmiques. Nous nous contenterons de signaler les difficultÃĐs d'application qu'elle a rencontrÃĐes. D'abord les rÃĐpÃĐtiteurs, dispensÃĐs dÃĐsormais de la surveillance d'internat, confiÃĐe à des surveillants spÃĐciaux dont nous aurons à parler, se trouvaient trop nombreux. Le maintien en surnombre de beaucoup d'entre eux a eu pour effet d'immobiliser dans les collÃĻges une foule de rÃĐpÃĐtiteurs qu'aucune vacance n'appelait plus dans les lycÃĐes. Fuis, dans quelle mesure associerait-on les rÃĐpÃĐtiteurs à l'enseignement ? Les professeurs, habituÃĐs à un complÃĐment de traitement, grÃĒce aux heures supplÃĐmentaires qui leur ÃĐtaient imposÃĐes en plus de leur maximum de service, ne virent pas sans mÃĐcontentement ces prÃĐcieuses heures constituer le service des rÃĐpÃĐtiteurs. à un autre point de vue, plus sÃĐrieux et plus pÃĐdagogique, ÃĐtait-il sans inconvÃĐnient de confier l'enseignement à tous les rÃĐpÃĐtiteurs, licenciÃĐs ou non, qui, dans l'enthousiasme de la premiÃĻre heure, demandaient à faire des heures de classe et n'avaient qu'à les demander pour les obtenir? A l'ÃĐpreuve, lâinconvÃĐnient se rÃĐvÃĐla tellement grand et les plaintes des parents furent si vives que les proviseurs se virent bientÃīt forcÃĐs de choisir avec quelque discernement ceux qui ÂŦ pouvaient Âŧ Être appelÃĐs aux fonctions de professeur adjoint. Mais les licenciÃĐs eux-mÊmes qui n'avaient jamais fait leurs preuves comme professeurs, qui n'avaient jusque-là manifestÃĐ leur zÃĻle pour l'enseignement qu'en refusant couramment des chaires de collÃĻge, ÃĐtaient-ils bien qualifiÃĐs pour professer dans des lycÃĐes trÃĻs importants oÃđ les chargÃĐs de cours et les agrÃĐgÃĐs n'arrivent qu'aprÃĻs un long et fructueux stage dans des lycÃĐes de dÃĐbut ? De plus, ce lÃĐgitime et lent avancement des professeurs titulaires et chargÃĐs de cours n'ÃĐtait-il pas menacÃĐ par la distribution d'un grand nombre d'heures d'enseignement aux rÃĐpÃĐtiteurs des grands lycÃĐes ? Les instructions de 1902, adressÃĐes aux proviseurs, autorisaient bien des craintes : ÂŦ On doit s'interdire de demander la suppression d'une chaire qui serait remplacÃĐe par un service complet d'enseignement donnÃĐ Ã un rÃĐpÃĐtiteur ; mais, en certains cas, la suppression d'une chaire d'importance relativement secondaire pourra Être admise s'il s'agit de rÃĐpartir entre plusieurs rÃĐpÃĐtiteurs un enseignement donnÃĐ dans plusieurs classes Âŧ. C'est en vain que, par une circulaire du 7 aoÃŧt 1905, M. Bienvenu-Martin, ministre de l'instruction publique, s'est efforcÃĐ de rassurer les professeurs en stipulant que les professeurs-adjoints pourraient Être chargÃĐs de quelques confÃĐrences complÃĐmentaires pour des groupes d'ÃĐlÃĻves faibles, que le dÃĐpeçage des cours essentiels et des classes magistrales ÃĐtait interdit, que les enseignements du français, du latin et du grec formaient dans une mÊme classe un faisceau qui ne doit pas Être rompu. Deux ans plus tard, le rapporteur du budget de l'instruction publique constate que dans les huit lycÃĐes suivants : Buffon, Condorcet, Henri IV, Alais, Bordeaux, Lille, Lons-le-Saulnier, Marseille, les heures d'enseignement confiÃĐes à des professeurs-adjoints sont assez nombreuses pour donner lieu à la crÃĐation de huit chaires de mathÃĐmatiques et à celle d'une chaire de physique au lycÃĐe de Marseille. Les proviseurs autonomes ne devaient-ils pas cÃĐder trop facilement à la tentation d'utiliser le professorat-adjoint pour rÃĐaliser de notables ÃĐconomies, par la transformation des heures supplÃĐmentaires payÃĐes en heures d'enseignement imposÃĐes aux rÃĐpÃĐtiteurs? Si l'on ajoute enfin que des rÃĐpÃĐtiteurs ont ÃĐtÃĐ chargÃĐs de certains enseignements auxquels leurs ÃĐtudes antÃĐrieures ne les avaient nullement prÃĐparÃĐs, on comprendra que les professeurs aient pu faire entendre cette plainte dÃĐsintÃĐressÃĐe qui a toute la valeur d'un avertissement: L'amour des ÃĐconomies est poussÃĐ jusqu'à l'abaissement du niveau des ÃĐtudes, et l'UniversitÃĐ est en train de perdre, par suite d'une rÃĐforme inconsidÃĐrÃĐe, son principal titre a la confiance et à l'estime des parents, sa supÃĐrioritÃĐ jusqu'ici incontestÃĐe sur tous les autres ÃĐtablissements d'instruction secondaire. Mal accueillie des professeurs de lycÃĐe, cette rÃĐforme du rÃĐpÃĐtitorat ne l'ÃĐtait pas mieux des professeurs de collÃĻge, qui craignaient de voiries professeurs-adjoints leur fermer l'accÃĻs des lycÃĐes en se faisant nommer, sur place, chargÃĐs de cours, aprÃĻs un certain temps d'exercice. M. Georges Leygues ne disait il pas, dans sa lettre à M. Ribot : ÂŦ Auxiliaires rÃĐels des professeurs, les rÃĐpÃĐtiteurs deviendront de vÃĐritables professeurs-adjoints et seront dÃĐsignÃĐs pour les fonctions de professeurs titulaires Âŧ? Parmi les rÃĐpÃĐtiteurs eux-mÊmes, la rÃĐforme a ÃĐtÃĐ trÃĻs diversement apprÃĐciÃĐe. On peut dire qu'en gÃĐnÃĐral elle les a plus surpris que charmÃĐs. Le titre de professeur-adjoint, qui relÃĻve leur prestige, n'est pas pour leur dÃĐplaire, mais beaucoup d'entre eux, pour ne parler que des rÃĐpÃĐtiteurs licenciÃĐs, estiment qu'il n'est pas nÃĐcessaire, pour le mÃĐriter, de participer à l'enseignement proprement dit. Les bribes d'enseignement qu'on leur offre dans les petites classes n'ont rien qui les tente. Ils pensent, non sans raison, que la direction, si dÃĐlicate quand elle est effective, du travail des ÃĐlÃĻves pendant l'ÃĐtude ; que des cours complÃĐmentaires exclusivement rÃĐservÃĐs aux ÃĐlÃĻves que leur faiblesse met hors d'ÃĐtat de suivre efficacement leur classe, constitueraient une collaboration trÃĻs rÃĐelle et trÃĻs suffisante avec les professeurs. Quoi qu'il en soit, le dÃĐcret du 30 juillet et la circulaire du 23 septembre 1909 viennent enfin d'organiser officiellement le professorat-adjoint. L'avenir nous apprendra ce que vaut cette organisation, dont voici les dispositions essentielles : Dans les lycÃĐes, les rÃĐpÃĐtiteurs sont fonctionnaires de l'externat. Ils sont chargÃĐs de la surveillance, au point de vue de l'ÃĐducation et du maintien de la discipline, dans tous les services, mouvements et rÃĐcrÃĐa-tiens auxquels participent les externes et externes surveillÃĐs. Le temps pendant lequel les ÃĐtudes leur sont confiÃĐes doit Être effectivement consacrÃĐ par eux au contrÃīle et à la direction du travail des ÃĐlÃĻves. Le titre de professeur-adjoint peut Être confÃĐrÃĐ par le ministre, sur la proposition du recteur (aprÃĻs avis de la section de l'enseignement secondaire du ComitÃĐ consultatif), aux rÃĐpÃĐtiteurs licenciÃĐs ou certifiÃĐs comptant au moins deux ans de services et vingt-cinq ans d'ÃĒge, qui auront enseignÃĐ avec succÃĻs dans les classes des lycÃĐes ou collÃĻges, pendant une durÃĐe totale de cent heures au moins. Le titre de professeur-adjoint est confÃĐrÃĐ pour une pÃĐriode de dix ans. La durÃĐe des services en qualitÃĐ de professeur-adjoint chargÃĐ d'enseignement assure aux rÃĐpÃĐtiteurs un tour de choix pour l'obtention des chaires du premier ordre des collÃĻges. A moins d'insuccÃĻs rÃĐguliÃĻrement constatÃĐ dans leur enseignement, les professeurs-adjoints seront nommÃĐs à une chaire de premier ordre dans un collÃĻge, au plus tard à l'expiration de la durÃĐe dÃĐcennale de leurs fonctions. Si, à ce moment, faute de poste vacant, ils n'ont pu Être nommÃĐs professeurs de collÃĻge, ils conserveront provisoirement leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur nomination à une chaire de collÃĻge. Eu cas d'insuccÃĻs rÃĐguliÃĻrement constatÃĐ, ils reprennent le titre et conservent seulement les fonctions de rÃĐpÃĐtiteur. AprÃĻs un premier ÃĐchec, les rÃĐpÃĐtiteurs pourront Être admis à une deuxiÃĻme et derniÃĻre ÃĐpreuve d'une durÃĐe ÃĐgale ; faute de l'avoir subie avec succÃĻs, ils cesseront de participer à renseignement. Il est en effet de l'intÃĐrÊt gÃĐnÃĐral, aussi bien de celui des ÃĐtudes que de celui du rÃĐpÃĐtiteur, de ne pas prolonger inutilement une ÃĐpreuve dÃĐjà suffisamment probante. Le Conseil supÃĐrieur de l'instruction publique n'a pas cru qu'il fÃŧt possible de donner indistinctement aux rÃĐpÃĐtiteurs licenciÃĐs et bacheliers actuellement en fonctions le droit de prÃĐtendre au titre et aux fonctions de professeur-adjoint. ConsidÃĐrant que, depuis plusieurs annÃĐes dÃĐjà , les bacheliers n'ont plus accÃĻs aux chaires de collÃĻge, il a estimÃĐ qu'il y aurait une sorte d'anomalie à leur confier des services d'enseignement dans les lycÃĐes oÃđ les classes sont, le plus souvent, beaucoup plus nombreuses que dans les collÃĻges. L'enseignement dont seront chargÃĐs les professeurs-adjoints doit correspondre rigoureusement à la spÃĐcialitÃĐ du titre dont ils sont pourvus. On ne confiera à un professeur-adjoint que les enseignements portÃĐs au plan d'ÃĐtudes pour une, deux ou trois heures au plus par semaine. Dans une mÊme classe, deux professeurs-adjoints au plus pourront participer à l'enseignement. Dans une mÊme classe, le total des heures confiÃĐes à des professeurs-adjoints ne dÃĐpassera pas cinq heures par semaine. Dans un mÊme ÃĐtablissement, le nombre total des heures d'enseignement confiÃĐes aux professeurs-adjoints et aux rÃĐpÃĐtiteurs dans une mÊme spÃĐcialitÃĐ ne pourra atteindre le minimum nÃĐcessaire pour la crÃĐation d'une nouvelle chaire de cette spÃĐcialitÃĐ. Le nombre total des heures d'enseignement confiÃĐes à un mÊme professeur-adjoint sera de six au plus par semaine. Les confÃĐrences complÃĐmentaires aux ÃĐlÃĻves faibles, sous la direction du professeur de la classe, constituent une partie essentielle de la fonction de professeur-adjoint. La circulaire ministÃĐrielle conclut en faisant remarquer que le dÃĐcret du 30 juillet 1909 ÂŦ rÃĻgle avec toute la prÃĐcision possible des questions qui, depuis plusieurs annÃĐes, prÃĐoccupaient les rÃĐpÃĐtiteurs et les professeurs. Il marque nettement que le rÃīle essentiel du rÃĐpÃĐtiteur est d'assurer la discipline intÃĐrieure des lycÃĐes et collÃĻges et de diriger le travail des ÃĐlÃĻves dans les ÃĐtudes, et c'est là une fonction dont l'importance est trop ÃĐvidente pour qu'on ne cherche pas à en rendre l'exercice à la fois plus facile et plus fÃĐcond. D'autre part, il fixe dans quelles limites les rÃĐpÃĐtiteurs pourront, par la participation à l'enseignement, se prÃĐparer aux fonctions de professeur, tout en augmentant leur autoritÃĐ morale. Âŧ Les rÃĐpÃĐtiteurs seront-ils satisfaits ? Ce qui est certain, c'est que ces questions ainsi tranchÃĐes continueront de ÂŦ prÃĐoccuper Âŧ les professeurs, auxquels on fera difficilement oublier que les reprÃĐsentants de leur FÃĐdÃĐration nationale des professeurs de lycÃĐes ont ÃĐtÃĐ seuls exclus de la commission chargÃĐe par le ministre d'ÃĐtudier le fonctionnement dÃĐfinitif du professorat-adjoint. Les surveillants d'internat. â Le rÃĐgime nouveau des lycÃĐes a dÃĐterminÃĐ l'apparition des surveillants d'internat. Ils sont chargÃĐs de la surveillance purement matÃĐrielle des dortoirs, promenades, etc. Mais il n'y a pas, en matiÃĻre d'ÃĐducation, de surveillance purement matÃĐrielle. Aussi le choix de ces surveillantsâ qui passent de nombreuses heures chaque jour avec les ÃĐlÃĻves, et qui, par leur caractÃĻre, leurs maniÃĻres, leur valeur intellectuelle et morale, peuvent exercer sur eux une excellente ou une dÃĐplorable influenceâ est-il particuliÃĻrement dÃĐlicat. Il est confiÃĐ au proviseur, qui organise comme il l'entend le rÃĐgime et le budget de l'internat. Ces surveillants d'internat ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne sont pas nommÃĐs par le ministre, ils ne versent aucune retenue pour la retraite, et l'on n'a pas hÃĐsitÃĐ Ã les laisser bÃĐnÃĐficier de la loi de 1884: ils se sont groupÃĐs en syndicats. Ils se serviront ÃĐvidemment dÃĐ ce droit pour amÃĐliorer leur situation. La nÃĐcessitÃĐ de faire des ÃĐconomies oblige les proviseurs à leur demander beaucoup de temps contre trÃĻs peu d'argent. Ce prolÃĐtariat des lycÃĐes ne va-t-il pas s'agiter ou ÂŦ s'aigrir dans une vie misÃĐrable Âŧ (Lanson) ? Pour parer à ce danger, il faut empÊcher la surveillance d'internat de devenir une carriÃĻre, et certains proviseurs attribuent dÃĐjà à ces modestes fonctions une durÃĐe maximum. Dans les lycÃĐes de facultÃĐ, ces surveillances sont trÃĻs demandÃĐes, parce qu'elles constituent une vÃĐritable bourse d'ÃĐtudes. On recrute trÃĻs facilement d'excellents surveillants parmi les jeunes ÃĐtudiants, les instituteurs-adjoints sortant des ÃĐcoles normales et dÃĐsirant suivre les cours de l'universitÃĐ, les rÃĐpÃĐtiteurs de collÃĻge aspirant à une licence, etc. Mais dans les villes de moyenne importance ou ÃĐloignÃĐes du chef-lieu de l'acadÃĐmie, le recrutement est difficile, et l'administration locale peut Être tentÃĐe de conserver indÃĐfiniment les surveillants dont elle apprÃĐciera les services. Une rÃĻgle prÃĐcise serait donc nÃĐcessaire, dans l'intÃĐrÊt des surveillants d'internat non moins que dans celui des proviseurs et des ÃĐlÃĻves. La durÃĐe de ces fonctions ne devrait pas dÃĐpasser quatre annÃĐes. Les ÂŦ Amicales Âŧ de l'enseignement secondaire. â Depuis 1904, les professeurs, s'autorisant de la loi de 1901 sur les associations, ont fondÃĐ entre professeurs d'un mÊme lycÃĐe des Amicales (A1). Les Amicales d'une mÊme acadÃĐmie se groupent pour former une FÃĐdÃĐration rÃĐgionale (A2). Les FÃĐdÃĐrations rÃĐgionales rÃĐunies constituent la FÃĐdÃĐration nationale (A5), dont le bureau permanent, ou commission exÃĐcutive, prÃĐpare les congrÃĻs annuels et doit reprÃĐsenter lÃĐ corps entier des professeurs dans toutes les circonstances et toutes les questions qui l'intÃĐressent. Les membres ÃĐlus de l'enseignement secondaire aux Conseils acadÃĐmiques et au Conseil supÃĐrieur de l'instruction publique auront certainement à s'inspirer des voeux exprimÃĐs par les FÃĐdÃĐrations rÃĐgionales et par la FÃĐdÃĐration nationale. Il existe ÃĐgalement une FÃĐdÃĐration des professeurs de collÃĻge et une FÃĐdÃĐration des rÃĐpÃĐtiteurs. â L'A4, non constituÃĐe, serait la FÃĐdÃĐration des trois FÃĐdÃĐrations. RÃĐforme des traitements. â On peut dire que la rÃĐforme de 1902 a tout modifiÃĐ dans l'enseignement secondaire, sauf les traitements, dont beaucoup sont restÃĐs immuables depuis 1872. Seuls les proviseurs ont reçu en 1902 des avantages importants. Cependant le rÃĐgime de l'autonomie, d'abord essayÃĐ dans quelques lycÃĐes et progressivement gÃĐnÃĐralisÃĐ jusqu'au 1er janvier 1908, a eu pour effet de mettre le plus d'ÃĐlÃĻves possible dans chaque division et d'imposer à chaque professeur son maximum rÃĐglementaire d'heures de service. La statistique des congÃĐs pour raisons de santÃĐ prouve qu'à ce dur rÃĐgime le personnel enseignant se fatigue vite. Le nombre de ces congÃĐs est passÃĐ de 88 en 1901-1902 à 212 en 1905-1906, et a suivi depuis lors une progression rÃĐguliÃĻre. Les prÃĐvisions pour frais de supplÃĐance des fonctionnaires atteints de maladie ont atteint, au budget de 1908, le chiffre de 110 000 francs. M, Couyba, rapporteur du budget de l'instruction publique, n'a pas hÃĐsitÃĐ Ã attribuer ce fÃĒcheux ÃĐtat de choses à la surcharge du personnel ; et, tout en tenant compte de l'accroissement numÃĐrique de ce personnel, il paraît difficile de l'expliquer autrement. Or, de 1902 à 1910, les professeurs agrÃĐgÃĐs et les chargÃĐs de cours ne se sont vu accorder aucune compensation pÃĐcuniaire. On n'a relevÃĐ lÃĐgÃĻrement, en 1905 et 1906, que les traitements des professeurs des classes ÃĐlÃĐmentaires et ceux des rÃĐpÃĐtiteurs. La situation matÃĐrielle des professeurs, loin de s'amÃĐliorer depuis 1873, a donc toujours ÃĐtÃĐ en empirant. La suppression, en 1887, des catÃĐgories de lycÃĐes, et le classement des professeurs des diffÃĐrents ordres en plusieurs classes, ont eu pour effet d'encombrer les premiÃĻres classes, dont les traitements sont les plus ÃĐlevÃĐs, de beaucoup de professeurs jeunes ; d'oÃđ lenteur extrÊme des promotions dans les basses classes et impossibilitÃĐ d'atteindre à la premiÃĻre classe avant la retraite. Si l'on ajoute à cela que l'enseignement secondaire des jeunes filles s'est organisÃĐ et a cessÃĐ de faire appel aux professeurs des lycÃĐes de garçons, â que le professorat-adjoint a entraînÃĐ la suppression des heures supplÃĐmentaires, â que la valeur de l'enseignement rend de plus en plus rares les leçons particuliÃĻres, on concevra sans peine que les professeurs, obligÃĐs de faire face, avec des ressources toujours dÃĐcroissantes, au renchÃĐrissement gÃĐnÃĐral du prix de la vie, aient fini par faire entendre une plainte trop justifiÃĐe, et que le nombre des candidats au professorat ait baissÃĐ dans des proportions inquiÃĐtantes pour le bon recrutement de l'UniversitÃĐ, comme le montre le tableau ci-dessous :
La Commission extraparlementaire. â En 1906, 6ur la proposition de M Couyba, et d'un grand nombre de ses collÃĻgues, la Chambre dÃĐcida la nomination d'une Commission extraparlementaire chargÃĐe d'ÃĐtudier les amÃĐliorations à apporter aux traitements. Des dÃĐputÃĐs, des sÃĐnateurs, des membres de la haute administration universitaire, des reprÃĐsentants des associations de toutes les catÃĐgories du personnel se rÃĐunirent, sous la prÃĐsidence de M. Bienvenu-Martin, pour ÃĐcouter les dolÃĐances des intÃĐressÃĐs. ÂŦ La Chambre s'en est donc remise aux reprÃĐsentants des intÃĐressÃĐs eux-mÊmes du soin de dresser les modestes cahiers de leurs voeux lÃĐgitimes. Âŧ Ils se sont montrÃĐs si prudents, si rÃĐservÃĐs dans leurs revendications, que les conclusions de la Commission ont paru rÃĐalisables. Mais ces conclusions, formulÃĐes dans le rapport de M. Faivre-Dupaigne, comment les rÃĐaliserait-on? Dans la sÃĐance du 6 novembre 1907, M. Aristide Briand, ministre de l'instruction publique, et M. Caillaux, ministre des finances, prirent l'engagement de commencer, dÃĻs l'exercice 1909, la rÃĐalisation des rÃĐformes demandÃĐes. La loi du 7 avril 1908 apporta au personnel de l'enseignement secondaire tout entier des conditions d'avancement plus rapides et plus sÃŧres. La Commission extraparlementaire avait placÃĐ cette rÃĐforme en tÊte de celles dont elle proposait l'accomplissement. GrÃĒce au maximum de stage dans chaque classe, les nouveau-venus sont dÃĐsormais assurÃĐs de ne plus attendre indÃĐfiniment, comme leurs aînÃĐs, des promotions alÃĐatoires. Quant aux professeurs dÃĐjà anciens dans la carriÃĻre et qui ont connu les mauvais jours, ils peuvent espÃĐrer arriver à la premiÃĻre classe de leur grade, â si toutefois la loi de 1908 se complÃĻte par des mesures favorables à ceux d'entre eux qui ont ÃĐtÃĐ trop retardÃĐs dans leur avancement. Mais il restait à procÃĐder au relÃĻvement des traitements et à dÃĐterminer le nombre d'annuitÃĐs sur lesquelles serait rÃĐpartie la dÃĐpense. La Commission extraparlementaire demandait qu'on appliquÃĒt à l'enseignement secondaire le procÃĐdÃĐ de relÃĻvement adoptÃĐ pour l'enseignement primaire en 1905, 1906, 1907 et 1908. En consÃĐquence, quatre annuitÃĐs ÃĐgales de 1266 725 fr. ou, au plus, cinq annuitÃĐs ÃĐgales de 1 013 380 fr., seraient allouÃĐes à partir de 1910. L'administration de l'instruction publique n'a pas cru devoir recourir à ce systÃĻme, auquel elle a trouvÃĐ divers inconvÃĐnients. Elle n'a pas jugÃĐ ÃĐquitable de faire attendre quatre ou cinq ans la derniÃĻre fraction d'une augmentation de 100 francs à des fonctionnaires qui ne recevraient que 25 ou 20 francs par an, tandis que certains de leurs collÃĻgues pourraient toucher, dÃĻs la premiÃĻre annÃĐe, 250 ou 200 francs, parce que le total de leur augmentation doit s'ÃĐlever à 1000 francs. Certes, il ÃĐtait telle catÃĐgorie qui aurait mÃĐritÃĐ de bÃĐnÃĐficier plus rapidement de l'augmentation ; mais des raisons d'ordre administratif et d'ordre budgÃĐtaire ne le permirent pas. Le systÃĻme proposÃĐ par le ministre de l'instruction publique à son collÃĻgue des finances consistait dans une distribution uniforme, pendant quatre ans, de 100 francs par an d'augmentation à chaque fonctionnaire jusqu'à concurrence de l'augmentation qui lui doit Être dÃĐvolue. Enfin, ceux dont l'augmentation totale de traitement excÃĐderait 400 francs devraient se voir attribuer le solde au dÃĐbut de la cinquiÃĻme annÃĐe. Si ce projet avait ÃĐtÃĐ adoptÃĐ par le ministÃĻre des finances, les annuitÃĐs nÃĐcessaires pour couvrir la dÃĐpense auraient ÃĐtÃĐ de :
La derniÃĻre annuitÃĐ parut trop lourde au ministÃĻre des finances, qui demanda que la pÃĐriode de relÃĻvement des traitements fÃŧt prolongÃĐe d'une annÃĐe et que l'on n'attribuÃĒt, la cinquiÃĻme annÃĐe, qu'une augmentation de 100 francs à tous ceux dont l'augmentation totale devait dÃĐpasser 500 francs. La sixiÃĻme annÃĐe seulement, les fonctionnaires augmentÃĐs de plus de 500 francs recevront le complÃĐment dÃĐfinitif de leur traitement. On peut donc dresser, dÃĻs maintenant, de la maniÃĻre suivante, le tableau des traitements dans les lycÃĐes de garçons pour 1915 :
NOTA. â Les demandes des fonctionnaires des lycÃĐes de garçons, indÃĐpendamment des indemnitÃĐs de rÃĐsidence, s'ÃĐlevaient à 4 108 800 fr. ; les rÃĐductions opÃĐrÃĐes par la Commission extraparlementaire ont ÃĐtÃĐ de 1 144 520 fr. Le tableau suivant rÃĐsume les relÃĻvements de traitements qui ont ÃĐtÃĐ accordÃĐs aux fonctionnaires des collÃĻges de garçons et qui leur seront versÃĐs en six annuitÃĐs, comme aux lycÃĐes :
(a) En dehors des 136 rÃĐpÃĐtiteurs ci-dessus, les autres rÃĐpÃĐtiteurs sont de 6e classe ou stagiaires, sans augmentation. NOTA. â Les demandes des fonctionnaires des collÃĻges de garçons s'ÃĐlevaient à 3 079 600 francs ; les rÃĐductions opÃĐrÃĐes parla Commission ont ÃĐtÃĐ de 1 790 700 francs. Les bourses dans l'enseignement secondaire des garçons. â L'enseignement secondaire permet seul d'entrer dans les carriÃĻres libÃĐrales, d'obtenir les fonctions publiques qui sont au sommet de la hiÃĐrarchie, de bÃĐnÃĐficier de la haute culture littÃĐraire ou scientifique. Les avantages sociaux, politiques, intellectuels et ÃĐconomiques qu'il porte avec lui ne doivent pas Être le privilÃĻge exclusif d'une classe sociale. C'est sans doute à cette pensÃĐe que la RÃĐpublique a obÃĐi en dotant de sommes considÃĐrables, mais insuffisantes, les crÃĐdits affectÃĐs aux bourses. Celles-ci devraient donc Être accordÃĐes à l'ÃĐlite des ÃĐlÃĻves qui frÃĐquentent l'ÃĐcole primaire ou l'ÃĐcole primaire supÃĐrieure. Or, il ne semble pas que ce soit tout à fait ainsi que les choses se passent : en 1900, le ministre de l'instruction publique accordait 1000 bourses dans les lycÃĐes ou collÃĻges de garçons. Sur les candidats admis, 707 ÃĐtaient dÃĐjà ÃĐlÃĻves de l'enseignement secondaire, 275 seulement venaient directement de l'enseignement primaire ou primaire supÃĐrieur. En 1901, 253 bourses furent accordÃĐes à des ÃĐlÃĻves sortant de l'enseignement primaire ; en 1902, 278: 196 en 1903 ; 296 en 1904 ; 276 en 1905 ; 287 en 1906'. Si l'on admet que six ans reprÃĐsentent le temps moyen que passe au lycÃĐe un ÃĐlÃĻve boursier, il en rÃĐsulterait que 1586 boursiers actuellement dans les ÃĐtablissements de l'Etat auraient obtenu leurs bourses en quittant l'ÃĐcole primaire sans stage prÃĐalable dans les lycÃĐes ou collÃĻges. Ces 1586 boursiers reprÃĐsentent un peu plus du quart et un peu moins du tiers des 5528 boursiers qui se trouvent dans nos ÃĐtablissements d'enseignement secondaire. On le voit, l'obligation de suivre pendant un temps plus ou moins long, et aux frais de leurs parents, les cours des lycÃĐes ou collÃĻges, s'impose à la grande majoritÃĐ des boursiers. Il est ÃĐvident que l'immense majoritÃĐ des prolÃĐtaires ne peut pas s'imposer un tel sacrifice, mÊme pendant une courte durÃĐe. L'institution des bourses ne donne donc pas à cet ÃĐgard tous les rÃĐsultats qu'on en pourrait espÃĐrer. Elle ne les donne pas non plus parce que les programmes et la composition de la Commission d'examen arrivent à rÃĐserver le succÃĻs à ceux qui ont suivi durant un certain temps les cours du collÃĻge et du lycÃĐe. Les bourses devraient, à notre avis, Être rÃĐservÃĐes aux enfants que leurs parents ont confiÃĐs aux ÃĐcoles de l'Etat. L'accÃĻs de l'enseignement secondaire doit Être ouvert aux fils des prolÃĐtaires les plus pauvres, par la multiplication des bourses complÃĻtes d'internat qui feraient de ces enfants les ÂŦ ÃĐlÃĻves de la patrie Âŧ, selon la touchante et nette expression de Condorcet. Enfin, la grande majoritÃĐ des bourses â il faut en rÃĐserver pour les ÃĐlÃĻves de l'enseignement secondaire que des revers de fortune de leurs parents mettraient hors d'ÃĐtat de poursuivre leurs ÃĐtudes â devrait Être attribuÃĐe aux ÃĐlÃĻves qui viennent de terminer le cycle des ÃĐtudes primaires dans les ÃĐcoles publiques. Les jurys d'examen, composÃĐs d'instituteurs et de professeurs, s'assureraient plutÃīt de la rÃĐalitÃĐ des aptitudes des candidats que de la prÃĐcision de leurs connaissances en ce qui concerne les Pharaons ou le Forum. L'institution des bourses pourrait recevoir de faciles perfectionnements. Telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle rend nÃĐanmoins des services qui ne sont pas nÃĐgligeables. Les ÃĐlÃĻves des lycÃĐes et collÃĻges remportent chaque annÃĐe de brillants succÃĻs aux concours d'entrÃĐe des grandes ÃĐcoles. Les boursiers sont toujours reçus en plus grand nombre que leurs camarades payants, comme l'indiquent les chiffres ci-dessous : Ãcole normale : Les ÃĐtablissements secondaires de l'Etat ont fait recevoir, en 1906, 51 candidats sur 67 places. Les autres candidats reçus appartenaient à l'enseignement supÃĐrieur universitaire. Candidats boursiers reçus : 22 % ; candidats non boursiers, ÃĐlÃĻves de l'enseignement secondaire public, reçus : 16 %. Ecole polytechnique : ElÃĻves sortant des ÃĐtablissements de l'Etat : 138 admis sur 183 admissions, en 1906. Candidats boursiers reçus : 21 % ; candidats non boursiers : 20 %. Ecole de Saint-Cyr : Candidats boursiers reçus : 37 % ; candidats non boursiers reçus : 23 %. Ecole navale : Sur 48 places, 39 ont ÃĐtÃĐ obtenues par des ÃĐlÃĻves des lycÃĐes et collÃĻges de l'Etat, en 1906. Candidats boursiers reçus : 18 %. Candidats non boursiers reçus : 10 %. Institut agronomique ; Sur 61 places, 48 ont ÃĐtÃĐ obtenues par des ÃĐlÃĻves de l'enseignement secondaire public, en 1906. Candidats boursiers reçus : 70 % ; candidats non boursiers reçus : 38 %. Il ne faudrait pas croire que les boursiers qui ÃĐchouent chaque annÃĐe aux ÃĐcoles du gouvernement se trouvent ainsi dÃĐvoyÃĐs et grossissent le nombre des dÃĐclassÃĐs aigris et vaniteux. Il est assez rare que la premiÃĻre tentative rÃĐussisse dans ces difficiles concours. Finalement la plupart des boursiers arrivent au succÃĻs. Les moins favorisÃĐs sortent comme rÃĐpÃĐtiteurs ou professeurs adjoints dans l'enseignement secondaire. Mais il ne nous a pas ÃĐtÃĐ possible de dresser sur ce point une statistique rigoureuse. Les bourses en 1906-1907 ont ÃĐtÃĐ accordÃĐes dans la proportion de 18, 20 % (garçons) et de 27, 40 % (filles] à des enfants dont les parents appartenaient à renseignement primaire ; dans la proportion de 15, 63 % (garçons) et de 13, 10 % (filles) à des fils et filles de cultivateurs, fermiers, meuniers, artisans et ouvriers. Le tableau ci-dessous montrÃĐ que les enfants des membres de l'enseignement primaire, des artisans et des ouvriers, sont ceux qui reçoivent le plus grand nombre des bourses. Les membres de l'enseignement secondaire et supÃĐrieur ne figurent sur ce tableau que pour 2, 93 % (garçons). Remarquons que pour donner à ce pourcentage sa vÃĐritable signification, il ne faut pas oublier que les artisans, cultivateurs et ouvriers constituent l'immense majoritÃĐ de la population française, et que dÃĻs lors la situation qui leur est faite dans cette rÃĐpartition est singuliÃĻrement modeste. Nous ne demandons pas que l'on retire aux fils d'employÃĐs, de commerçants, de petits fonctionnaires les bourses qui leur sont accordÃĐes. Nous voudrions voir accroître le nombre de celles qu'obtiennent les enfants qui vont à l'ÃĐcole primaire et qui ne peuvent pas aller ailleurs, ne fÃŧt-ce que quelques mois. Il est dÃĐplorable que sur l'immense population scolaire des ÃĐcoles publiques de France, qui comprend une foule de garçons vifs, intelligents, laborieux, l'Etat ne trouve pas le moyen d'en appeler chaque annÃĐe plus de 300 à profiter de l'enseignement secondaire qu'il donne dans ses propres ÃĐtablissements.
On trouvera à la fin du prÃĐsent article des indications dÃĐtaillÃĐes sur les conditions à remplir pour l'obtention d'une bourse dans les lycÃĐes et collÃĻges de garçons et de filles, avec quelques autres documents officiels relatifs aux bourses. Population scolaire des lycÃĐes et collÃĻges de garçons. â Le tableau suivant montre l'accroissement de la population scolaire des lycÃĐes de garçons, de 1875 à 1908. Le nombre des ÃĐlÃĻves in ternes, qui a ÃĐtÃĐ en augmentant jusqu'en 1885, a constamment dÃĐcru depuis, tandis que le nombre des ÃĐlÃĻves externes s'est accru dans la proportion de 2 à 3 :
La diminution de l'effectif scolaire total, à partir de 1907, dont il a ÃĐtÃĐ tant parlÃĐ, a ÃĐtÃĐ insignifiante et est dÃĐjà complÃĻtement arrÊtÃĐe. Mais le nombre des internes subit une rÃĐduction trÃĻs sensible. Beaucoup de causes ont contribuÃĐ Ã cette dÃĐsertion de l'internat. La facilitÃĐ des moyens de transport et la multiplicitÃĐ des ÃĐtablissements secondaires permettent à beaucoup de parents, jadis obligÃĐs de se sÃĐparer de leurs enfants, de les garder aujourd'hui chez eux. De plus il s'est fondÃĐ des internats libres qui envoient leurs ÃĐlÃĻves suivre les cours des lycÃĐes. Certains parents, alarmÃĐs sans doute par les campagnes excessives menÃĐes contre l'internat du lycÃĐe, croient bon d'assurer à leurs fils le double bÃĐnÃĐfice d'une instruction universitaire et d'une ÃĐducation privÃĐe. Ajoutons que le chiffre total des ÃĐlÃĻves des lycÃĐes serait certainement plus ÃĐlevÃĐ si les ÃĐcoles primaires supÃĐrieures ne recevaient pas un grand nombre d'enfants qui constituaient autrefois une partie de la clientÃĻle secondaire. La mÊme remarque s'applique aux collÃĻges de garçons, dont la population scolaire est donnÃĐe dans le tableau ci-dessous :
La population scolaire des ÃĐtablissements secondaires de l'Etat ne cesse de s'accroître, depuis l'enquÊte parlementaire de 1902. Au 5 novembre 1906 le gain ÃĐtait de 16 642 ÃĐlÃĻves sur la statistique de 1901. On comptait, à cette date, 98 963 ÃĐlÃĻves (y compris l'AlgÃĐrie), soit 60 347 pour les lycÃĐes et 38 616 pour les collÃĻges. Pendant la mÊme pÃĐriode, les ÃĐtablissements libres laÃŊques gagnaient 3456 ÃĐlÃĻves avec une population totale de 12 309 ÃĐlÃĻves. De 1898 à 1906 les ÃĐtablissements ecclÃĐsiastiques, devenus laÃŊques ou restÃĐs sÃĐculiers, par application de la loi de 1901 sur les associations, ont perdu 23 271 ÃĐlÃĻves, tandis que le gain de l'enseignement laÃŊc, public ou libre, a ÃĐtÃĐ de 20 098. Au 5 novembre 1906, 154892 ÃĐlÃĻves suivaient les cours de l'enseignement secondaire. Ce nombre se dÃĐcompose ainsi : Enseignement publicâĶâĶâĶâĶâĶâĶâĶâĶ..âĶ 98 963 Enseignement libre laÃŊque (y compris les institutions sÃĐculiÃĻres ou congrÃĐganistes devenues laÃŊques) âĶâĶâĶ..âĶâĶâĶâĶâĶ.. 20 820 Enseignement libre sÃĐculierâĶâĶâĶâĶâĶâĶâĶ 35 049 En 1908, les lycÃĐes de garçons comptaient 59998 ÃĐlÃĻves ; les collÃĻges de garçons, 36 282. En 1909, les lycÃĐes de garçons comptaient 60 548 ÃĐlÃĻves ; les collÃĻges de garçons, 36580. L'enseignement secondaire libre comptait en 1908 : 253 ÃĐtablissements laÃŊques avec 19 935 ÃĐlÃĻves et 371 ÃĐtablissements ecclÃĐsiastiques avec' 44 558 ÃĐlÃĻves, soit un total de 624 ÃĐtablissements libres avec 64 493 ÃĐlÃĻves. La concurrence dans l'enseignement secondaire. â Mais la qualitÃĐ de l'enseignement importe beaucoup plus que le nombre des ÃĐlÃĻves qui le reçoivent. Or la lutte engagÃĐe entre l'Eglise et l'Etat, sur le terrain tout dÃĐsignÃĐ de l'enseignement secondaire, a conduit les administrations collÃĐgiales à s'inquiÃĐter surtout de l'effectif de leurs ÃĐtablissements. Il s'est agi, alors, d'attirer à soi, par la prudente rÃĐserve, par la neutralitÃĐ stricte de l'enseignement, par le silence et l'effacement des professeurs hors de leur chaire, la clientÃĻle rÃĐcalcitrante des maisons congrÃĐganistes. TalonnÃĐe par la concurrence, l'UniversitÃĐ se fait donc insinuante, parfois insignifiante, et elle s'efforce de combattre les ÃĐtablissements clÃĐricaux, trop souvent, en les imitant. ÂŦ CollÃĻge d'Eglise et collÃĻge d'Etat, ÃĐcrivait un jour M. Lavisse, se ressemblent lamentablement, celui ci ÃĐtant nÃĐ de celui-là . Âŧ Chacune des deux maisons rivales cherche à enlever à l'autre sa clientÃĻle, en lui empruntant quelques-uns des procÃĐdÃĐs qu'elle suppose utiles à son succÃĻs. L'ÃĐcole libre demande à l'UniversitÃĐ ses professeurs et ses diplÃīmes, le lycÃĐe prend à l'ÃĐcole libre son aumÃīnier, invite ses maîtres à taire leurs opinions personnelles dans leur classe, à ne les manifester qu'avec une extrÊme ÂŦ prudence Âŧ au dehors. Est-ce à dire qu'il faille supprimer cette concurrence, obliger les parents à mettre leurs enfants au lycÃĐe, abroger la loi Falloux et revenir au monopole universitaire qu'en soixante ans le Parlement, saisi de nombreuses propositions, n'a pas encore rÃĐtabli? La grande majoritÃĐ du personnel enseignant secondaire ne le dÃĐsire pas. Le plus clair rÃĐsultat de ce monopole serait de paralyser le professeur, qu'il livrerait à toutes les attaques des associations de parents ÂŦ bien pensants Âŧ, exaspÃĐrÃĐs par la contrainte imposÃĐe. Il suffirait d'un mot d'ordre des curÃĐs et des ÃĐvÊques pour que, dans le lycÃĐe obligatoire de demain, se dÃĐchaînÃĒt la pieuse rÃĐvolte dont l'ÃĐcole primaire obligatoire nous offre aujourd'hui l'ÃĐdifiant spectacle. Cela doit donner à rÃĐflÃĐchir aux rÃĐformateurs trop pressÃĐs, zÃĐlÃĐs partisans d'une mesure radicale, dont l'efficacitÃĐ apparente leur dissimule le rÃĐel danger. Qu'on laisse donc l'enseignement universitaire gagner lui-mÊme sa cause, qui est celle de la dÃĐmocratie et de la science ; qu'on lui permette de se rÃĐpandre par sa propre valeur, par ses succÃĻs, par l'ardeur de ses convictions, toujours respectueuses de la libertÃĐ des consciences. Il saura bien gagner à lui les sympathies hÃĐsitantes. Il vaincra à force de convaincre. Mais, s'il existe contre lui d'aveugles et irrÃĐductibles haines, pourquoi les ameuter imprudemment contre ses maîtres? Pourquoi vouloir introduire l'ennemi dans la place? Il ne dÃĐsarmerait qu'aprÃĻs l'avoir conquise. Si l'enseignement secondaire bÃĐnÃĐficiait du jour au lendemain de la sympathie ou mÊme de l'engouement des catÃĐgories sociales auxquelles il paraît destinÃĐ, nous n'en devrions pas conclure qu'il a trouvÃĐ sa vraie formule et qu'il remplit exactement le rÃīle qui doit lui revenir dans une dÃĐmocratie rÃĐpublicaine. On ne peut songer sans frÃĐmir à ce qu'il faudrait accorder à la clientÃĻle congrÃĐganiste pour qu'elle se dÃĐclarÃĒt satisfaite! Devra-t-on renoncer à enseigner les vÃĐritÃĐs ÃĐvidentes, dÃĐnoncÃĐes dÃĐjà comme monstrueuses lorsqu'elles trouvent place dans les plus anodins des manuels primaires? Tiendra-t-on ÃĐcole de surnaturel? Qu'on maintienne donc la concurrence ; mais, si nous laissons aux autres leur libertÃĐ, que ce soit à la condition de rendre la sienne à l'enseignement universitaire. Malheureusement, il faudrait pour cela que la concurrence perdît son caractÃĻre commercial ; et il est permis de craindre que le rÃĐgime de l'autonomie des lycÃĐes ne soit guÃĻre conciliable avec la large et loyale concurrence des idÃĐes et des mÃĐthodes, qui rendrait aux leçons de l'enseignement public l'accent, l'initiative, la franchise nÃĐcessaires. Enseignement secondaire des jeunes filles. â Depuis la loi du 21 dÃĐcembre 1880, la France possÃĻde des lycÃĐes et collÃĻges pour l'enseignement secondaire des filles. Le Dictionnaire a placÃĐ ailleurs (Voir Filles) les indications relatives à cet enseignement, à ses ÃĐlÃĻves, et au personnel spÃĐcial qui a ÃĐtÃĐ prÃĐparÃĐ' pour le donner. ÂŦ Le lycÃĐe ou le collÃĻge ne s'ouvre à la jeune fille qu'à partir de douze ans. Jusque-là elle doit suivre l'ÃĐcole primaire, ou faire ailleurs des ÃĐludes ÃĐquivalentes. [Aujourd'hui, les lycÃĐes et collÃĻges de jeunes filles possÃĻdent une classe enfantine et trois classes primaires.] De douze à dix-sept ans, la scolaritÃĐ est partagÃĐe en deux pÃĐriodes : de douze à quinze ans, pÃĐriode d'enseignement commun et obligatoire, embrassant presque dans une ÃĐgale mesure toutes les matiÃĻres scientifiques et littÃĐraires ; de quinze à dix-sept, pÃĐriode d'enseignement mi-partie obligatoire, mi-partie facultatif, portant sur les mÊmes matiÃĻres, revues de plus haut et avec plus de dÃĐveloppement. Par ces dispositions, on s'est proposÃĐ, d'une part, de faciliter aux ÃĐlÃĻves de l'ÃĐcole primaire l'accÃĻs du lycÃĐe, d'autre part de donner à la jeune fille, au bout de trois ans, un ensemble complet des connaissances qu'elle doit possÃĐder. Âŧ (GrÃĐard, L'enseignement secondaire des filles.) Le diplÃīme instituÃĐ par la loi à la fin de la cinquiÃĻme annÃĐe est dÃĐlivrÃĐ Ã la suite d'un examen portant sur les matiÃĻres obligatoires, avec interrogations sur les cours facultatifs suivis par l'ÃĐlÃĻve. Le voeu exprimÃĐ par le rapporteur de la commission devant le Conseil supÃĐrieur ÃĐtait qu'on ne laissÃĒt pas dÃĐgÃĐnÃĐrer cet examen en une sorte de baccalaurÃĐat, demandant au dernier moment un effort de mÃĐmoire, et comportant, par suite, une prÃĐparation plus ou moins hÃĒtive ; ce doit Être un diplÃīme de fin d'ÃĐtudes donnÃĐ dans l'intÃĐrieur de la maison, sous le contrÃīle d'un reprÃĐsentant de l'Etat, et qu'on mÃĐritera sÃŧrement par ce seul fait d'avoir suivi tout le cours d'ÃĐtudes, grÃĒce à de ÂŦ sÃĐrieux examens de passage Âŧ, qui devront Être exigÃĐs dÃĻs le commencement. Mais ce diplÃīme d'ÃĐtudes secondaires, prÃĐcisÃĐment parce qu'il n'est pas un examen, ne saurait confÃĐrer les mÊmes droits que le baccalaurÃĐat des lycÃĐes de garçons. Beaucoup de jeunes filles se prÃĐsentent, et avec succÃĻs, à celles des ÃĐpreuves de ce baccalaurÃĐat qui ne comportent ni grec ni latin, donnant ainsi la preuve de la valeur de l'enseignement qu'elles reçoivent. L'enseignement facultatif du latin, qui commence à s'introduire dans les lycÃĐes de jeunes filles, permet à d'excellentes ÃĐlÃĻves de rÃĐussir brillamment aux sÃĐries Latin-Sciences, Latin-Langues vivantes. Les crÃĐateurs des lycÃĐes de jeunes filles, s'inspiraient de cette idÃĐe, aujourd'hui dÃĐpassÃĐe, qu'il doit exister entre les lycÃĐes de garçons et les lycÃĐes de jeunes filles des diffÃĐrences essentielles. On craignait sans doute de faire des pÃĐdantes, d'insupportables ÂŦ femmes savantesÂŧ. Mais un enseignement vraiment secondaire donne à ses ÃĐlÃĻves, en mÊme temps qu'une haute idÃĐe de la science, un trop juste sentiment des limites de leurs connaissances pour qu'un tel danger soit à redouter. L'enseignement secondaire des jeunes filles est aujourd'hui en pleine prospÃĐritÃĐ. On a pu dire qu'il ÃĐtait ÂŦ une, des crÃĐations les plus parfaites de la RÃĐpublique Âŧ. La portÃĐe sociale en apparaît incontestable. La bourgeoisie elle-mÊme, devenue plus sensible à l'instabilitÃĐ des fortunes, s'habitue à ne plus voir une ÂŦ dÃĐclassÃĐe Âŧ dans la femme qui s'efforce, par son initiative personnelle et son labeur instruit, de s'assurer une existence indÃĐpendante. Le personnel des lycÃĐes et collÃĻges de filles a passÃĐ de 84.3 unitÃĐs en 1893 à 2122 en 1906. Le nombre des lycÃĐes et collÃĻges de filles, qui ÃĐtait de 10 en 1883, de 16 en 1887, de 57 en 1893, ÃĐtait de 103 en 1906. Le nombre des ÃĐlÃĻves s'est ÃĐlevÃĐ de 96 en 1881 à 2761 en 1886. Il dÃĐpasse aujourd'hui 35 000. La progression est indiquÃĐe dans le tableau suivant :
La Commission extraparlementaire ne pouvait se dÃĐsintÃĐresser du relÃĻvement trop nÃĐcessaire des traitements d'un personnel auquel on doit cette prospÃĐritÃĐ. Pour des raisons d'une valeur discutable, les traitements fÃĐminins restent infÃĐrieurs à ceux du personnel des lycÃĐes de garçons. Ils seront cependant l'objet des augmentations suivantes:
Les traitements dans les ÃĐtablissements d'enseignement secondaire de jeunes filles ÃĐtaient les suivants avant l'application des conclusions de la Commission extraparlementaire de l'enseignement :
Nota. â Les membres du personnel administratif ou enseignant pourvus d'une agrÃĐgation de langues vivantes reçoivent, en sus des traitements indiquÃĐs ci-dessus, une indemnitÃĐ d'agrÃĐgation de 500 fr. soumise aux retenues pour pensions civiles. Les fonctionnaires du personnel de surveillance ont droit au logement et aux prestations. Les ÃĐconomes des lycÃĐes de jeunes filles qui sont en outre chargÃĐes des fonctions d'agent spÃĐcial dans l'internat municipal annexÃĐ reçoivent en sus une indemnitÃĐ non soumise aux retenues, qui ne peut Être infÃĐrieure à 1200 fr.
Nota. â Les fonctionnaires du personnel de surveillance ont en outre droit gratuitement au logement. Conclusion. â Le succÃĻs de l'enseignement secondaire des jeunes filles prouve qu'il rÃĐpond à un rÃĐel besoin qu'il sait satisfaire. Les rÃĐformes successives de l'enseignement secondaire des garçons tÃĐmoignent d'un sincÃĻre effort pour adapter à des exigences modernes les ÃĐtudes qui s'en dÃĐsintÃĐressaient trop. Il serait prÃĐmaturÃĐ de juger, dÃĻs maintenant, dans le dÃĐtail, la rÃĐforme de 1902. Le temps seul pourra montrer ce qu'elle contient d'excellent et de durable ; il faut compter sur lui pour en corriger les erreurs. Ce qui paraît dÃĻs maintenant acquis, c'est que les ÃĐtudes sans latin ni grec peuvent former d'excellents esprits, habituÃĐs aux mÃĐthodes secondaires et parmi lesquels se recrutent de trÃĻs bons ÃĐlÃĻves â parfois les meilleurs â de la classe finale de mathÃĐmatiques ou de philosophie. La faveur dont jouit, auprÃĻs des parents, la section Latin-sciences paraît trÃĻs justifiÃĐe ; mais la section Sciences-Langues vivantes, que les boursiers de l'enseignement primaire forment en grande partie, peut aisÃĐment soutenir la comparaison. Le commencement des ÃĐtudes secondaires dans les lycÃĐes et collÃĻges de jeunes filles et de garçons aprÃĻs une solide instruction primaire, la possibilitÃĐ d'ÃĐtudes secondaires sans latin ni grec, l'importance donnÃĐe dans les classes ÃĐlÃĐmentaires aux ÃĐtudes de français, autant, de jalons posÃĐs pour ÃĐtablir dans la mesure du possible l'unitÃĐ de l'ÃĐducation française, qu'avait rÊvÃĐe la Convention et qu'elle avait essayÃĐ de rÃĐaliser par l'institution des ÃĐcoles centrales. Il est clair que la tendance naturelle de la dÃĐmocratie, que l'instinct mÊme de la justice, que l'intelligence des vÃĐritables intÃĐrÊts de notre sociÃĐtÃĐ moderne, poussent dans cette voie, nous demandent de combler l'abîme qui sÃĐparait jadis les diffÃĐrents ordres d'instruction, de poser un pont entre l'instruction primaire et l'instruction secondaire, de faciliter les ÃĐtudes de longue haleine à l'ÃĐlite de la population enfantine, non seulement par des bourses attribuÃĐes au mÃĐrite, et qui constituent une sorte de gratuitÃĐ, mais encore par un ingÃĐnieux agencement de programmes qui abaisse les barriÃĻres entre l'ÃĐcole primaire et le lycÃĐe, et permette de passer, sans un effort extraordinaire, de l'une à l'autre. Ecole primaire, collÃĻge communal, lycÃĐe d'Etat, enseignement classique, enseignement scientifique, tout doit, à travers les diffÃĐrences inÃĐvitables, avoir pour but d'ÃĐlever de plus en plus le niveau des intelligences, de faire naître les vocations, de crÃĐer, à des degrÃĐs divers, un esprit commun dans le pays, de fonder, au profit de tous, une ÃĐducation commune, laÃŊque, moderne, ÃĐmancipatrice et vraiment nationale. [T. STEEG.] Nous donnons ci-aprÃĻs sept documents relatifs aux bourses nationales dans les lycÃĐes et collÃĻges de garçons et de jeunes tilles, et aux conditions à remplir pour leur obtention : A â Note Indiquant les conditions et les formalitÃĐs à remplir pour l'obtention d'une bourse nationale, dÃĐpartementale ou communale, dans les lycÃĐes ou collÃĻges de garçons. I â Des diffÃĐrentes natures de bourses. L'Etat, les dÃĐpartements et les communes entretiennent dans les lycÃĐes et collÃĻges de garçons des bourses d'internat, de demi-pensionnat, d'externat simple ou surveillÃĐ. Ces bourses sont confÃĐrÃĐes aux enfants de nationalitÃĐ française dont l'aptitude a ÃĐtÃĐ constatÃĐe, et particuliÃĻrement à ceux dont la famille a rendu des services au pays. Elles ne sont accordÃĐes qu'aprÃĻs enquÊte ÃĐtablissant l'insuffisance de fortune de la famille. Elles sont de deux catÃĐgories : 1° les bourses d'essai, accordÃĐes à titre provisoire ; 2° les bourses de mÃĐrite, accordÃĐes à titre dÃĐfinitif. Les bourses d'essai sont accordÃĐes à partir de la classe de sixiÃĻme ; elles sont concÃĐdÃĐes pour une annÃĐe scolaire. Aucune condition de stage dans un lycÃĐe ou collÃĻge n'est imposÃĐe aux candidats aux bourses d'essai. Les bourses de mÃĐrite sont accordÃĐes soit à des ÃĐlÃĻves jouissant d'une bourse d'essai, et dont l'aptitude a ÃĐtÃĐ constatÃĐe, soit à des candidats ayant subi avec succÃĻs l'examen et justifiant, en outre, d'un stage d'un an au moins dans un lycÃĐe ou collÃĻge. Aucune bourse de mÃĐrite ne peut Être accordÃĐe pour la classe de sixiÃĻme. II. â FormalitÃĐs à remplir par les familles des candidats. Les examens ont lieu dans la premiÃĻre quinzaine d'avril au chef-lieu de chaque dÃĐpartement. Les candidats doivent Être inscrits, du 1er au 25 mars, au secrÃĐtariat de la prÃĐfecture de leur rÃĐsidence ou de la rÃĐsidence de leur famille. La demande d'inscription est accompagnÃĐe : 1° de l'acte de naissance de l'enfant ; 2° d'un certificat du chef de l'ÃĐtablissement auquel il appartient ; ce certificat donne le relevÃĐ sommaire des notes obtenues par l'ÃĐlÃĻve pour la conduite et le travail depuis la rentrÃĐe des classes et pendant l'annÃĐe scolaire prÃĐcÃĐdente, la liste de ses places de composition, avec indication de sa classe et du nombre des ÃĐlÃĻves de sa division, la liste de ses prix et accessits ; 3° d'une dÃĐclaration du pÃĻre de famille faisant connaître sa profession et celle de sa femme, les prÃĐnoms, ÃĒge, sexe et profession de chacun de ses enfants vivants, le montant de ses ressources annuelles et celui de ses contributions ; ladite dÃĐclaration, qui doit Être signÃĐe du postulant et certifiÃĐe exacte par le maire de la commune, indiquera, en outre, si des bourses, remises ou dÃĐgrÃĻvements ont dÃĐjà ÃĐtÃĐ accordÃĐs prÃĐcÃĐdemment au candidat ou à ses frÃĻres ou soeurs. III. â Examen d'aptitude. Les bourses d'essai ne peuvent Être accordÃĐes qu'à des candidats ayant passÃĐ avec succÃĻs l'examen spÃĐcial d'aptitude aux bourses. Cet examen est subi devant une commission siÃĐgeant au chef-lieu du dÃĐpartement. Les candidats aux bourses fondÃĐes et entretenues par les dÃĐpartements, les communes et les particuliers sont soumis au mÊme examen. L'obtention du certificat d'aptitude ne confÃĻre aucun droit absolu. Toutes les demandes de bourses de l'Etat sont soumises à une commission centrale siÃĐgeant au ministÃĻre, qui les classe par ordre de mÃĐrite, d'aprÃĻs l'ensemble des titres produits à l'appui. Les candidats sont distribuÃĐs en sÃĐries, suivant leur ÃĒge, chaque sÃĐrie correspondant à une classe. Toutefois, par application de l'article 6 du dÃĐcret du 6 aoÃŧt 1895 et de l'article 3 de t'arrÊte du 31 mai 1902, si un candidat appartient dÃĐjà à une classe supÃĐrieure à celle de son ÃĒge, il est tenu de subir l'examen sur les matiÃĻres de cette classe, à moins que sa famille n'ait fait connaître expressÃĐment, dans sa demande, son intention de la lui faire redoubler. Le rÃĐsultat de l'examen n'est valable que pour un an. Aucune dispense d'ÃĒge ou de stage n'est accordÃĐe. La 1re sÃĐrie comprend les candidats qui doivent entrer en sixiÃĻme ; La 2e sÃĐrie ceux qui doivent entrer en cinquiÃĻme et ainsi de suite. Pour Être inscrits, les candidats doivent avoir, avant le 1er janvier de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi : Dans la 1re sÃĐrie (entrÃĐe en sixiÃĻme), moins de douze ans ; Dans la 2e sÃĐrie (entrÃĐe en cinquiÃĻme), moins de treize ans ; Dans la 3e sÃĐrie (entrÃĐe en quatriÃĻme), moins de quatorze ans ; Dans la 46 sÃĐrie (entrÃĐe en troisiÃĻme), moins de seize ans ; Dans la 5e sÃĐrie (entrÃĐe en seconde), moins de dix-sept ans ; Dans la 6° sÃĐrie (entrÃĐe en premiÃĻre), moins de dix-huit ans. Les candidats pourvus de la premiÃĻre partie du baccalaurÃĐat sont dispensÃĐs de l'examen d'aptitude s'ils sont ÃĒgÃĐs de moins de vingt et un ans et s'ils se prÃĐparent à une grande ÃĐcole de l'Etat. IV. â Programme des examens. Les candidats sont examinÃĐs, savoir : Dans la 1re sÃĐrie, sur les parties communes au programme du cours moyen de l'enseignement primaire et au programme des classes ÃĐlÃĐmentaires des lycÃĐes. Dans la 2e sÃĐrie, sur les matiÃĻres de sixiÃĻme ; dans la 3e sÃĐrie, sur les matiÃĻres de cinquiÃĻme, et ainsi de suite. L'examen comprend deux ÃĐpreuves : une ÃĐpreuve ÃĐcrite et une ÃĐpreuve orale. L'ÃĐpreuve ÃĐcrite est ÃĐliminatoire ; elle comprend : Pour la 1re et la 2e sÃĐrie de la Division A : 1° Une dictÃĐe française suivie de questions sur certaines parties du texte dictÃĐ, permettant de constater chez les candidats la connaissance de la langue et l'intelligence du texte ; 2e une composition française ou une composition sur une des matiÃĻres du cours (histoire, gÃĐographie, sciences) ; Pour la 3e, la 4e et la 5e sÃĐrie de la Division A : 1° Une composition française ou une composition sur une matiÃĻre du cours ; 2° une version latine ; Pour la 1re et la 2e sÃĐrie de la Division B : 1° Une dictÃĐe française suivie de questions sur certaines parties du texte dictÃĐ, permettant de constater chez les candidats la connaissance de la langue et l'intelligence du texte ; 2° une composition française ou une composition sur une des matiÃĻres du cours ; Pour la 3e, la 4e et la 5e sÃĐrie de la Division B : 1° Une composition française ou une composition sur une matiÃĻre du cours ; 2° un exercice ÃĐcrit de langues vivantes ; Pour la 6e sÃĐrie (2e cycle) : 1° Section A : Une composition française et une version latine ou grecque ; 2° Section B : Une composition de langues vivantes et une version latine ; 3° Section C : Une composition de sciences et une version latine ; 4° Section D : Une composition de sciences et une composition de langues vivantes. Pour la version latine et la version grecque, l'usage du dictionnaire est autorisÃĐ. Les ÃĐpreuves de langues vivantes, à l'examen ÃĐcrit et à l'examen oral, portent sur l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Dans les sÃĐries oÃđ deux langues sont reprÃĐsentÃĐes, l'une des ÃĐpreuves porte obligatoirement sur l'allemand ou l'anglais. L'usage du lexique est autorisÃĐ dans les ÃĐpreuves ÃĐcrites. â Depuis 1906, le lexique dont l'usage est autorisÃĐ pour les ÃĐpreuves ÃĐcrites de langues vivantes ne peut Être qu'un lexique en langue ÃĐtrangÃĻre, sans traduction. V. â Dossiers des candidatures. Les demandes de bourses de l'Etat doivent Être adressÃĐes au ministre, mais remises dans les bureaux de la prÃĐfecture, avec les piÃĻces nÃĐcessaires, savoir : 1° L'acte de naissance de l'enfant ; 2° Le certificat scolaire mentionnÃĐ au paragraphe II ; 3° Le certificat d'aptitude, dÃĐlivrÃĐ au secrÃĐtariat de la prÃĐfecture et indiquant le nombre des points obtenus par le candidat, ou le certificat d'admission à la premiÃĻre partie au moins des ÃĐpreuves du baccalaurÃĐat ; 4° Une note dÃĐtaillÃĐe ou un ÃĐtat dÃŧment certifiÃĐ des services sur lesquels la demande est fondÃĐe ; 5° La dÃĐclaration du pÃĻre de famille mentionnÃĐe au paragraphe II ; 6° L'engagement ÃĐcrit des parents de payer les frais du trousseau et de pension qui, en cas de nomination, seraient laissÃĐs à leur charge. Tous les dossiers doivent Être constituÃĐs sans retard, de maniÃĻre que les prÃĐfets puissent les envoyer le plus tÃīt possible, par l'intermÃĐdiaire des recteurs d'acadÃĐmie, au ministre de l'instruction publique. En ce qui regarde les demandes prÃĐsentÃĐes par des candidats qui ont subi avec succÃĻs l'examen d'aptitude en avril, tout dossier qui ne parviendrait au ministÃĻre qu'aprÃĻs le 1er septembre ne pourrait plus Être soumis à la commission centrale et serait renvoyÃĐ Ã la famille. Quant aux dossiers relatifs aux demandes formÃĐes par des candidats pourvus du baccalaurÃĐat, ils ne doivent Être transmis au ministÃĻre, ni avant le 1er juillet, ni aprÃĻs le 1er dÃĐcembre. (Circulaire du 4 juin 1904.) VI. â Dispositions diverses. Les bourses d'essai peuvent Être renouvelÃĐes, mais une fois seulement. Elles peuvent Être converties en bourses dÃĐfinitives, aprÃĻs avis dÃĐlibÃĐrÃĐ par les professeurs et les rÃĐpÃĐtiteurs de la classe rÃĐunis, sur la prÃĐsentation du chef de l'ÃĐtablissement et la proposition du recteur, et à la condition que les titulaires sont inscrits sur un tableau d'honneur spÃĐcial. En cas de faute grave, Âŧou d'insuffisance dans les notes de conduite ou de travail, la dÃĐchÃĐance de la bourse peut Être prononcÃĐe par le ministre. B â Note indiquant les conditions et les formalitÃĐs à remplir pour l'obtention d'une bourse nationale, dÃĐpartementale ou communale, dans les lycÃĐes ou collÃĻges de jeunes filles. I. â.Des diffÃĐrentes natures de bourses. L'Etat, les dÃĐpartements et les communes entretiennent dans les lycÃĐes et collÃĻges de jeunes filles des bourses d'internat, de demi-pensionnat et d'externat. Ces bourses sont confÃĐrÃĐes aux enfants de nationalitÃĐ française dont l'aptitude a ÃĐtÃĐ constatÃĐe, et particuliÃĻrement à celles dont la famille a rendu des services au pays. Elles ne sont accordÃĐes qu'aprÃĻs enquÊte ÃĐtablissant l'insuffisance de fortune de la famille. Elles sont de deux catÃĐgories : 1° les bourses d'essai, accordÃĐes à titre provisoire ; 2° les bourses de mÃĐrite, accordÃĐes à titre dÃĐfinitif. Les bourses d'essai sont concÃĐdÃĐes pour une annÃĐe scolaire. Les bourses de mÃĐrite sont accordÃĐes, soit à des ÃĐlÃĻves jouissant d'une bourse d'essai et dont l'aptitude a ÃĐtÃĐ constatÃĐe, soit à des aspirantes ayant subi avec succÃĻs l'examen et justifiant, en outre, d'un stage d'un an au moins dans un lycÃĐe ou collÃĻge. Aucune bourse de mÃĐrite n'est accordÃĐe pour une classe infÃĐrieure à la deuxiÃĻme annÃĐe secondaire. II. âFormalitÃĐs à remplir par les familles des aspirantes. Les familles des aspirantes doivent les faire inscrire, du 1er au 25 mars, au secrÃĐtariat de la prÃĐfecture du dÃĐpartement de leur rÃĐsidence ou de la rÃĐsidence de leurs enfants. La demande d'inscription est accompagnÃĐe : 1° de l'acte de naissance de l'enfant ; 2° d'un certificat de la directrice de l'ÃĐtablissement oÃđ elle a commencÃĐ ses ÃĐtudes : ce certificat donne le relevÃĐ des notes obtenues par l'ÃĐlÃĻve pour la conduite et le travail depuis la rentrÃĐe des classes et pendant l'annÃĐe scolaire prÃĐcÃĐdente, la liste de ses places et notes de composition, avec indication de sa classe et du nombre des ÃĐlÃĻves de sa division, la liste de ses prix et accessits, les apprÃĐciations de ses professeurs ; le certificat n'est pas exigÃĐ des aspirantes qui ont ÃĐtÃĐ ÃĐlevÃĐes dans leur famille ; 3° d'une dÃĐclaration du pÃĻre de famille faisant connaître sa profession, les prÃĐnoms, ÃĒge, sexe et profession de chacun de ses enfants vivants, le montant de ses ressources annuelles et celui de ses contributions : ladite dÃĐclaration, qui doit Être signÃĐe du postulant et certifiÃĐe exacte par le maire de la commune, indiquera, en outre, si des bourses, remises ou dÃĐgrÃĻvements ont dÃĐjà ÃĐtÃĐ accordÃĐs prÃĐcÃĐdemment à l'aspirante ou à ses frÃĻres ou soeurs. III. Examen d'aptitude. Les bourses d'essai ne peuvent Être accordÃĐes qu'à des aspirantes ayant subi avec succÃĻs l'examen spÃĐcial du certificat d'aptitude aux bourses. Cet examen est subi devant une commission siÃĐgeant au chef-lieu du dÃĐpartement. Les aspirantes aux bourses fondÃĐes et entretenues par les dÃĐpartements, les communes et les particuliers sont soumises au mÊme examen. L'obtention du certificat d'aptitude ne confÃĻre aucun droit absolu. Toutes les demandes de bourses de l'Etat sont soumises à une commission centrale, siÃĐgeant au ministÃĻre, qui les classe par ordre de mÃĐrite, d'aprÃĻs l'ensemble des titres produits à l'appui. Les aspirantes sont distribuÃĐes en sÃĐries, suivant leur ÃĒge. Chaque sÃĐrie correspond à une classe. Aucune dispense d'ÃĒge n'est accordÃĐe. Les aspirantes peuvent, sur leur demande, subir l'examen dans une sÃĐrie supÃĐrieure à celle de leur ÃĒge. Les aspirantes qui appartiennent à une classe correspondant à une sÃĐrie supÃĐrieure à celle de leur ÃĒge doivent subir l'examen d'aprÃĻs le programme de cette classe, si elles ne veulent pas la doubler. La classe dont l'ÃĐlÃĻve, nommÃĐe boursiÃĻre, doit Être admise à suivre les cours, à la rentrÃĐe, dans rÃĐtablissement qui lui est assignÃĐ, est dÃĐterminÃĐe par l'examen qu'elle a passÃĐ au mois d'avril. Par exemple, l'aspirante, pour entrer en deuxiÃĻme annÃĐe, est tenue d'avoir satisfait aux ÃĐpreuves de la deuxiÃĻme sÃĐrie ; pour entrer en troisiÃĻme annÃĐe, aux ÃĐpreuves de la troisiÃĻme sÃĐrie, et ainsi de suite. Un examen subi sur les matiÃĻres de la premiÃĻre annÃĐe ne pourrait pas Être valable pour l'admission en troisiÃĻme annÃĐe. Ce te rÃĻgle est absolue. Les bourses sont accordÃĐes pour les classes auxquelles donne accÃĻs l'examen subi. Aucune aspirante ne peut Être admise comme boursiÃĻre dans une classe supÃĐrieure à celle pour laquelle elle a concouru. Les aspirantes doivent avoir pour entrer : Dans la 1re annÃĐe de cours, moins de treize ans accomplis au 1er octobre de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi, 1re sÃĐrie ; Dans la 2e annÃĐe de cours, moins de quatorze ans accomplis au 1er octobre de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi, 2e sÃĐrie ; Dans la 3e annÃĐe de cours, moins de quinze ans accomplis au 1er octobre de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi. 3e sÃĐrie ; Dans la 4e annÃĐe de cours, moins de seize ans accomplis au 1er octobre de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi, 4e sÃĐrie ; Dans la 5° annÃĐe de cours, moins de seize ans accomplis au 1er octobre de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi, 5e sÃĐrie. Les aspirantes pourvues du grade de bachelier ou du diplÃīme de fin d'ÃĐtudes secondaires et ÃĒgÃĐes de moins de vingt et un ans sont dispensÃĐes de l'examen d'aptitude aux bourses. IV. Programmes des examens. Les aspirantes aux bourses de l'enseignement secondaire sont interrogÃĐes, savoir : Pour la 1re annÃĐe de cours, sur les matiÃĻres du cours moyen de l'enseignement primaire obligatoire ; Pour la classe de 2e annÃĐe, sur les matiÃĻres du programme de la 1re annÃĐe, et ainsi de suite jusquâà la classe de 5e annÃĐe. L'examen comprend deux ÃĐpreuves : une ÃĐpreuve ÃĐcrite et une ÃĐpreuve orale. L'ÃĐpreuve ÃĐcrite est ÃĐliminatoire ; elle comprend : Pour la 1re sÃĐrie, une dictÃĐe française suivie de questions sur certaines parties du texte dictÃĐ permettant de constater chez les aspirantes la connaissance de la langue et l'intelligence du texte, et une composition sur une des matiÃĻres du cours moyen de l'enseignement primaire obligatoire ; Pour la 2e et la 3e sÃĐrie, deux compositions : l'une littÃĐraire, l'autre scientifique, sur les matiÃĻres des cours de 1re et de 2e annÃĐe ; Pour la 4e et la 5e sÃĐrie, deux compositions : l'une littÃĐraire ou historique, l'autre scientifique, sur les matiÃĻres des cours de 3e et de 4e annÃĐe ; une version de langue vivante. Les ÃĐpreuves orales portent sur les matiÃĻres suivantes : 1re sÃĐrie. â Grammaire, calcul, histoire, gÃĐographie ; 2e et 3e sÃĐries. â Langue française, histoire et gÃĐographie, mathÃĐmatiques et histoire naturelle ; 4e sÃĐrie. â LittÃĐrature, histoire et gÃĐographie, sciences, langues vivantes ; 5e sÃĐrie. â Morale et littÃĐrature, histoire, sciences, langues vivantes ; les ÃĐlÃĻves de cette sÃĐrie peuvent demander à Être interrogÃĐes, en outre, sur les matiÃĻres facultatives des cours de 4e annÃĐe. V. Dossiers des demandes de bourses de l'Etat. Les demandes de bourses de l'Etat doivent Être adressÃĐes au ministre et remises dans les bureaux de la prÃĐfecture, avec les piÃĻces nÃĐcessaires, savoir : 1° L'acte de naissance de l'enfant ; 2° Le certificat scolaire mentionnÃĐ au paragraphe II ; 3° Le certificat d'aptitude, dÃĐlivrÃĐ au secrÃĐtariat de la prÃĐfecture et indiquant le nombre des points obtenus par l'aspirante, ou le certificat d'admission au grade de bachelier ou au diplÃīme de fin d'ÃĐtudes ; 4° Une note dÃĐtaillÃĐe ou un ÃĐtat dÃŧment certifiÃĐ des services sur lesquels la demande est fondÃĐe ; 5° La dÃĐclaration du pÃĻre de famille mentionnÃĐe au paragraphe II ; 6° L'engagement ÃĐcrit des parents de payer les frais de trousseau et de pension qui, en cas de nomination, seraient laissÃĐs à leur charge. VI. Dispositions diverses. Les bourses d'essai ne peuvent Être renouvelÃĐes qu'une fois. Elles peuvent Être converties en bourses dÃĐfinitives, aprÃĻs avis dÃĐlibÃĐrÃĐ par les professeurs et les rÃĐpÃĐtitrices de la classe rÃĐunis, sur la prÃĐsentation de ht directrice et la proposition du recteur, et à la condition que les titulaires soient inscrites sur un tableau d'honneur spÃĐcial. En cas de faute grave, la directrice a le droit de rendre une boursiÃĻre à sa famille. Les boursiÃĻres qui, sans avoir encouru la peine de l'exclusion, n'obtiennent que des notes insuffisantes pour la conduite ou le travail, sont dÃĐfÃĐrÃĐes au conseil de discipline qui leur inflige, s'il y a lieu, un avertissement. Cet avertissement est notifiÃĐ Ã la famille par l'inspecteur d'acadÃĐmie. AprÃĻs deux avertissements, les ÃĐlÃĻves boursiÃĻres qui continuent à Être mal notÃĐes encourent la dÃĐchÃĐance de leur bourse. La dÃĐchÃĐance peut Être ÃĐgalement prononcÃĐe contre celles qui, à la suite des examens de passage, sont reconnues incapables d'entrer dans une classe supÃĐrieure. C â DÃĐcret relatif aux bourses dans les lycÃĐes et collÃĻges de garçons et aux remises de faveur dans les lycÃĐes de garçons. (6 aoÃŧt 1895.) ARTICLE PREMIER. â Les bourses dans les lycÃĐes et collÃĻges de garçons sont confÃĐrÃĐes aux enfants de nationalitÃĐ française dont l'aptitude a ÃĐtÃĐ constatÃĐe, et particuliÃĻrement à ceux dont la famille a rendu des services au pays. Elles ne sont accordÃĐes qu'aprÃĻs enquÊte ÃĐtablissant l'insuffisance de fortune de la famille. ART. 2. â Les bourses sont de deux catÃĐgories : 1° les bourses d'essai, accordÃĐes à titre provisoire ; 2° les bourses de mÃĐrite, accordÃĐes à titre dÃĐfinitif. ART. 3. â Les bourses d'essai ne peuvent Être accordÃĐes qu'à des candidats ayant subi avec succÃĻs un examen spÃĐcial dont les conditions et les programmes sont dÃĐterminÃĐs par des rÃĻglements dÃĐlibÃĐrÃĐs en Conseil supÃĐrieur de l'instruction publique. ART. 4. â Cet examen est subi devant une commission de cinq membres nommÃĐe par le recteur et siÃĐgeant au chef-lieu du dÃĐpartement. ART. 5. â Les candidats aux bourses fondÃĐes et entretenues par les dÃĐpartements, les communes et les particuliers sont soumis au mÊme examen. ART. 6. â Les bourses sont accordÃĐes pour les classes auxquelles donne accÃĻs l'examen subi. Aucun candidat ne peut Être admis comme boursier dans une classe supÃĐrieure à celle pour laquelle il a concouru. ART. 7. â Les bourses d'essai sont accordÃĐes à partir de la classe de septiÃĻme (abrogÃĐ) ; elles sont concÃĐdÃĐes pour une annÃĐe scolaire. Elles peuvent Être renouvelÃĐes : deux fois pour les ÃĐlÃĻves auxquels elles ont ÃĐtÃĐ attribuÃĐes pour la classe de septiÃĻme (abrogÃĐ) ; une fois seulement pour ceux qui les ont obtenues pour une classe supÃĐrieure à la septiÃĻme. Les candidats aux bourses de la classe de septiÃĻme doivent justifier, au moment de l'examen, d'un stage de six mois au moins dans un lycÃĐe ou dans un collÃĻge (abrogÃĐ). ART. 8. â Les bourses de mÃĐrite sont accordÃĐes, soit à des ÃĐlÃĻves jouissant d'une bourse d'essai et dont l'aptitude a ÃĐtÃĐ constatÃĐe, soit à des candidats ayant subi avec succÃĻs l'examen prÃĐvu par l'article 3 et justifiant, en outre, d'un stage d'un an au moins dans un lycÃĐe ou collÃĻge. Aucune bourse de mÃĐrite n'est accordÃĐe pour une classe infÃĐrieure à la cinquiÃĻme. ART. 9. â Les bourses d'essai peuvent Être converties en bourses dÃĐfinitives, aprÃĻs avis dÃĐlibÃĐrÃĐ par les professeurs et les rÃĐpÃĐtiteurs de la classe rÃĐunis, sur la prÃĐsentation du chef de l'ÃĐtablissement et la proposition du recteur. Peuvent seuls prÃĐtendre aux bourses dÃĐfinitives les ÃĐlÃĻves qui sont inscrits sur un tableau d'honneur spÃĐcial dressÃĐ conformÃĐment à l'article 11. ART. 10. â Lorsqu'une bourse d'essai n'a pas ÃĐtÃĐ, à la fin de l'annÃĐe scolaire, renouvelÃĐe ou convertie dans les conditions prÃĐvues par les articles 7 et 10, la jouissance de cette bourse cesse de plein droit. ART. 11. â Les tableaux d'honneur des boursiers d'essai et des boursiers de mÃĐrite sont dressÃĐs par le chef de l'ÃĐtablissement avec le concours des professeurs et des rÃĐpÃĐtiteurs de la classe. Aucun ÃĐlÃĻve ne peut y Être inscrit s'il n'a obtenu, à chacun des trimestres de l'annÃĐe scolaire, des notes supÃĐrieures à la moyenne pour sa conduite, son aptitude et ses progrÃĻs. ART. 12. â Les bourses nationales d'essai sont concÃĐdÃĐes par arrÊtÃĐ ministÃĐriel, les bourses nationales de mÃĐrite par dÃĐcret du PrÃĐsident de la RÃĐpublique, aprÃĻs avis d'une commission chargÃĐe du classement des candidatures. Cette disposition est applicable aux boursiers des lycÃĐes et collÃĻges de l'AlgÃĐrie, le gouverneur gÃĐnÃĐral conservant, d'ailleurs, le droit de prÃĐsentation pour les deux tiers des bourses affectÃĐes à la colonie. ART. 13. â Les bourses de l'Etat, des dÃĐpartements et des communes sont concÃĐdÃĐes en totalitÃĐ ou par fractions. Des promotions de bourse peuvent Être accordÃĐes aux ÃĐlÃĻves qui justifient de leur inscription au tableau d'honneur visÃĐ par l'article 11. ART. 14. â Les boursiers de mÃĐrite de l'Etat, des dÃĐpartements et des communes restent en possession de leur bourse jusqu'à l'ÃĒge de dix-neuf ans accomplis. S'ils atteignent cet ÃĒge avant l'expiration de l'annÃĐe scolaire, leur bourse est prorogÃĐe de plein droit jusqu'à la fin de ladite annÃĐe. Les boursiers ÃĒgÃĐs de dix-neuf ans et de moins de vingt ans peuvent obtenir une prolongation de bourse d'une annÃĐe, à la condition d'Être inscrits au tableau d'honneur des boursiers ; ceux qui sont ÃĒgÃĐs de vingt ans accomplis doivent, pour obtenir une prolongation, justifier, en outre, de l'admissibilitÃĐ Ã une grande ÃĐcole de l'Etat. ART. 15. â Des bourses peuvent Être concÃĐdÃĐes sans examen à des ÃĐlÃĻves ayant moins de vingt et un ans, s'ils ont subi avec succÃĻs au moins la premiÃĻre partie des ÃĐpreuves du baccalaurÃĐat, et s'ils se prÃĐparent à une grande ÃĐcole de l'Etat. Sont exclus du bÃĐnÃĐfice de la disposition ci-dessus les ÃĐlÃĻves, ÃĒgÃĐs de plus de dix-neuf ans, à qui une prolongation de bourse n'a pas ÃĐtÃĐ accordÃĐe. ART. 16. â En cas de faute grave, le chef d'ÃĐtablissement a le droit de rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en rÃĐfÃĐrer immÃĐdiatement au recteur de l'acadÃĐmie. Les boursiers qui, sans avoir encouru la peine de l'exclusion, n'obtiennent que des notes insuffisantes pour la conduite ou le travail, sont dÃĐfÃĐrÃĐs au Conseil de discipline qui leur inflige, s'il y a lieu, un avertissement. Cet avertissement est notifiÃĐ Ã la famille par l'inspecteur d'acadÃĐmie. AprÃĻs deux avertissements, les ÃĐlÃĻves boursiers qui continuent à Être mal notÃĐs encourent la dÃĐchÃĐance de leur bourse. La dÃĐchÃĐance peut Être ÃĐgalement prononcÃĐe contre ceux qui, à la suite des examens de passage, sont reconnus incapables d'entrer dans une classe supÃĐrieure. La dÃĐchÃĐance des boursiers nationaux et des boursiers communaux est prononcÃĐe par le ministre.ART. 17. â L'article 14 du dÃĐcret du 19 janvier 1881, * interdisant le cumul de fractions de bourse d'origine diffÃĐrente, est abrogÃĐ. ART. 18. â Les remises de frais de pension ou d'ÃĐtudes, dites ÂŦ remises de faveur Âŧ, sont supprimÃĐes. Des exemptions peuvent Être exceptionnellement accordÃĐes : 1° à des enfants dÃĐjà prÃĐsents dans un lycÃĐe, dont la famille a rendu des services signalÃĐs à lâEtat et se trouve, par suite d'ÃĐvÃĐnement grave, hors d'ÃĐtat de continuer à acquitter les frais des ÃĐtudes secondaires ; 2° aux soldats en congÃĐ ou rÃĐguliÃĻrement autorisÃĐs par leur chef de corps à suivre les cours d'un lycÃĐe en vue de la prÃĐparation à une grande ÃĐcole de l'Etat et à condition qu'ils aient ÃĐtÃĐ, l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente, dÃĐclarÃĐs admissibles au concours de cette ÃĐcole ; 3° aux enfants de troupe. Toutefois, pour ces derniers, la condition d'examen est obligatoire. ART. 19. â Les dispositions des rÃĻglements antÃĐrieurs sont abrogÃĐes en ce qu'elles ont de contraire au prÃĐsent dÃĐcret. ART. 20. â Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargÃĐ de l'exÃĐcution du prÃĐsent dÃĐcret. D. â ArrÊtÃĐ concernant les examens d'aptitude aux bourses dans les lycÃĐes et collÃĻges de garçons. . (31 mai 1902.) ARTICLE PREMIER. â Les commissions chargÃĐes d'examiner les candidats aux bourses des lycÃĐes et collÃĻges de garçons sont composÃĐes d'un inspecteur d'acadÃĐmie, prÃĐsident, et de quatre membres choisis par le recteur parmi les professeurs ou les anciens professeurs des facultÃĐs, des lycÃĐes et des collÃĻges. Des professeurs de langues vivantes sont adjoints au jury pour les catÃĐgories oÃđ les langues vivantes sont obligatoires. ART. 2. â Les examens ont lieu dans la premiÃĻre quinzaine d'avril au chef-lieu de chaque dÃĐpartement. Les candidats doivent Être inscrits du 1er au 25 mars, au secrÃĐtariat de la prÃĐfecture de leur rÃĐsidence ou de la rÃĐsidence de leur famille. La demande d'inscription est accompagnÃĐe : 1° de l'acte de naissance de l'enfant ; 2° d'un certificat du chef de l'ÃĐtablissement oÃđ il a commencÃĐ ses ÃĐtudes ; ce certificat donne le relevÃĐ sommaire des notes obtenues par l'ÃĐlÃĻve pour la conduite et le travail depuis la rentrÃĐe des classes et pendant l'annÃĐe scolaire prÃĐcÃĐdente, la liste de ses places de composition, avec indication de sa classe et du nombre des ÃĐlÃĻves de sa division, la liste de ses prix et accessits ; le certificat n'est pas exigÃĐ des candidats qui ont ÃĐtÃĐ ÃĐlevÃĐs dans leur famille ; 3° d'une dÃĐclaration du pÃĻre de famille faisant connaître sa profession, les prÃĐnoms, ÃĒge, sexe et profession de chacun de ses enfants vivants, le montant de ses ressources annuelles et celui de ses contributions ; ladite dÃĐclaration, qui doit Être signÃĐe du postulant et certifiÃĐe exacte par le maire de la commune, indiquera en outre si des bourses, remises ou dÃĐgrÃĻvements ont dÃĐjà ÃĐtÃĐ accordÃĐs prÃĐcÃĐdemment au candidat ou à ses frÃĻres ou soeurs. ART. 3. â Les candidats sont distribuÃĐs en sÃĐries, suivant leur ÃĒge, chaque sÃĐrie correspondant à une classe. Toutefois, par application de l'article 6 du dÃĐcret du 6 aoÃŧt 1895, si un candidat appartient dÃĐjà à une classe supÃĐrieure à celle de son ÃĒge, il est tenu de subir l'examen sur les matiÃĻres de cette classe, à moins que sa famille n'ait fait connaître expressÃĐment, dans sa demande, son intention de la lui faire redoubler. Le rÃĐsultat de l'examen n'est valable que pour un an. Aucune dispense d'ÃĒge ou de stage n'est accordÃĐe [abrogÃĐ). Pour la 1re sÃĐrie et les sÃĐries supÃĐrieures, aucun stage prÃĐalable dans un lycÃĐe ou collÃĻge n'est exigÃĐ des candidats. La 1re sÃĐrie comprend ceux qui doivent entier en sixiÃĻme ; La 2e sÃĐrie ceux qui doivent entrer en cinquiÃĻme, et ainsi de suite. ART. 4. â Pour Être inscrits, les candidats doivent avoir, avant le 1er janvier de l'annÃĐe oÃđ l'examen est subi : Dans la 1er sÃĐrie, moins de douze ans ; Dans la 2e sÃĐrie, moins de treize ans ; Dans la 3e sÃĐrie, moins de quatorze ans ; Dans la 4e sÃĐrie, moins de seize ans ; Dans la 5e sÃĐrie, moins de dix-sept ans ; Dans la 6e sÃĐrie, moins de dix-huit ans ; ART. 5. â Les candidats sont examinÃĐs, savoir : Dans la 1er sÃĐrie, sur les parties communes au programme du cours moyen de l'enseignement primaire et à celui des classes ÃĐlÃĐmentaires des lycÃĐes ; Dans la 2e sÃĐrie, sur les matiÃĻres de sixiÃĻme ; dans la 3° sÃĐrie, sur les matiÃĻres de cinquiÃĻme, et ainsi de suite. ART. 6. â L'examen comprend deux ÃĐpreuves : une ÃĐpreuve ÃĐcrite et une ÃĐpreuve orale. L'ÃĐpreuve ÃĐcrite est ÃĐliminatoire ; elle comprend : Pour la 1re et la 2e sÃĐrie de la Division A : 1° Une dictÃĐe française suivie de questions sur certaines parties du texte dictÃĐ permettant de constater chez les candidats la connaissance de la langue et l'intelligence du texte ; 2° une composition française ou une composition sur une des matiÃĻres du cours (histoire, gÃĐographie, sciences). Pour la 3e, la 4e et la 5e sÃĐrie de la Division A : 1° Une composition française ou une composition sur une matiÃĻre du cours ; 2° une version latine. Pour la 1re et la 2e sÃĐrie de la Division B : 1° Une dictÃĐe française suivie de questions sur certaines parties du texte dictÃĐ, permettant de constater chez les candidats la connaissance de la langue et l'intelligence du texte ; 2° une composition française ou une composition sur une des matiÃĻres du cours ; Pour la 3e, la 4e et la 5° sÃĐrie de la Division B : 1° Une composition française ou une composition sur une matiÃĻre du cours ; 2° un exercice ÃĐcrit de langues vivantes ; Pour la 6e SÃĐrie (2° cycle) : 1° Section A : Une composition française et une version latine ou grecque ; 2° Section B : Une composition de langues vivantes et une version latine ; 3° Section C : Une composition de sciences et une version latine 4° Section D : Une composition de sciences et une composition de langues vivantes. Pour la version latine et la version grecque, l'usage du dictionnaire est autorisÃĐ ART. 7. â La durÃĐe des ÃĐpreuves ÃĐcrites est fixÃĐe ainsi qu'il suit (non compris le temps et la dictÃĐe du sujet) :
Dans les autres sÃĐries, la durÃĐe de chacune des compositions est de deux heures. ART. 8. â Le nombre maximum des points à compter pour chaque ÃĐpreuve ÃĐcrite est de 20. Pour Être admis à l'ÃĐpreuve orale, le candidat doit obtenir au moins 20 points dans l'ensemble des deux ÃĐpreuves ÃĐcrites. La nullitÃĐ d'une composition peut entraîner l'ajournement. ART. 9. â L'examen oral comprend : Pour la 1re sÃĐrie des Divisions A et B, Trois ÃĐpreuves : Lecture et explication d'un texte français (coefficient double) ; Interrogations sur les sciences: Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie. Pour la 2e, la 3e et la 4e sÃĐrie de la Division A, Cinq ÃĐpreuves : Explication française ; Explication latine ; Interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Interrogations sur une langue ÃĐtrangÃĻre. Pour la 2°, la 3e et la 4e sÃĐrie de la division B, Cinq ÃĐpreuves : Explication française ; Deux interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Interrogations sur une langue ÃĐtrangÃĻre. Pour la 5° sÃĐrie de la division A, Cinq ÃĐpreuves : Explication française ; Explication latine ou grecque ; Interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Interrogations sur une langue ÃĐtrangÃĻre. Pour la 5e sÃĐrie de la division B, Cinq ÃĐpreuves : Explication française ; Deux interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Interrogations sur une langue ÃĐtrangÃĻre. Pour la 6° sÃĐrie, Section A, Six ÃĐpreuves : Explication française ; Explication latine ; Explication grecque ; Interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Interrogations sur une langue ÃĐtrangÃĻre. Section B, Six ÃĐpreuves : Explication française ; Explication latine ; Interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Explications et interrogations sur deux langues ÃĐtrangÃĻres. Section C, Six ÃĐpreuves : Explication française ; Explication latine ; Deux interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Interrogations sur une langue ÃĐtrangÃĻre. Section D, Six ÃĐpreuves : Explication française ; Deux interrogations sur les sciences ; Interrogations sur l'histoire et la gÃĐographie ; Explications et interrogations sur deux langues ÃĐtrangÃĻres. ART. 10. â Une note de 0 à 10 est attribuÃĐe à chaque ÃĐpreuve orale. Nul ne peut Être admis dÃĐfinitivement au certificat d'aptitude qu'avec la moitiÃĐ du maximum des points attribuÃĐs à l'ensemble des ÃĐpreuves ÃĐcrites et orales. La nullitÃĐ d'une ÃĐpreuve peut entraîner l'ajournement. ART. 11. â Les ÃĐpreuves de langues vivantes, à l'examen ÃĐcrit et à l'examen oral, portent sur l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Dans les sÃĐries oÃđ deux langues sont reprÃĐsentÃĐes, l'une des ÃĐpreuves porte obligatoirement sur l'allemand ou l'anglais. L'usage du lexique est autorisÃĐ dans les ÃĐpreuves ÃĐcrites. ART. 12. â ImmÃĐdiatement aprÃĻs les examens, le prÃĐsident du jury rÃĐdige un procÃĻs-verbal auquel il joint la liste nominative des candidats qui se sont prÃĐsentÃĐs, avec les notes qu'ils ont obtenues ; les candidats sont inscrits sur cette liste, par ordre alphabÃĐtique et par sÃĐries. Le procÃĻs-verbal est transmis au ministÃĻre avec la liste des candidats, dans la quinzaine qui suit la clÃīture de la session. ART. 13. â Les examens qui n'auraient pas ÃĐtÃĐ subis dans les conditions rÃĐglementaires peuvent Être annulÃĐs par le ministre. ART. 14. â L'obtention du certificat d'aptitude ne confÃĻre aucun droit absolu. Toutes les demandes de bourses de l'Etat sont soumises à une commission centrale, siÃĐgeant au ministÃĻre, qui les classe par ordre de mÃĐrite, d'aprÃĻs l'ensemble des titres produits à l'appui. Cette commission tient compte aux candidats des deux premiÃĻres sÃĐries de la production du certificat d'ÃĐtudes primaires. ART. 15. â Sont dispensÃĐs de l'examen d'aptitude, en vue de l'obtention d'une bourse nationale : 1° Les boursiers nationaux d'enseignement primaire supÃĐrieur transfÃĐrÃĐs dans l'enseignement secondaire par application de l'article 61 de l'arrÊtÃĐ sur les bourses d'enseignement primaire supÃĐrieur ; 2° Les boursiers dÃĐpartementaux ou communaux d'enseignement secondaire qui ont ÃĐtÃĐ nommÃĐs antÃĐrieurement à la suite d'un examen subi dans les conditions rÃĐglementaires. ART. 16. â Les arrÊtÃĐs des 12 janvier 1887 et 13 janvier 1892 sont et demeurent rapportÃĐs. E. â DÃĐcret relatif aux bourses dans les deux cycles d'ÃĐtudes. (4 aoÃŧt 1903.) ARTICLE PREMIER. â Les bourses de mÃĐrite concÃĐdÃĐes, dans les lycÃĐes et collÃĻges, au cours du premier cycle d'ÃĐtudes, prennent fin de plein droit à l'achÃĻvement de ce cycle. Elles ne peuvent Être renouvelÃĐes pour le second cycle qu'en faveur des boursiers qui justifient de leur inscription au tableau d'honneur visÃĐ par l'article 11 du dÃĐcret du 6 aoÃŧt 1895 et sont l'objet d'une proposition spÃĐciale du proviseur ou du principal, aprÃĻs avis dÃĐlibÃĐrÃĐ par le conseil des professeurs, professeurs-adjoints ou rÃĐpÃĐtiteurs de la classe de troisiÃĻme. ART. 2. â L'article 14, § 1er, du dÃĐcret du 6 aoÃŧt 1895 est abrogÃĐ en ce qu'il a de contraire au prÃĐsent dÃĐcret, qui aura son effet à dater de la fin de l'annÃĐe scolaire 1903-1904. ART. 3. â Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargÃĐ de l'exÃĐcution du prÃĐsent dÃĐcret. F. â DÃĐcret supprimant les bourses pour la classe de septiÃĻme. (16 janvier 1904.) Les bourses d'essai instituÃĐes en vertu de l'article 7 du dÃĐcret du 6 aoÃŧt 1895, pour la classe de septiÃĻme, sont supprimÃĐes. Les dispositions des rÃĻglements antÃĐrieurs sont abrogÃĐes en ce qu'elles ont de contraire au prÃĐsent dÃĐcret, qui aura son effet à dater de l'annÃĐe 1905. G â Note sur le rÃīle et le travail de la Commission centrale des bourses, approuvÃĐe par cette Commission. (Rapporteur : M. Henri BernÃĐs, membre de la Commission et du Conseil supÃĐrieur de l'instruction publique.) La Commission centrale des bourses a ÃĐtÃĐ instituÃĐe en 1882 par M. Duvaux, ministre de l'instruction publique. Sa crÃĐation rÃĐpondait à une double pensÃĐe : continuer l'oeuvre, inaugurÃĐe par la loi de 1880 sur les Conseils universitaires, d'association du personnel enseignant, sous forme consultative, au travail d'administration et de direction de l'UniversitÃĐ ; donner au pays, pour la rÃĐpartition des bourses d'enseignement secondaire, des garanties d'ÃĐgalitÃĐ et d'impartialitÃĐ plus complÃĻtes. La Commission se compose, depuis sa fondation, de professeurs, d'administrateurs de lycÃĐe, d'inspecteurs gÃĐnÃĐraux de l'enseignement secondaire, en exercice ou en retraite. Le vice-recteur de l'acadÃĐmie de Paris y a longtemps siÃĐgÃĐ. Le directeur de l'enseignement secondaire, le chef et le sous-chef du 1er bureau, en font partie de droit. Des membres du Parlement ont à diverses reprises participÃĐ Ã ses travaux. GrÃĒce à son ÃĐloignement des centres de composition, à son caractÃĻre de collectivitÃĐ, à l'absence de publicitÃĐ donnÃĐe au nom de ses membres, elle ÃĐchappe aisÃĐment aux influences d'intrigue personnelle et de recommandations. Choisissant, pour chaque ÃĐpreuve ÃĐcrite du concours des bourses, un sujet unique qui est donnÃĐ partout, comparant les dossiers venus de toutes les parties de la France, elle met soit dans les ÃĐpreuves mÊmes, soit dans l'apprÃĐciation des situations de famille et de la valeur des postulants, une unitÃĐ que ne sauraient assurer au mÊme degrÃĐ des commissions locales. Le choix des compositions est chaque annÃĐe longuement dÃĐlibÃĐrÃĐ par elle. Plusieurs de ses membres apportent, pour les ÃĐpreuves qui ont ÃĐtÃĐ dÃĐsignÃĐes d'avance à chacun d'eux en raison de sa compÃĐtence particuliÃĻre, un certain nombre de sujets, qui sont discutÃĐs en commun. Toutes les fois que cela est jugÃĐ nÃĐcessaire, des indications sont jointes à ces sujets sur la maniÃĻre dont ils doivent Être traitÃĐs, ou transmises aux commissions d'examen dÃĐpartementales, sur la mÃĐthode et l'esprit qui doivent prÃĐsider à la correction. L'effort de la commission, depuis qu'elle existe, a toujours ÃĐtÃĐ de rendre les ÃĐpreuves le plus probantes possible au point de vue de l'intelligence et des qualitÃĐs de rÃĐflexion. Pour les problÃĻmes d'arithmÃĐtique, par exemple, elle a toujours insistÃĐ sur l'importance d'un raisonnement soigneusement rÃĐdigÃĐ ; elle a transformÃĐ l'ancienne ÃĐpreuve de dictÃĐe, par l'adjonction de questions ÃĐcrites portant sur l'analyse grammaticale et logique, le sens prÃĐcis de tel ou tel mot, de telle ou telle phrase, ou l'idÃĐe gÃĐnÃĐrale du morceau ; questions qui comptent pour moitiÃĐ dans l'apprÃĐciation de l'ÃĐpreuve. Sur la correction mÊme des ÃĐpreuves ÃĐcrites, en ce qui concerne du moins les candidats dÃĐclarÃĐs admissibles dans chaque dÃĐpartement, elle exerce un contrÃīle. Les copies ÃĐtant jointes aux dossiers, elle peut, s'il y a lieu, relever, abaisser une note aprÃĻs dÃĐlibÃĐration spÃĐciale ; il lui est mÊme arrivÃĐ, tout exceptionnellement il est vrai, de faire transmettre un avis à telle commission dÃĐpartementale dont l'indulgence paraissait excessive ou la mÃĐthode de correction contestable. Le rÃīle des commissions dÃĐpartementales, qui n'ont à s'occuper que de l'aptitude des postulants, consiste essentiellement à opÃĐrer parmi les candidats un premier triage. Environ la moitiÃĐ d'entre eux, aprÃĻs les ÃĐpreuves ÃĐcrites et orales, se trouvent ÃĐliminÃĐs. Il s'en faut de beaucoup, du reste, les copies des admissibles permettent de s'en rendre compte, que tous ceux que laisse passer ce premier crible soient prÊts, ou aptes, à suivre utilement les classes d'un lycÃĐe ou d'un collÃĻge, ou mÃĐritent que l'Etat les y aide. Choisir entre eux d'aprÃĻs la seule considÃĐration des situations de famille aurait, quant à la valeur moyenne des boursiers, des consÃĐquences dÃĐplorables. Les documents dont l'ÃĐtude permet à la Commission centrale de fixer son choix se divisent en deux groupes : un dossier scolaire, un dossier de famille. Le dossier scolaire ne contenait, primitivement, que le procÃĻs-verbal de l'examen et un certificat de bonne conduite dÃĐlivrÃĐ par le chef de l'ÃĐtablissement auquel appartenait le candidat. Sur la demande de la Commission, des ÃĐlÃĐments d'apprÃĐciation beaucoup plus nombreux et plus prÃĐcis y ont ÃĐtÃĐ introduits. Il comprend maintenant : les copies mÊmes de l'ÃĐpreuve ÃĐcrite, qu'elle revoit et apprÃĐcie à son tour ; le relevÃĐ des notes de conduite et de travail, des notes et des places de composition, des rÃĐcompenses et ÃĐloges de diverse nature obtenus par le candidat pendant l'annÃĐe en cours et la prÃĐcÃĐdente, le nombre des ÃĐlÃĻves de sa classe, les apprÃĐciations motivÃĐes, et signÃĐes, soit de son instituteur s'il est à l'ÃĐcole primaire, soit, s'il est au collÃĻge ou au lycÃĐe, de chacun de ses professeurs ; enfin, pour les ÃĐlÃĻves dÃĐjà en cours d'ÃĐtudes secondaires, le rÃĐsultat d'un classement gÃĐnÃĐral des candidats aux bourses, que, dans chaque lycÃĐe ou collÃĻge, le chef d'ÃĐtablissement doit, à titre d'indication, arrÊter d'accord avec l'assemblÃĐe des professeurs, en tenant compte de tous les ordres de considÃĐrations à leur connaissance. Le dossier de famille comprend une dÃĐclaration du chef de la famille faisant connaître sa profession, celle de sa femme si elle en a une, les services publics, s'il y a lieu, de l'un ou de l'autre ou de leurs ascendants, les prÃĐnoms, ÃĒges, sexe, profession de tous leurs enfants vivants, le nombre de ceux qu'ils ÃĐlÃĻvent ou ont ÃĐlevÃĐs, le montant annuel du gain professionnel et des autres ressources, celui des contributions, l'indication des bourses, remises, dÃĐgrÃĻvements, qui ont pu Être dÃĐjà accordÃĐs au candidat ou à ses frÃĻres et soeurs dans tout enseignement ou tout ÃĐtablissement communal, dÃĐpartemental, ou d'Etat. Cette dÃĐclaration, signÃĐe, doit Être en outre certifiÃĐe exacte par le maire de la commune. L'inspecteur d'acadÃĐmie et le prÃĐfet y ajoutent des renseignements complÃĐmentaires ou leur apprÃĐciation personnelle, selon les ÃĐlÃĐments particuliers d'information dont ils disposent. La Commission trouve en outre dans le dossier l'avis prÃĐalable donnÃĐ, aprÃĻs examen de toutes ses parties, par le recteur de l'acadÃĐmie. Les dossiers, pendant les quatre ou cinq mois, à raison de deux ou trois sÃĐances hebdomadaires, que dure chaque annÃĐe le travail de classement, sont, avant chaque sÃĐance, distribuÃĐs aux membres de la Commission, qui les ÃĐtudient en dÃĐtail. A la sÃĐance suivante, chacun d'eux prÃĐsente un rapport sur chacun de ces dossiers, et la Commission le discute : le dossier reçoit ensuite une note de classement qui peut varier de 0 à 20. Les candidats obtenant une note supÃĐrieure à 14 ou 15 sont proposÃĐs par la Commission au ministre pour une dÃĐcision favorable. Mais cette dÃĐcision appartient au ministre seul. Il peut ÃĐcarter des candidats proposÃĐs par la Commission ; il peut en admettre qu'elle a ÃĐcartÃĐs. Il fixe seul aussi d'une façon dÃĐfinitive, aprÃĻs proposition de la Commission, la quotitÃĐ de la bourse accordÃĐe à chacun. Quand le candidat n'est pas encore ÃĐlÃĻve d'un lycÃĐe ou d'un collÃĻge, ce n'est plus, comme il y a quelques annÃĐes, à titre dÃĐfinitif (sauf retraits toujours exceptionnels) qu'il obtient du premier coup sa bourse. La Commission centrale a demandÃĐ et obtenu l'institution, pour ce cas, des bourses d'essai (dÃĐcret du 6 aoÃŧt 1895). Elles sont accordÃĐes pour un an ; au bout de l'annÃĐe, selon les rÃĐsultats obtenus, elles peuvent Être retirÃĐes, prolongÃĐes pour une seconde annÃĐe d'essai, ou converties en bourses dÃĐfinitives, dÃĐsormais appelÃĐes à juste titre bourses de mÃĐrite. Peuvent seuls obtenir une bourse de mÃĐrite les boursiers d'essai inscrits sur un tableau d'honneur spÃĐcial, aprÃĻs dÃĐlibÃĐration des professeurs et rÃĐpÃĐtiteurs de la classe. AprÃĻs deux ans de bourse d'essai, l'ÃĐlÃĻve qui n'obtient pas de bourse dÃĐfinitive cesse d'Être boursier.' Pendant quelques annÃĐes, les dossiers pour transformation, prolongation ou retrait des bourses d'essai ont ÃĐtÃĐ examinÃĐs par la Commission centrale. Ce sont maintenant les bureaux de chaque acadÃĐmie qui prÃĐparent sur ce point les dÃĐcisions ministÃĐrielles. Mais la Commission centrale a gardÃĐ un moyen prÃĐcieux de contrÃīle sur le travail des boursiers, et de contrÃīle aussi, on peut le dire, sur ses propres dÃĐsignations. Une bourse entiÃĻre, du moins quand il s'agit du demi-pensionnat ou de l'internat, n'est guÃĻre, à moins d'extrÊme nÃĐcessitÃĐ, accordÃĐe du premier coup. Il y a lieu, au cours des ÃĐtudes, à l'octroi de complÃĐments successifs, parfois à des transformations de bourses d'externat simple en bourses d'externat surveillÃĐ, de celles-ci en bourses de demi-pensionnat, des bourses de demi-pension en bourses d'internat (ces derniÃĻres n'ÃĐtant du reste qu'exceptionnellement accordÃĐes quand les parents habitent la ville mÊme oÃđ se font les ÃĐtudes). Ce systÃĻme, qui permet de faciliter, en fractionnant les bourses quand c'est possible, le dÃĐbut des ÃĐtudes secondaires à un plus grand nombre d'enfants, constitue en mÊme temps, par l'attrait des promotions à gagner, un moyen efficace de tenir les boursiers en haleine, et de stimuler leurs efforts. Les promotions sont accordÃĐes, comme les bourses elles-mÊmes, sur l'avis de la Commission centrale. Le dossier scolaire est alors, naturellement, l'ÃĐlÃĐment essentiel de ses apprÃĐciations. Quant aux dÃĐcisions qui accordent ou refusent, depuis la rÃĐforme de 1902, la prolongation pour le second cycle des bourses obtenues pour le premier, elles sont prises sur l'avis des recteurs d'acadÃĐmie. La Commission centrale n'est consultÃĐe que sur les prolongations au delà de dix-neuf et vingt ans, sollicitÃĐes par des candidats aux grandes ÃĐcoles. Au point de vue scolaire, les garanties dont l'intervention de la Commission centrale entoure le premier choix, l'institution des bourses d'essai, celle des promotions, ont singuliÃĻrement amÃĐliorÃĐ le recrutement des boursiers, des boursiers d'Etat tout au moins, seuls soumis à ce rÃĐgime. Les plaintes sur leur valeur, si frÃĐquentes autrefois, ont pour ainsi dire cessÃĐ de se produire. Les rapports des proviseurs, des recteurs, font unanimement leur ÃĐloge. Le travail des promotions permet chaque annÃĐe à la Commission centrale de constater que les boursiers proposÃĐs par elle, dans l'enseignement des garçons surtout, se montrent presque tous dignes du soutien qui leur a ÃĐtÃĐ accordÃĐ, et tiennent en gÃĐnÃĐral la tÊte de leurs classes. De bonnes notes des professeurs, deux ou trois prix ou accessits, ne suffisent souvent pas pour obtenir une promotion : c'est que la moyenne des boursiers à pourvoir prÃĐsente des rÃĐsultats meilleurs encore. Aux concours d'entrÃĐe dans les grandes ÃĐcoles, les boursiers d'Etat tiennent aussi la tÊte. De calculs faits en 1899 sur les chiffres des annÃĐes prÃĐcÃĐdentes, il rÃĐsulte que, formant 6 % de la population totale des lycÃĐes et collÃĻges, ils obtenaient, calcul fait sur les reçus de l'enseignement libre aussi bien que de l'UniversitÃĐ, 29 % des admissions à Saint-Cyr, 35 % des admissions à l'Ecole polytechnique. Pour le concours de l'Ecole normale et des bourses de licence, la proportion approcherait de 100 %. Quant à l'ÃĐquitÃĐ, au point de vue social, de la rÃĐpartition des bourses, elle est, avec le bon recrutement des boursiers, le grand souci de la Commission centrale. Aux termes mÊmes des dÃĐcrets, elle doit tenir grand compte des services militaires ou civils rendus par les parents des candidats. Elle se conforme à cette prescription. Mais elle s'applique à ne pas la laisser tourner au dÃĐtriment des familles qui, par d'autres formes de travail, servent ÃĐgalement le pays. Elle ne perd jamais de vue, en tout cas, que l'insuffisance des ressources est une des conditions essentielles auxquelles doit Être soumise l'obtention d'une bourse. Sans doute, apprÃĐcier chaque situation exactement est chose dÃĐlicate. Le nombre des enfants, aussi bien que le chiffre des revenus, doit entrer en ligne de compte. Les indications fournies par les dossiers sont quelquefois, par la faute des intÃĐressÃĐs, incomplÃĻtes ou obscures, quelquefois, sans doute, erronÃĐes. La Commission demande, quand elle le croit nÃĐcessaire, un supplÃĐment d'informations prises sur place. Là oÃđ les autoritÃĐs locales n'apportent pas de rectification, elle serait fort empÊchÃĐe d'y voir plus clair qu'elles. Dans l'ensemble, cependant, munie par le prÃĐfet, l'inspecteur, le maire, l'avis du conseil municipal parfois, et la feuille du percepteur, de tous les renseignements dont disposerait une commission dÃĐpartementale, elle se croit en droit de dire que son oeuvre est juste. La publication au Journal officiel du nom des boursiers, et des titres de chaque famille à la bourse, permet du reste de la contrÃīler. Il en ressort avec ÃĐvidence que le soutien de l'Etat ne va qu'à des familles de situation modeste, et surtout aux familles nombreuses, dont les demandes, à moins de mÃĐdiocritÃĐ notoire des enfants, sont rarement rejetÃĐes. Sur ce point essentiel, les statistiques sont, croyons-nous, probantes. La derniÃĻre ÃĐtablie, celle des boursiers nommÃĐs en 1905, donne, pour la rÃĐpartition du nombre â bien modeste â de 1513 bourses ou de fractions de bourses (1288 pour renseignement des garçons, 225 pour celui des jeunes filles) que les crÃĐdits disponibles ont permis d'accorder, les rÃĐsultats suivants : Professions libÃĐrales (mÃĐdecins, avocats, pharmaciens, architectes, hommes de lettres, artistes, etc.): garçons, 32 bourses (2, 59%) ; filles, 6 (2, 7 %) ; Officiers ministÃĐriels (notaires, avouÃĐs, greffiers, huissiers) : garçons, 26 (2, 01 %) ; filles, 2 (0, 08) ; Pasteurs et rabbins : garçons, 7 (0, 54 %) ; filles 1 (0, 04%) ; Officiers en activitÃĐ ou en retraite : garçons, 69 (5, 36 %) ; filles, 8(3, 5%) ; . Fonctionnaires de l'enseignement supÃĐrieur ou de l'enseignement secondaire (ces derniers, dans les lycÃĐes du moins, jouissent pour leurs enfants de l'externat surveillÃĐ gratuit ; il ne leur est guÃĻre accordÃĐ de bourses de demi-pension ou d'internat que si leurs enfants sont obligÃĐs, pour achever leurs ÃĐtudes, de quitter la ville oÃđ les parents enseignent) : garçons, 57 (4, 42 %) ; filles, 25(11, 1 %) ; Fonctionnaires de l'enseignement primaire : garçons, 252 (19, 56 %) ; filles, 52 (23, 1 %) ; ces chiffres sont en augmentation ; la proportion, il y a huit ans, ÃĐtait de 16, 5 %. Depuis lors, la gratuitÃĐ de l'externat a ÃĐtÃĐ accordÃĐe à ces fonctionnaires ; pour en profiter, un plus grand nombre qu'autrefois de ceux qui n'habitent pas à proximitÃĐ d'un collÃĻge ou d'un lycÃĐe postulent des complÃĐments, bourses d'externat surveillÃĐ, de demi-pension, d'internat. Autres fonctionnaires ou employÃĐs de l'Etat, des dÃĐpartements ou des communes : garçons, 278 (22, 35 %) ; filles, 50 (22, 5 %) ; Commerçants : garçons, 113 (8, 77 %) ; filles, 14 (6, 2%) ; Sous-officiers, gendarmes, gardes forestiers, etc.: garçons, 102 (7, 90 %) ; filles, 11 (4, 9 %) ; EmployÃĐs de chemins de fer : garçons, 39 (3, 02 %) ; filles, 9(4 %) ; EmployÃĐs de commerce : garçons, 83 (6, 46 %) ; filles, 24 (10, 7 %) ; Cultivateurs, fermiers, petits propriÃĐtaires : garçons, 95 (7, 53 %) ; filles, 8 (3, 5 %) ; Artisans et ouvriers : garçons, 135 (10, 48 %) ; filles, 7 (3, 1 %). Pour cette derniÃĻre catÃĐgorie, l'augmentation progressive du quantum est intÃĐressante à noter. En 1885, les boursiers (garçons) de cette origine formaient 1 % du total ; en 1898, 7, 5 % ; la proportion est de 10, 48% en 1905. Il importe d'ailleurs de remarquer que dans les milieux ouvriers, comme dans tous ceux oÃđ les parents sont, par leur culture propre, plus ÃĐloignÃĐs du souci des ÃĐtudes, et, par leurs habitudes d'esprit, moins portÃĐs que d'autres à diriger leurs enfants vers des fonctions publiques, trÃĻs peu d'enfants sont poussÃĐs, soit par leurs familles, soit par les instituteurs, à se prÃĐsenter au concours des bourses. Les boursiers de cette origine, et de certains autres ÃĐgalement modestes, dont le nombre, nous venons de le montrer, s'accroît dÃĐjà d'une façon continue, seraient à coup sÃŧr plus nombreux encore si, dans les milieux auxquels ils appartiennent, il se produisait plus de candidatures. Quant aux plaintes que les postulants malheureux font quelquefois entendre sur les nominations de boursiers, la Commission, qui ne peut d'ailleurs y rÃĐpondre que pour sa part de responsabilitÃĐ, estime, sans se croire cependant infaillible, qu'elles tiennent le plus souvent à cette double cause : illusions assez naturelles des plaignants sur l'importance de leurs titres personnels et la valeur scolaire de leurs enfants ; impossibilitÃĐ oÃđ ils sont, ne jugeant que sur deux, ou trois cas dont le leur est le seul, du reste, qu'ils connaissent dans le dÃĐtail, de se rendre compte des exigences moyennes, soit comme situation, soit comme qualitÃĐs intellectuelles et morales, soit comme notes d'examen, auxquelles une longue habitude et la comparaison annuelle de milliers de dossiers amÃĻnent naturellement, et justement, la Commission centrale. |
| Â |