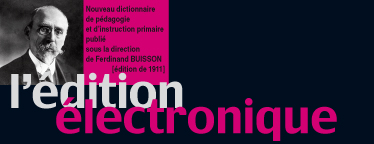 |
fFleury (Claude)L'abbé Fleury est connu surtout par son Histoire ecclésiastique (1691 et années suivantes), que l'Histoire de l'Eglise de l'abbé Choisy, venue trente ans plus tard, ne put détrôner dans la faveur du public d'autrefois ; on disait plaisamment, en ce temps-là : « L'abbé Choisy est plus fleuri, mais l'abbé Fleury est plus choisi ». Mais Fleury mérite aussi une mention pour ses idées pédagogiques. C'était un esprit distingué et, sur plusieurs points, en avance sur son siècle. C'est en 1685 qu'il publia son traité Du choix et de la méthode des éludes. Il s'était préparé à ce travail par une longue expérience personnelle acquise auprès des princes de Conti, dont il avait été le gouverneur. Ajoutons qu'en 1689 Fénelon, qui prisait fort son esprit et ses qualités, se l'adjoignit comme sous-précepteur du duc de Bourgogne, Son livre est à la fois une critique très vive des méthodes en usage et un exposé des réformes que l'auteur voulait introduire dans les études. C'est avec une sévérité justifiée qu'il juge le moyen âge et la dialectique verbale alors en honneur : « Cette manière de philosopher sur les mots et les phrases, sans examiner les choses en elles-mêmes, était assurément commode, dit-il, pour se passer de la connaissance des faits qui ne s'acquiert que par la lecture. » ; Fleury a le tort de ne pas ajouter : et par l'étude directe de la nature, mais il ne méconnaissait pas cette source du savoir, car il dit ailleurs : « Ce que l'on appelait au moyen âge étudier la physique, c'était raisonner en l'air, comme si la nature n eût plus été au monde pour la consulter elle-même ». Sévère pour le moyen âge, Fleury admire la Renaissance et le beau mouvement littéraire du seizième siècle ; mais il critique avec justesse les excès érudits des lettrés de cette époque. « Il y eut alors des curieux qui passèrent leur vie à étudier le latin et le grec, et à lire tous les auteurs seulement pour la langue. Un a cru que se servir des anciens, c'était les savoir par coeur, parler des choses dont ils ont parlé, et redire leurs propres paroles, au lieu que, pour les bien imiter, il faut choisir les sujets qui nous conviennent, les traiter comme eux d'une manière solide et agréable, et les expliquer aussi bien en noire langue qu'ils les expliquaient en la leur. » Fleury, qui a l'esprit très porté à la critique, n'est pas content non plus des études de son temps. Il proteste contre les vers latins, se plaint qu'on sorte du collège avec une médiocre connaissance de l'histoire, et croit enfin à l'urgence d'une réforme. Il demande qu'on exerce l'écolier en sa langue, et qu'on lui fasse écrire des narrations, des lettres, avant d'en venir à des sujets plus difficiles. Il se moque des latinistes de collège qui ne savent parler qu'à des Grecs et à des Romains, et qui sont ensuite tout déconcertés dans le monde, « quand il leur faut parler à des hommes qui portent des chapeaux et des perruques ». Fleury se préoccupe d'abord des dispositions de l'enfant. Le grand obstacle à l'étude et au progrès, c'est la mauvaise méthode que l'on suit : on propose à l'enfant des vérités abstraites, des formules générales, à un âge où il peut tout au plus observer et saisir des choses concrètes et particulières. Le remède est par conséquent tout trouvé : il faut, autant qu'il est possible, ne présenter à l'enfant que des objets sensibles, «des peintures et des images ». Fleury demande qu'on s'étudie à rendre l'instruction attrayante ; mais il indique pour cela des moyens un peu naïfs et un peu puérils. Il veut que les livres qu'on met entre les mains de l'enfant soient neufs et bien reliés, que tout, autour de lui, soit souriant et gracieux, que le précepteur lui-même ait un beau visage ! Flatter et séduire les sens pour captiver peu à peu l'intelligence, tel est le principe. Fleury pose ensuite une autre question : « A qui l'instruction est-elle due? Faut-il la donner à tous ou la réserver à quelques-uns? » Fleury répond que tout le monde doit en avoir sa part : « Il n'est pas juste que les pauvres, les artisans, les femmes, qui ont de la raison comme les autres, demeurent sans instruction ». Mais il ne va pas jusqu'au bout de ce principe : se contredisant lui-même, il conclut que « les pauvres n'ont besoin ni de savoir lire, ni de savoir écrire ». Les connaissances nécessaires à tous, dit-il, sont la morale, la logique, l'hygiène : connaître et pratiquer ses devoirs, avoir l'esprit juste et le raisonnement droit, jouir d'une santé robuste, voilà l'idéal de tous les hommes. Quant aux études qui demeurent nécessairement le privilège d'une élite. Fleury les divise en trois classes : il y a les études nécessaires, puis les éludes utiles, enfin les études simplement curieuses. Les études nécessaires sont la grammaire, l'arithmétique, l'économie (c'est-à-dire l'art d'administrer sa maison), la jurisprudence. L'énumération est un peu courte : mais ce qui est plus choquant encore, c'est de voir Fleury compter l'histoire, la physique, les langues parmi les études dont on peut se passer à la rigueur. On voit que, si le sous-précepteur du duc de Bourgogne avait su critiquer quelques défauts de la pédagogie scolastique, ses vues générales sur l'instruction publique étaient remarquablement étroites. |
