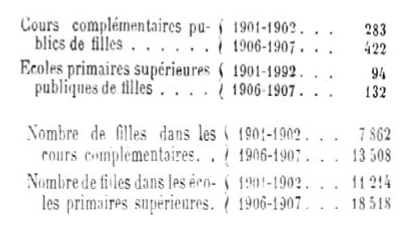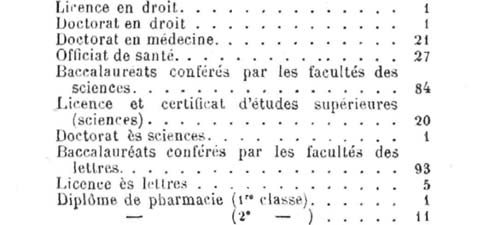|
fFilles (Instruction primaire, secondaire et supérieure des)Nous ne faisons pas entrer dans cet article des considérations historiques sur l'éducation des filles en France au moyen âge et sous l'ancien régime. Il n'était pas question, avant 1789. d'une éducation nationale à laquelle les jeunes filles dussent avoir part : c'était l'Eglise qui se chargeait de donner aux filles des paysans, des artisans, de la bourgeoisie, et même de la noblesse, l'enseignement qu'elle jugeait approprié à leur sexe ; et, en dehors des exercices destines à former les élèves à la piété et aux bonnes moeurs, la tâche de l'école ou du couvent se bornait à faire acquérir aux futures mères de famille les notions les plus élémentaires de la lecture, de l'écriture et du calcul. On pourrait citer, il est vrai, à partir du seizième siècle, quelques éducations particulières, quelques fondations comme celle de Saint-Cyr, quelques livres comme ceux de Fénelon et de Rousseau: mais ce sont là des faits isolés, à propos desquels le lecteur pourra consulter les articles du Dictionnaire qui s'y rapportent (voir entre autres Erasme, Vivès, Fénelon, Mme de Maintenon, Mme de Lambert, Rousseau). Aussi, sans nous arrêter à cette période de notre histoire, où nous ne pourrions que constater l'absolue insuffisance des programmes et des moyens d'enseignement, nous restreignons notre étude à la période moderne, à partir du moment où la Révolution posa la question de l'éducation des filles comme l'une des moitiés du problème de l'éducation générale de la nation. PREMIERE PARTIE. — De 1789 à 1870. 1° Enseignement primaire. L'histoire de l'instruction primaire des filles en France depuis 1789 jusqu'à nos jours est résumée dans les documents législatifs où les gouvernements qui se sont succédé parmi nous ont inscrit leur pensée. L'impression qui résulte d'un examen attentif de ces documents, c'est que, jusqu'à l'époque contemporaine, l'éducation des filles n'a pas obtenu dans les préoccupations des hommes d'Etat la même place que celle des garçons. Il semble que trop souvent la question ne soit venue qu'en seconde ligne, et que parfois même elle ait été reléguée dans un dédaigneux oubli ; comme si l'on pouvait espérer d'obtenir une bonne éducation de l'enfance tant que les mères ne seront pas façonnées elles-mêmes à leur rôle d'institutrices. Nous allons laisser aux textes le soin de parler à notre place. Période révolutionnaire. — L'Assemblée constituante n'eut pas le temps d'aborder le problème de l'éducation nationale. Dans le projet de décret que lui présenta Talleyrand au moment où elle allait se séparer, huit articles formant le titre XVII étaient consacrés à l'éducation des filles. En voici le texte : « ARTICLE PREMIER. — Les filles ne pourront être admises aux écoles primaires que jusqu'à l'âge de huit ans. « ART. 2. — Après cet âge, l'Assemblée nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles et leur rappelle que c'est leur premier devoir. « ART. 3. — Il sera pourvu, dans chaque département, au moyen de former des établissements destinés à procurer aux filles qui sortiront des écoles primaires, ou de la première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables a leur sexe. « ART. 4. — Il sera pourvu aussi par les départements à l'établissement d'un nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne pourront être élevées dans la maison paternelle. « ART. 5. — Ces maisons seront dirigées par des institutrices nommées par les directoires des départements. « ART. 6. — Les départements prescriront des règles à ces établissements, veilleront à leur exécution, pourront destituer les institutrices dont la conduite ne répondrait pas à la confiance publique. « ART. 7. — Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitements des institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs élèves. « ART. 8. — Toutes les instructions données aux élèves dans les maisons d'éducation publique tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique et aux talents utiles dans le gouvernement d'une famille. » Condorcet fit à l'Assemblée législative, au nom du Comité d'instruction publique, un rapport qui est resté fameux, et qu'inspirait un ardent amour de l'indépendance et de l'égalité sociale. Le projet de loi annexé à son rapport prévoyait, dans les villages de 400 à 1500 habitants, une seule école primaire, avec un instituteur ; dans les endroits qui renferment de 1500 à 4000 habitants, deux écoles, un instituteur et une institutrice, ou bien une seule école avec un instituteur et une institutrice. L'école unique des villages de 400 à 1500 habitants devait être nécessairement mixte quant au sexe ; celles des endroits de 1500 à 4000 habitants pouvaient le devenir, si les deux écoles étaient réunies en une seule. Le rapport ne contient rien qui vise spécialement l'éducation des filles : mais c'est, dit-il, parce que « cette instruction sera l'objet d'un rapport particulier ; et, en effet, si l'on observe que, dans les familles peu riches, la partie domestique de l'éducation des enfants est presque uniquement abandonnée à leurs mères ; si l'on songe que sur vingt-cinq familles livrées à l'agriculture, au commerce, aux arts, une au moins a une veuve pour son chef, on sentira combien cette portion du travail qui nous a été confié est importante et pour la prospérité commune, et pour le progrès général des lumières ». On sait du reste quelles étaient les opinions de Condorcet : croyant à l'égalité intellectuelle des sexes, il était partisan, non seulement de la parité des programmes de l'enseignement, mais de l'enseignement commun. Avec la Convention commence une ère nouvelle dans l'histoire de l'instruction publique en France. On a retracé dans ce Dictionnaire (Voir Convention) les efforts tentés par cette assemblée pour organiser l'éducation nationale. Dégageons de ces actes ceux qui se rapportent spécialement à l'éducation des filles. Le décret du 30 mai 1793 dispose « qu'il y aura une école primaire clans tous les lieux qui ont depuis-400 jusqu'à 1500 individus ». Voilà l'origine légale des écoles mixtes. Ce principe, comme on vient de le voir, était emprunté au plan de Condorcet. Lepeletier, dans son plan d'éducation commune, lu à la Convention le 13 juillet 1793 par Robespierre, avait écrit: « Je demande que vous décrétiez que depuis l'âge de cinq ans jusqu'à douze pour les garçons, et jusqu'à onze pour les filles, tous les enfants, sans distinction et sans exception, seront élevés en commun aux dépens de la République, et que tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront mêmes vêtements, même nourriture, même instruction, mêmes soins ». Le plan présenté par Romme en octobre 1793, au nom de la Commission d'éducation nationale, maintenait l'école mixte quant au sexe dans les communes de 400 à 1500 habitants, mais il prévoyait, comme d'ailleurs le projet Condorcet, dans les communes plus considérables, des écoles spéciales aux filles dirigées par des institutrices. L'art. 10 du décret du 5 brumaire an II détermine en ces termes le programme de l'enseignement destiné aux filles : « Les filles s'occupent des mêmes objets d'enseignement et reçoivent la même éducation que les garçons, autant que leur sexe le comporte : mais elles s'exercent plus particulièrement a la filature, à la couture et aux travaux domestiques qui conviennent à leur sexe. » Le décret Bouquier (du 29 frimaire an II), qui remplaça le plan de Romme, ne contient pas de dispositions spéciales aux écoles de filles. Après le 9 thermidor, Lakanal fait voter le décret du 27 brumaire an III, et c'est là que pour la première fois se trouve inscrit le principe de la séparation obligatoire des sexes. L'art. 7 de ce décret dit : « Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles ; en conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice. » L'enseignement donné aux élèves est d'ailleurs le même dans chacune des deux sections. Après la destruction de la constitution républicaine de 1793, la Commission des Onze, qui fit la constitution de l'an III, présenta, par l'organe de Daunou (6 messidor), un projet d'organisation de l'instruction publique dans lequel les Tilles étaient exclues des écoles publiques : « L'éducation des filles — y était-il dit — est réservée aux soins domestiques des parents, et aux établissements libres et particuliers d'instruction ». Le projet du 23 vendémiaire an IV (première forme du décret organique du 3 brumaire an IV] contient la même disposition ; mais le 27 vendémiaire la Convention renvoya au Comité d'instruction publique l'examen de cette question : « Y aura-t-il des écoles primaires pour les filles? » Le Comité se prononça pour l'affirmative ; et, ensuite de cette décision, Lakanal, le 3 brumaire, présenta à l'assemblée, qui l'adopta, le décret que voici, en deux articles : « ARTICLE PREMIER. — Chaque école primaire sera divisée en deux sections, une pour les garçons, et une pour les filles. En conséquence, il y aura un instituteur et une institutrice. « ART. 2. — Les filles apprendront à lire, écrire, compter, les éléments de la morale républicaine ; elles seront formées aux travaux manuels des différentes espèces utiles et communes. » Dans le rapport qui précédait le décret, Lakanal disait : « Ce sont les femmes qui façonnent notre enfance et font notre première éducation, d'où dépendent presque toujours nos destinées. Voulez-vous donner à la patrie des citoyens vertueux ? Donnez aux femmes une éducation républicaine. Si vous les abandonnez aux soins domestiques, vous les condamnez pour la plupart à une entière nullité morale. » Consulat, Empire et Restauration. — Le gouvernement consulaire et impérial s'est fort peu occupé de l'instruction populaire. Toutefois, les articles 107 et 108 du décret constitutif de l'Université impériale prescrivent des mesures pour l'établissement de cours normaux annexés aux lycées et collèges, en vue de former de bons maîtres pour les écoles primaires ; mais il ne s'agit là que des hommes, et aucun secours de même nature n'est offert aux institutrices. Détournée de l'instruction populaire par d'autres soins, la sollicitude de Napoléon se porte, au contraire, sur l'éducation des filles de ses généraux et de ses légionnaires. L'établissement d'une maison de la Légion d'honneur à Ecouen est une conception qui lui appartient en propre ; elle lui fournit l'occasion de découvrir toute sa pensée en matière d'éducation des femmes. Comme plusieurs esprits distingués de son temps, Napoléon jugeait avec sévérité ce qu'il appelait « la faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées » ; il les considérait comme des êtres d'une nature inférieure ; et comme il bornait leur rôle aux choses du ménage, entendu dans le sens le plus étroit, par une conséquence logique il limitait leur instruction aux données les plus élémentaires. Comment aurait-il restitué au programme des écoles populaires de filles l'histoire et la géographie, la littérature, les éléments des sciences physiques et naturelles, quand il hésitait à maintenir ces matières sur les programmes d'études de la maison d'Ecouen ou n'eu concédait l'usage que d'une main avare? La Restauration n'était pas le gouvernement le plus propre à prendre en main l'oeuvre de l'éducation des filles. L'ordonnance royale du 29 février 1816 organisa les comités cantonaux, nous n'avons pas besoin de rappeler dans quel esprit. Cette ordonnance, qui compte 42 articles, ne dit rien des écoles de filles ; mais l'art. 22 maintient l'interdiction des écoles mixtes : « Les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir l'enseignement ». L'instruction du 14 juin 1816, qui règle le mode d'examen pour le brevet de capacité, est également muette sur la question des filles et ne prescrit aucune épreuve pour les travaux à l'aiguille. Aucun des actes émanés de la Commission d'instruction publique, pendant les trois années qui suivent, ne porte la trace d'une pensée en faveur de l'éducation féminine. Qu'il s'agisse de créer dans les académies des écoles modèles d'enseignement mutuel, de distribuer des récompenses honorifiques aux chefs d'école, c'est toujours aux instituteurs que songent exclusivement les pouvoirs publics. L'administration eut tardivement conscience de cette lacune, et, dans une instruction du 3 juin 1819, le ministre de l'intérieur (on sait que l'instruction publique était alors une simple division de son ministère), le comte Decazes, s'efforça de réparer le mal causé par une si funeste omission. « Monsieur le préfet, dit cette circulaire, plus les résultats obtenus par l'application des dispositions de cette ordonnance (celle de 1816) aux écoles de garçons ont été heureux, et plus on regrette que celles de ces dispositions qui en étaient susceptibles n'aient point été étendues aux écoles de filles, qui, moins nombreuses que les premières, niais non moins intéressantes, appellent aussi la sollicitude de l'autorité. « ... Les trois objets qui doivent vous occuper sont : 1° le choix des institutrices ; 2° la surveillance des écoles ; 3° l'augmentation de leur nombre. « La surveillance des institutrices devant être attribuée aux comités cantonaux, et l'ordonnance du 29 février 1816 indiquant assez de quelle manière cette surveillance doit être exercée, je crois inutile de m'étendre sur ce point. « Vous savez également quels sont les moyens à employer pour multiplier le nombre des écoles dans les communes où il est insuffisant. Je vais donc m'attacher surtout à vous guider dans le choix des institutrices, opération d'une grande importance, et qui est confiée à vos soins immédiats. » (Suivent des prescriptions relatives à l'examen du brevet de capacité et à la nomination des institutrices. Les brevets sont de deux degrés. Ceux du degré inférieur sont accordés aux personnes qui sauront suffisamment lire, écrire et chiffrer pour en donner des leçons. Les connaissances exigées des institutrices du degré supérieur seront les principes de la religion, la lecture, l'écriture, les quatre règles de l'arithmétique, celles de trois et de société, et les éléments de la grammaire.) « Aucune institutrice ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir des garçons dans son école.» Deux mois plus tard, le 29 juillet, le ministre complétait cette circulaire par de nouvelles instructions, où on lit : « On demande, dans quelques départements, si les institutrices qui appartiennent à des congrégations religieuses doivent être soumises aux mêmes formalités que les institutrices libres. « La circulaire n'exprime point d'exception en faveur des premières et l'on ne saurait en admettre ; la seule formalité dont on puisse les dispenser est celle de se pourvoir des brevets de capacité. Vous pourrez leur délivrer l'autorisation d'enseigner, d'après l'exhibition de leur lettre d'obédience. « Ces institutrices seront ainsi assimilées aux Frères des Ecoles chrétiennes. » C'est dans ce document qu'on voit apparaître pour la première fois le privilège accordé aux congréganistes femmes (concédé aux congréganistes hommes dès 1808), et qui devait subsister pendant soixante-deux ans. On remarquera qu'au moment même où il octroie aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses cet exorbitant passe-droit, le ministre déclare hypocritement « qu'on ne saurait admettre d'exception en faveur des congréganistes », et qu'il s'agit seulement de les « dispenser d'une formalité ». Dans cette même année 1819, la ville de Paris, pour qui la sollicitude envers ses écoles est d'antique tradition, publia par l'organe du préfet un règlement spécial aux écoles de filles et applicable tant à la ville qu'aux communes rurales du département de la Seine. Ce règlement, en 38 articles, contient quelques dispositions remarquables : L'art. Il confie la surveillance et l'inspection des écoles de filles établies à Paris à des dames surveillantes ; L'art. 12 impose à ces inspectrices l'obligation d'adresser tous les trois mois un rapport aux maires des arrondissements pour être transmis au préfet de la Seine ; L'art. 14 charge les sous-préfets et les maires de Paris de « dresser le tableau des jeunes filles qui, ne recevant point chez leurs parents ou dans les écoles établies l'instruction primaire, sont dans le cas d'être appelées aux écoles publiques, dont le nombre sera augmenté à cet effet partout où il sera reconnu insuffisant ». Une instruction du ministre de l'intérieur Siméon aux préfets, du 19 juin 1820, édicta des prescriptions relatives aux « écoles de filles des degrés supérieurs », et à l'examen des maîtresses et sous-maitresses de ces écoles. On y lit ce passage : « Les maîtresses et sous-maîtresses appartenant à des congrégations religieuses autorisées par le roi seront dispensées de subir l'examen ; vous pourrez leur remettre le diplôme et l'autorisation d'enseigner, d'après l'exhibition de leur lettre d'obédience. » Monarchie de 1830. — Nous sommes arrivés à la monarchie de Juillet et à cette loi fameuse du 28 juin 1833 qui a renouvelé la face de l'enseignement primaire en France. Plus d'une mesure transitoire, plus d'un projet dû à l'initiative parlementaire s'étaient produits entre l'avènement du gouvernement nouveau et la discussion de la loi de 1833, mais cette dernière les a rejetés dans l'ombre. Et pourtant cette loi ne traite qu'une moitié de la question : consacrée tout entière à l'organisation des écoles de garçons, elle laisse systématiquement en dehors de son action féconde les écoles de filles. Le nom de ces dernières n'est pas même prononcé : le gouvernement, qui avait introduit dans son projet primitif une disposition transitoire concernant les filles, l'article 26, consentit à la suppression de cet article. Voici comment la chose se fit. L'article 26 en question portait que les dispositions de la loi seraient applicables aux écoles de filles. Or, parmi ces dispositions, il en était une (art. 4) qui exigeait des instituteurs — sans qu'une exception fût faite pour les congréganistes — la possession du brevet de capacité. Une semblable exigence, étendue aux institutrices, allait mettre les congréganistes femmes dans l'impossibilité de continuer à enseigner. Le supérieur général des Lazaristes, Etienne, qui était en même temps supérieur de la Compagnie des Filles de la Charité, prit peur, et résolut de chercher à écarter le danger. On lit ce qui suit dans sa biographie, écrite par un prêtre de la Mission (Paris, Gaume et Cie, 1881) : « M. Etienne songea d'abord à s'entendre avec les Frères des Ecoles chrétiennes, et à adresser, de concert avec eux, une réclamation au gouvernement. Mais le supérieur général des Frères refusant de s'associer à cette démarche et préférant se soumettre aux exigences de la nouvelle loi, M. Etienne fut contraint d'agir isolément, et résolut de s'adresser à M. Guizot, dont il possédait l'estime et la bienveillance. Prenant donc occasion de quelque autre affaire, il va trouver le ministre, et, celui-ci lui ayant demandé incidemment des nouvelles de la Compagnie des Filles de la Charité, qu'il aimait beaucoup et dont il appréciait singulièrement les services : « Les Filles de la Charité, répondit M. Etienne, sont dans la plus grande inquiétude, depuis qu'elles savent qu'il est question de fermer leurs écoles. — Fermer leurs écoles! et pourquoi cela? demanda le ministre avec étonnement. — Parce que le récent projet de loi sur l'instruction primaire exige des institutrices un brevet de capacité. — Eh bien ! est-ce là une difficulté sérieuse? La plupart des soeurs employées aux écoles sont très capables, je le sais, et n'ont point à redouter un échec devant le jury d'examen. — Sans doute, monsieur le ministre, si elles se résignent à comparaître devant le jury, mais. — La loi, interrompit M. Guizot, doit être la même pour tous, et nous ne saurions faire d'exception poulies religieuses. — Nous ne demanderions pas non plus d'exception, reprit M. Etienne, s'il n'y avait là pour les communautés religieuses une question de vie ou de mort ; mais nous sommes persuadés que cette mesure leur serait fatale, et nous croyons que cet avis sera partagé par tous ceux qui connaissent la nature de l'état religieux, les vertus spéciales qu'il exige et les habitudes de vie qu'il fait contracter. » Et là-dessus Etienne exposa longuement les raisons qui, selon lui, devaient faire dispenser de l'examen les soeurs enseignantes. Guizot fut très frappé, ajoute le biographe, des arguments de son interlocuteur ; et à quelque temps de là, le 4 mai 1833, l'article 26 du projet ayant été mis en discussion à la Chambre, et quelques députés en ayant demandé la suppression, tandis que d'autres voulaient seulement le modifier : « J'adhère à la suppression totale », dit le ministre, et l'article, mis aux voix, fut supprimé. Par la suppression de l'article 26, la loi ne s'appliquait plus qu'aux écoles de garçons. Donc ce fut pour les garçons seulement et non pour les filles que l'article 9 imposa à toute commune l'obligation de fonder et d'entretenir une école publique ; aux filles, il restait la ressource de l'école mixte ; Ce fut pour les garçons et non pour les filles que l'article 10 constitua tout un réseau d'écoles primaires supérieures dans les communes de 6000 habitants ; Ce fut pour les garçons seulement que l'article Il décida la création d'une école normale par département ; ce furent les instituteurs et non les institutrices que l'article 12 tira d'une situation misérable, en leur assurant un logement communal et un traitement fixe. Bref, au lendemain du vote de la loi du 28 juin 1833, les écoles de filles se trouvèrent soumises à un régime d'exception. Mode d'administration, nomination, recrutement et paiement des institutrices, tout resta pendant trois années sur le pied où l'avaient placé les ordonnances de la Restauration. Préfets des départements, comités locaux, réclamèrent vainement un régime commun. Des décisions réitérées du Conseil royal (14 janvier, 25 février. 4 juillet 1834) repoussèrent leurs demandes et maintinrent l'application stricte de la loi du 28 juin 1833. Toutefois, dès le 25 avril 1834, un premier et important progrès fut accompli sur le terrain pédagogique. Le Conseil royal édicta un règlement dont les sages dispositions furent applicables aux écoles de filles (art. 33), avec addition pour celles-ci des travaux à l'aiguille. Programmes d'études dans les écoles élémentaires, emploi du temps, sectionnement des élèves, punitions et discipline, examens publics, etc., ce règlement, élaboré avec une intelligente sollicitude, prévoyait tout, et introduisait ainsi dans les écoles des deux sexes les mêmes garanties d'ordre et de travail. Mais ce ne fut que le 23 juin 1836, trois ans presque jour pour jour après le vote de la loi organique, qu'une ordonnance royale — le comte Pelet (de la Lozère) étant ministre de l'instruction publique — dota les écoles de filles d'un régime complet. Cette ordonnance maintint expressément pour les institutrices congréganistes le privilège de la dispense du brevet élémentaire (art. 13). Voici le texte des 19 articles dont elle se compose : « Louis-Philippe, etc. : « Vu les ordonnances royales concernant les écoles primaires de filles et notamment celles des 29 février 1816, 3 avril 1820, 13 octobre 1821, 8 avril 1824, 21 avril 1828, 6 janvier et 14 février 1830 ; « Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, ensemble nos ordonnances du 16 juillet et du 8 novembre de la même année et du 26 février 1835 ; « Considérant qu'il est nécessaire de coordonner et de modifier sur certains points les dispositions des anciennes ordonnances précitées, en se rapprochant, autant que possible, des dispositions de la loi de 1833 ; « Le Conseil royal de l'instruction publique entendu ; « Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique ; « Nous avons ordonné ce qui suit : « TITRE Ier. — DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LES ECOLES DE FILLES ET DE SON OBJET. « ARTICLE PREMIER. — L'instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure. « L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, les éléments de la langue française, le chant, les travaux d'aiguille, et les éléments du dessin linéaire. « L'instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues de l'arithmétique et de la langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France. « ART. 2. — Dans les écoles de l'un et de l'autre degré, sur l'avis du comité local et du comité d'arrondissement, l'instruction primaire pourra recevoir, avec l'autorisation du recteur de l'académie, les développements qui seront jugés convenables selon les besoins et les ressources des localités. « ART. 3. — Les articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux écoles primaires de filles. « TITRE II. — DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES. « ART. 4. — Pour avoir le droit de tenir une école primaire privée, il faudra avoir obtenu : 1° un brevet de capacité, sauf le cas prévu par l'article 13 de la présente ordonnance ; 2° une autorisation pour un lieu déterminé. « 1° Du brevet de capacité. « ART. 5. — Il y a deux sortes de brevets de capacité : les uns pour l'instruction primaire élémentaire, les autres pour l'instruction primaire supérieure. « Ces brevets seront délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée par notre ministre de l'instruction publique, et conformément à un programme déterminé par le Conseil royal. « ART. 6. — Aucune postulante ne sera admise devant la commission d'examen, si elle n'est âgée de vingt ans au moins. Elle sera tenue de présenter : 1° son acte de naissance ; si elle est veuve, l'acte de décès de son mari ; 2° un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où elle aura résidé depuis trois ans. « A Paris, le certificat sera délivré, sur l'attestation de trois notables, par le maire de l'arrondissement municipal ou de chacun des arrondissements municipaux ou l'impétrante aura résidé depuis trois ans. « 2° De l'autorisation. « ART. 7. — L'autorisation nécessaire pour tenir une école primaire de filles sera délivrée par le recteur de l'académie. « Cette autorisation, sauf le cas prévu par l'article 13, sera donnée, après avis du comité local et du comité d'arrondissement, sur la présentation du brevet de capacité et d'un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l'époque où elle aura obtenu le brevet de capacité. « ART. 8. — L'autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes ; il faut, pour tenir pensionnat, une autorisation spéciale. « TITRE III. — DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES. « ART. 9. — Nulle école ne pourra prendre le litre d'école primaire communale, qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à l'institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d'établissements publics, soit par une délibération du conseil municipal dûment approuvée. « ART. 10. — Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu'elle s'impose. « Seront admises gratuitement dans l'école publique les élèves que le conseil municipal aura désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution. « ART. 11. — Les dispositions de l'article 2 et suivants de la présente ordonnance, relatives au brevet de capacité et à l'autorisation, sont applicables aux écoles primaires publiques. « Toutefois, à l'égard de ces dernières, le recteur devra se faire remettre, outre les pièces mentionnées à l'article 6, une expédition de la délibération du conseil municipal qui fixera le sort de l'institutrice. « ART. 12. — Dans les lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d'admettre des filles, et à aucune institutrice d'admettre des garçons. « TITRE IV. — DES ECOLES PRIMAIRES DE FILLES DIRIGEES PAR DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES. « ART. 13. — Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse, dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance, pourront être autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leur lettre d'obédience et sur l'indication, par la supérieure, de la commune où les soeurs seront appelées. « ART. 14. — L'autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d'un brevet de capacité du degré supérieur, obtenu dans la forme et aux conditions prescrites par la présente ordonnance. « TITRE V. — DES AUTORITES PREPOSEES A L'INSTRUCTION PRIMAIRE. « ART. 15. — Les comités locaux et les comités d'arrondissement, établis en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l'ordonnance du 8 novembre de la même année, exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les articles 21, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, et 23, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite loi. « ART. 16. — Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi leurs membres ou par des dames inspectrices. « ART. 17. — Lorsque les dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité, soit local, soit d arrondissement, concernant les écoles qu'elles auront visitées, elles assisteront à la séance avec voix délibérative. « ART. 18. — Il y aura dans chaque département une commission d'instruction primaire chargée d'examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité. « Les examens auront lieu publiquement. « Des dames inspectrices pourront faire partie desdites commissions. « Ces commissions délivreront des certificats d'aptitude d'après lesquels le recteur de l'académie expédiera le brevet de capacité sous l'autorité du ministre. « Dispositions transitoires. « ART. 19. — Les institutrices primaires, communales ou privées, actuellement établies en vertu d'autorisations régulièrement obtenues, pourront continuer de tenir leurs écoles sans avoir besoin d'aucun nouveau titre ; elles devront seulement déclarer leur intention au comité local d'ici au 1er septembre prochain. » Cette ordonnance royale constitue un progrès remarquable sur la législation qui avait prévalu à partir du décret du 3 brumaire an IV. Elle reconnaît le droit des filles de participer à l'enseignement primaire supérieur (art. 1er). A l'égard du traitement des institutrices, elle se contente d'une demi-mesure. Il faut, pour que l'école soit déclarée communale, que le conseil municipal vote un traitement fixe suffisant, mais le chiffre du traitement n'est pas déterminé comme pour les instituteurs, et les communes ne sont pas mises en face de l'obligation légale de créer une école spéciale aux filles (articles 9 et 10). On donnait aux comités le droit de faire visiter les écoles par des dames inspectrices, et on admettait la présence de ces dames inspectrices dans la commission d'examen pour les aspirantes au brevet de capacité (articles 16 et 18). Quant à la lettre d'obédience tenant lieu de brevet aux institutrices congréganistes, dans les écoles élémentaires, le privilège, qui datait de la Restauration, en était maintenu (art. 13). Aucune obligation n'était imposée aux départements quant aux écoles normales de filles, et cependant telle était l'excellence et la nécessité de l'institution que, spontanément, des écoles s'établirent à Mézières, à Lons-le-Saulnier, Argentan, Besançon, Orléans, Lyon. C'est sous le régime fixé par cette ordonnance que vécurent les écoles de filles jusqu'à la loi du 15 mars 1850. Seconde République et Second Empire. — En 1848, quand la seconde République eut remplacé le gouvernement de Juillet, l'un de ses premiers actes fut de supprimer la lettre d'obédience (circulaire ministérielle du 5 juin 1848) ; mais les effets de cette circulaire furent abolis par deux autres circulaires dictées dans des intentions toutes différentes, à la date des 6 novembre 1848 et 25 janvier 1849. Déjà s'élaborait la loi du 15 mars 1850. Avant de nous occuper de cette loi, citons à l'actif du gouvernement de la seconde République, à l'époque où le portefeuille de l'instruction publique était aux mains d'Hippolyte Camot, le projet de loi présenté par ce ministre le 30 juin 1848. L'enseignement, par ce projet, est rendu obligatoire et gratuit pour les enfants des deux sexes. L'enseignement de l'histoire et de la géographie prend place dans le programme des écoles élémentaires de garçons et de filles. Dans les écoles mixtes quant au sexe, les travaux spéciaux aux filles se font sous la direction d'une dame, à laquelle est allouée une indemnité annuelle de 100 francs. Les comités locaux, pour les affaires concernant les écoles de filles, s'adjoignent une ou plusieurs déléguées qui assistent aux séances avec voix délibérative. La commission d'examen pour les aspirantes au brevet de capacité s'adjoint deux examinatrices qui ont voix délibérative. Mentionnons encore un autre projet (15 décembre 1848) rédigé par une commission dont Barthélémy Saint-Hilaire fut président. Il reproduit la plupart des dispositions du projet Camot, mais il embrasse plus de choses. Les salles d'asile, ce premier degré de l'école, les écoles normales, qui en forment le couronnement, y figurent. Les écoles normales d'instituteurs y sont obligatoires pour le département, celles d'institutrices seulement facultatives. L'obligation d'entretenir une école de filles commence aux communes de 800 âmes de population agglomérée. Les écoles supérieures de filles sont facultatives, celles de garçons sont obligatoires dans les communes de 6000 âmes et au-dessus. La lettre d'obédience est supprimée avec délai de cinq ans pour les institutrices âgées de moins de trente ans, et tolérance complète pour les institutrices âgées de plus de trente ans. Telles étaient les idées qui dominaient dans les rangs du parti libéral en 1848 et auxquelles le cours des événements substitua la loi du 15 mars 1850. La loi de 1850 a réuni en cinq articles, formant le chapitre V, tout ce qui concerne les écoles de filles ; en voici le texte : « CHAP. V. — Des écoles de filles. « ART. 48. — L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'art. 23, les travaux à l'aiguille. « ART. 49. — Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat. « L'examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement. « ART. 50. — Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices, à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en Conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi relatives aux écoles et aux instituteurs sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des articles 38, 39, 40 et 41. «ART. 51. — Toute commune de 800 âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf ce qui est dit à l'art. 15. « Le Conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles ; et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que l'école des garçons et l'école des filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal. « ART. 52. — Aucune école primaire publique ou libre ne peut, sans l'autorisation du Conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes, s*il existe dans la commune une école publique ou libre de filles. » Deux articles constituent un progrès sérieux sur la législation de 1833 : ce sont l'art. 51, qui impose à toute commune de 800 âmes l'obligation d'avoir une école de filles, « si ses propres ressources lui en fournissent les moyens », et l'art. 52 qui retire aux instituteurs le droit de recevoir des enfants des deux sexes s'il existe dans la commune une école spéciale de filles. Malheureusement l'art. 15, par une combinaison ingénieuse avec l'art. 51, ouvrait la porte à une série de concessions et de tolérances qui détruisent en grande partie l'effet recherché par le législateur. Il fallait limiter à une période de temps déterminée ce droit de tolérance provisoire créé par l'art. 15, et, passé cette période, armer le législateur de tous les pouvoirs nécessaires pour contraindre les communes les plus récalcitrantes à la création d'écoles spéciales. De plus l'addition malheureuse des mots : « si ses propres ressources lui en fournissent les moyens » paralysait d'avance le mouvement qu'on entendait favoriser. Sur la plupart des autres points, la loi de 1850 imité les omissions regrettables de celle de 1833, ou détruit des portions utiles de cette loi. Le nom d'enseignement primaire supérieur n'est même pas prononcé dans la loi, et cet enseignement, si cher au législateur de 1833, n'a plus d'existence légale. Le privilège de la lettre d'obédience est confirmé et prend, avec une nouvelle vigueur, racine dans nos lois. Le Conseil départemental (art. 36, § 3) peut dispenser une commune d'entretenir une école publique à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement priment gratuit dans une école libre. Ce système des écoles libres tenant lieu d'écoles publiques fut surtout préjudiciable aux écoles de filles. Il favorisa la naissance ou la prolongation d'un état de choses bâtard, absolument contraire au but que devait se proposer le législateur, et qui consiste à pourvoir chaque commune d'une école publique. Ajoutez que l'inspection, dans cette catégorie d'écoles, ne s'exerçait que d'une manière incomplète (art. 21), en sorte que la commune et l'Etat semblaient abdiquer leur droit de contrôle dans un des cas où c'est un devoir sacré pour eux de l'exercer, c'est-à-dire quand il s'agit de ces élèves indigents dont les pouvoirs publics ont la tutelle. On ne fut pas long à reconnaître l'insuffisance de la loi de 1850, surtout pour les écoles de filles. En 1862, un projet de loi fut préparé par M. Rouland, ministre de l'instruction publique, et soumis aux délibérations du Conseil impérial de l'instruction publique dans sa séance du 18 décembre. Il visait spécialement les écoles de filles. Dans une note rédigée à l'appui, le ministre mettait le doigt sur une des parties les plus défectueuses de cette législation, qui exigeait de toute commune de 800 âmes au moins une école de filles, « mais seulement si ses propres ressources lui en fournissaient les moyens », ce qui équivalait, comme le fait remarquer le ministre, à détruire d'une main ce que la loi avait édifié de l'autre. La note ministérielle signale l'existence de près de 18 000 écoles mixtes (exactement 17 928). « Il faut reconnaître, disait-elle, qu'un instituteur ne peut initier les petites filles aux travaux à l'aiguille, qu'il est si désirable de leur rendre familiers, surtout dans les campagnes ; il ne peut enfin les former avec la délicatesse nécessaire à ces vertus spéciales aux femmes qui font les bonnes et saintes mères de famille. » D'autre part, parlant des écoles mixtes confiées à des institutrices, particulièrement à des institutrices congréganistes, munies d'une simple lettre d'obédience, elle fait ressortir ce que cette combinaison laisse à désirer pour l'éducation virile et professionnelle des jeunes garçons. En conséquence, le ministre proposait une loi en 9 articles, dont voici le texte : « ARTICLE PREMIER. — Toute commune de 500 âmes est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une commune voisine, d'entretenir une école communale de filles, sauf ce qui est dit à l'article 36 de la loi du 15 mars 1850. La réunion sera prononcée par le Conseil départemental, les conseils municipaux entendus. Le Conseil général pourra toutefois, le Conseil départemental entendu, dispenser de l'entretien d'une école spéciale de filles : « 1° Les communes dont la population est disséminée dans les petits hameaux éloignés du chef-lieu et dans lesquels l'école des filles ne pourrait réunir qu'un trop petit nombre d'enfants ; « 2° Celles qu'il reconnaîtrait ne pouvoir satisfaire aux prescriptions de l'article 6 de la présente loi. « ART. 2. — Les écoles communales de filles sont divisées en trois classes ; à chacune d'elles correspond un traitement fixe dont le minimum est déterminé ainsi qu'il suit : 1re classe…………………600 fr. 2e classe………………… 500 — 3e classe………………….400 — « ART. 3. — Le ministre de l'instruction publique et des cultes arrête tous les trois ans la classification des écoles communales de filles, sur la proposition des Conseils généraux, après avis des Conseils départementaux de l'instruction publique, les conseils municipaux entendus. « ART. 4. — Le traitement des institutrices communales est payé mensuellement par le receveur municipal. « ART. 5. — Il est pourvu au traitement des institutrices communales et au loyer des maisons d'école dont les communes ne sont pas propriétaires, au moyen : « 1° Des dons ou legs faits, ayant pour objet l'instruction primaire ; « 2° De la rétribution scolaire, dont le taux est fixé chaque année par les Conseils départementaux, sur la proposition des conseils municipaux, et qui est perçue pour le compte des communes ; « 3° D'un prélèvement voté par les conseils municipaux sur leurs revenus ordinaires ; « 4° Du restant libre des trois centimes spéciaux affectés aux dépenses de l'instruction primaire par la loi du 15 mars 1850. « ART. 6. — Lorsque les ressources ci-dessus énumérées ne suffisent pas pour équilibrer, dans les budgets municipaux, les recettes et les dépenses des écoles communales de filles, la moitié du déficit sera comblée au moyen d'une imposition spéciale votée par les conseils municipaux. « Il sera pourvu à l'autre moitié du déficit par les Conseils généraux, soit au moyen d'un restant disponible des deux centimes spéciaux qu'ils sont autorisés à voter par la loi du 15 mars 1850, soit au moyen d'une nouvelle imposition spéciale, qui ne pourra excéder deux centimes, au principal des quatre contributions directes, et, en cas d insuffisance de ces ressources, par le ministre de l'instruction publique sur le crédit qui sera annuellement porté à cet effet au budget de l'Etat. « ART. 7. — Il sera établi au moins une école normale d'institutrices par académie. « Les départements du ressort académique qui enverront des élèves-boursiers à l'école normale contribueront aux dépenses générales de l'établissement au prorata du nombre de leurs élèves, soit au moyen du restant disponible de leurs deux centimes spéciaux votés en exécution de l'article 40 de la loi du 15 mars 1830, soit à l'aide de leurs centimes facultatifs ou de l'imposition spéciale mentionnée au dernier paragraphe de l'article 6. « ART. 8. — A défaut de vote des conseils municipaux et des Conseils généraux, les impositions mentionnées aux articles précédents seront établies d'office par un décret impérial, sur la proposition, du ministre de l'instruction publique et des cultes, conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1850. « ART. 9. — Les écoles mixtes établies ou à établir dans les communes de 200 à 500 âmes continueront d'être dirigées par des instituteurs. « Les écoles mixtes établies ou à établir dans les communes dont la population ne dépasse pas 200 âmes pourront être confiées à des institutrices, lesquelles seront rétribuées conformément aux dispositions ci-dessus. « Toutefois, le ministre de l'instruction publique pourra suivant les circonstances, sur l'avis des Conseils départementaux, autoriser la direction de l'école mixte par une institutrice dans les communes dont la population est au-dessus de 200 âmes et au-dessous de 500. » Après le texte du projet de loi, voici le commentaire extrait de la note précitée : « Par son article 1", le projet impose à toute commune de 500 âmes d'avoir une école de filles ; mais loin de s'en rapporter comme la loi de 1850 à la générosité des conseils municipaux, il fixe par son article 2 le traitement minimum qui doit être affecté à chaque institutrice ; il indique par les articles 5 et 6 les sources auxquelles il y aura lieu de puiser pour l'entretien de ces écoles. Il assure d'abord à l'institutrice un minimum de traitement fixe qui lui sera régulièrement payé tous les mois, et qui pourra s'élever si, l'école prospérant sous sa direction, le Conseil général juge convenable de la faire passer dans une classe supérieure. « L'article 7 du projet exige l'établissement d'une école normale d'institutrices par académie. Il y a en ce moment 10 écoles normales primaires (de filles), et 42 cours normaux, c'est-à-dire 42 maisons d'éducation particulières dans lesquelles le département et l'Etat paient la pension d'un certain nombre de jeunes filles qui se destinent à l'enseignement. « En augmentant le nombre des écoles de filles, il importe de pourvoir au recrutement de ces écoles. « Le projet de loi, en laissant subsister quelques écoles mixtes, s'efforce d'en atténuer les inconvénients par l'introduction d'une surveillante, et il y a lieu d'espérer que les précautions qu'il ordonne à ce sujet obtiendront l'assentiment du Conseil impérial. » Quelles influences firent échouer ce projet, remarquable pour son époque? Nous l'ignorons, mais cinq années furent perdues pour l'amélioration de l'instruction populaire des filles. Le successeur de Rouland, Victor Duruy, n'allait pas tarder à reprendre en mains la même cause. Une enquête publiée en 1866 a constaté l'état des écoles après quatorze ans de fonctionnement de la loi de 1850. Prenons quelques départements au hasard ; celui du Nord, le plus riche de France après celui de la Seine, comptait 33 communes de plus de 800 habitants dépourvues d'écoles de filles. La Seine-Inférieure, qui vient après dans l'ordre de la richesse, comptait 11 communes sans écoles, et 20 communes de 800 habitants dépourvues d'écoles publiques de filles. A une autre extrémité de la France, la Dordogne présentait 50 communes, comprenant 17 000 habitants, encore dépourvues d'écoles ; 83 communes de 800 âmes et au-dessus, comprenant 90 000 habitants, n'avaient pas satisfait à l'obligation de créer une école spéciale de filles. Et l'inspecteur d'académie de la Dordogne, qui signalait ces résultats, en donnait la raison en des termes qui sont d'une remarquable précision : « Les causes de cette situation sont : 1° En général, indifférence des familles pour l'instruction primaire et spécialement pour l'instruction des filles ; 2° calculs intéressés : on recule devant une dépense qui incombe tout entière à la commune pour le local et le traitement, puisque les centimes spéciaux sont généralement absorbes par l'entretien des écoles de garçons ; 3° lacune dans la loi, qui s'en remet aux communes du soin de créer une école, si leurs ressources le leur permettent, qui laisse l'autorité sans action en présence du peu de zèle des populations, qui n'a rien fait pour organiser les écoles de filles, comme elle a organisé celle des garçons. » Comme nombre de ses collègues, l'inspecteur de la Dordogne eût pu ajouter deux traits au tableau : l'évincement dans tous les postes importants de l'élément laïque par l'élément congréganiste ; l'abaissement du niveau des études, conséquence fatale de la lettre d'obédience. La loi du 10 avril 1867 eut pour but de remédier au mal constaté par l'enquête. On peut dire que chacune des dispositions de cette loi s'appuie sur des voeux exprimés avec ensemble et autorité par la majorité des inspecteurs d'académie, préalablement consultés. Le ministre intelligent et patriote qui, dès cette époque, voulait doter son pays de l'instruction obligatoire, peut être considéré comme le premier promoteur d'un sérieux progrès dans les écoles de filles. Voici les dispositions principales de cette loi, relativement au sujet dont nous nous occupons : « ARTICLE PREMIER. — Toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le Conseil départemental en vertu de l'article 15 de la loi du 15 mars 1850. » Il faut regretter ce rappel d'une disposition déjà critiquée de la loi de 1850. On eût dû limiter à un nombre convenable d'années le régime de dispense et de tolérance. « Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet après avis du Conseil départemental. » Disposition excellente et pratique qui assurait aux filles, dans toutes les écoles, une suffisante éducation manuelle, et corrigeait l'une des défectuosités le plus souvent signalées des écoles mixtes. « ART. 2. — … Le Conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché une institutrice adjointe. » La loi de 1850 n'avait rien disposé quant aux institutrices adjointes : la loi du 10 avril 1867 leur donne pour la première fois une existence légale. Mais elle n'eut pas le soin de fixer avec précision le nombre maximum d'élèves à partir duquel une création d'emploi d'adjointe était nécessaire, et l'article 2 ne donna pas tous ses fruits. « ART. 16. — Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire. » Cette mesure réparatrice fit croître l'enseignement primaire en valeur morale et en dignité civique. Elle renoua la tradition interrompue depuis les derniers décrets de la Convention. Elle fut applicable dans les écoles des deux sexes. Telles sont les dispositions spécialement applicables aux écoles de filles de cette loi de 1867 qui marque une époque dans l'histoire de notre enseignement primaire. 2° Enseignement primaire supérieur. Il ne faut pas remonter au delà de la législation de 1833 pour trouver l'origine d'un enseignement primaire supérieur dans les écoles de filles. La Convention y avait renoncé. L'Empire ne s'en occupa point ; quant à la Restauration, elle confina les institutrices ans les limites d'un programme d'examen moins étendu que celui des instituteurs. Toutefois la force des choses et les besoins des familles, surtout dans les grandes villes, firent naître des institutions et des pensions destinées à donner aux jeunes filles une instruction supérieure à celle que dispense l'école primaire. Une instruction ministérielle du 19 juin 1820 plaça ces établissements sous la surveillance des préfets, et astreignit les maîtresses et les sous-maîtresses à des examens spéciaux. La lecture du programme imposé montre combien l'administration à cette époque exigeait peu des personnes chargées de la direction ou de l'enseignement dans ces écoles dites « du degré supérieur ». Le voici : « Les connaissances exigées des personnes qui se présenteront pour obtenir le diplôme de maîtresse de pension seront les principes de la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française et l'arithmétique. « Les personnes qui voudraient être sous-maîtresses devront savoir lire et écrire correctement, et justifier qu'elles sont en état de montrer au moins l'une des parties de l'enseignement dont suit l'énoncé : les principes de la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française, l'arithmétique, l'histoire ancienne et moderne et la géographie. » Le privilège de la lettre d'obédience tenant lieu de brevet était accordé aux institutrices congréganistes dirigeant des écoles du degré supérieur, non toutefois sans une restriction qui est à noter : « Si, dans quelques cas particuliers, le préfet voit des inconvénients à leur confier l'éducation des jeunes filles, il devra en référer au ministre qui décidera si le diplôme doit ou ne doit pas être délivré. » L'un des caractères les plus remarquables de la loi du 28 juin 1833 avait été sa sollicitude pour l'enseignement primaire supérieur. Non seulement l'article 1er en consacrait l'existence et en fixait le programme, mais il lui ouvrait une voie de progrès constant par l'addition de ce paragraphe : « Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables ». L'ordonnance du 23 juin 1836 appliqua aux écoles de filles les dispositions principales de la loi de 1833 relatives à l'enseignement primaire supérieur. Elle dit : « ARTICLE PREMIER. — L'instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure. « L'instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues d'arithmétique et de langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général, et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France. » On remarquera que ce programme est notablement moins riche que celui des écoles primaires supérieures de garçons. Il y manque « la géométrie et ses applications usuelles, ainsi que les notions de sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie ». Il est vrai que ces lacunes peuvent, à la rigueur, être comblées en vertu de l'article 3 qui déclare que, avec l'assentiment des autorités compétentes, « l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables selon les besoins et les ressources des localités ». Un brevet de capacité pour l'enseignement primaire supérieur fut institué pour les institutrices, et les directrices appartenant aux congrégations ne purent diriger une école du degré supérieur sans justifier de la possession de ce diplôme (articles 5 et 14). Les droits conférés par la lettre d'obédience se trouvaient ainsi limités aux écoles élémentaires. Un arrêté du 28 juin suivant fixa le programme d'examen : « ARTICLE PREMIER. — . Pour le brevet de capacité du degré supérieur : « 1° Tout ce qui est compris dans le programme pour le brevet du degré élémentaire ; « 2° Exposition de la doctrine chrétienne ; « 3° Notions plus étendues d'arithmétique, de langue et de littérature françaises ; « 4° Eléments de l'histoire et de la géographie en général, et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France. « ART. 2. — Si la postulante se propose d'enseigner une langue vivante ou la musique instrumentale, ou de donner des notions élémentaires de physique, d'histoire naturelle ou de cosmographie, elle sera aussi interrogée sur ces divers points, et il sera fait mention particulière de celle partie de l'examen dans le certificat d'aptitude qui lui sera délivré. » Ainsi les notions des sciences reprenaient, par cette voie détournée, droit de cité dans l'enseignement supérieur des filles : on leur entrebâillait la porte après l'avoir précédemment fermée. Ce n'est pas dans ces conditions qu'elles auraient dû y figurer. Le dommage commis envers elles par l'ordonnance du 2.3 juin 1836 n'était qu'incomplètement réparé. En effet, un programme n'est pas fait seulement en vue des examens et pour servir de base à l'obtention d'un diplôme ; il doit servir de règle et de niveau pour les études, et à ce titre les indications qu'il fournit sont doublement précieuses. On reprochera donc à l'article 2 de l'arrêté de ne pas encourager suffisamment les études scientifiques dans les écoles de filles, et d'en abandonner le sort à l'initiative des maîtresses, au lieu d'en imposer l'usage et d'en régler l'emploi. L'article 3 donnait à l'examen une valeur pédagogique des plus sérieuses : outre la composition écrite que chaque postulante devait rédiger sur n sujet donné, elle devait « faire une leçon orale d'une demi-heure sur une des parties du programme correspondant au degré du brevet qu'elle voudra obtenir ». La Révolution de 1848 et la loi du 15 mars 1850 ne laissèrent pas à la législation de 1836 sur l'enseignement primaire supérieur des filles le temps de porter ses fruits. Nous avons vu déjà que la loi de 1850 supprimait systématiquement le nom d'instruction primaire supérieure. Elle inscrivit au programme, à titre de matières facultatives : l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ; les éléments de l'histoire et de la géographie ; des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ; des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ; l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ; le chant et la gymnastique (art. 23). Certes, il y avait là matière à un enseignement étendu et fructueux. Mais l'esprit de la loi était peu favorable à la diffusion de l'instruction. Loin de prendre en main la direction de l'enseignement primaire supérieur pour lui donner une vigoureuse impulsion, l'Etat se désintéressait de la question. On abandonnait aux communes l'initiative du progrès, sous la réserve d'une autorisation donnée par le Conseil départemental. 3° Enseignement secondaire. « L'Etat, disait Ernest Legouvé il y a déjà bien des années, paie une université pour les hommes, des cours de faculté pour les hommes, une Ecole polytechnique pour les hommes, des écoles des arts et métiers pour les hommes. Et pour les femmes, qu'a-t-il fondé? Des écoles primaires. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi n'existe-t-il pas un enseignement secondaire pour les femmes? Pourquoi les jeunes filles des classes moyennes et des classes élevées n'ont-elles pas droit à la même sollicitude que les jeunes filles ouvrières? Il faut des lycées d'externes pour les jeunes filles, comme il y a des lycées pour les garçons. » Des lycées pour les filles? La pensée n'était pas nouvelle. Napoléon l'avait réalisée à Ecouen, et il avait même dépassé la conception de Legouvé, puisque la maison d'Ecouen était un internat. Mais il avait limité sa sollicitude aux filles de ses légionnaires. De plus, Ecouen, constitué d'après les vues personnelles de l'empereur, n'entrait que le moins possible dans le domaine de la haute éducation intellectuelle. On en jugera par la reproduction du document ci-dessous, où Napoléon expose le programme d'études qu'il a conçu pour cet établissement : « Qu'apprendra-t-on aux demoiselles qui seront élevées à Ecouen? Il faut commencer par la religion dans toute sa sévérité. N'admettez à cet égard aucune modification. La religion est une importante affaire dans une institution publique de demoiselles. Elle est, quoi qu'on en puisse dire, le plus sûr garant pour les mères et les maris. Elevez-nous des croyantes et non des raisonneuses. La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destination dans l'ordre social, la nécessité d'une constante et perpétuelle résignation et d'une sorte de charité indulgente et facile, tout cela ne peut s'obtenir que par la religion, par une religion charitable et douce. Je n'ai attaché qu'une importance médiocre aux institutions religieuses de Fontainebleau, et je n'ai prescrit que tout juste ce qu'il fallait pour les lycées. C'est tout le contraire pour l'institution d'Ecouen. Presque toute la science qui y sera enseignée doit être celle de l'Evangile. Je désire qu'il en sorte non des femmes très agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de moeurs et de coeur, non d'esprit et d'amusement. Il faut donc qu'il y ait à Ecouen un directeur, homme d'esprit, d'âge et de bonnes moeurs, que les élèves fassent chaque jour des prières régulières, entendent la messe et reçoivent des leçons sur le catéchisme. Cette partie de l'éducation est celle qui doit être la plus soignée. « Il faut ensuite apprendre aux élèves à chiffrer, à écrire et les principes de leur langue, afin qu'elles sachent l'orthographe. Il faut leur apprendre un peu de géographie et d'histoire, mais bien se garder de leur montrer le latin ni aucune langue étrangère. On peut enseigner aux plus âgées un peu de botanique et leur faire un léger cours de physique ou d'histoire naturelle, et encore tout cela peut-il avoir des inconvénients. Il faut se borner en physique à ce qui est nécessaire pour prévenir une crasse ignorance et une stupide superstition, et s'en tenir aux faits, sans raisonnements qui tiennent directement ou indirectement aux causes premières. « On examinera s'il conviendrait de donner à celles qui sont parvenues à une certaine classe une masse pour leur habillement. Elles pourraient s'accoutumer à l'économie, à calculer la valeur des choses et à compter avec elles-mêmes. « Mais, en général, il faut les occuper toutes, pendant les trois quarts de la journée, à des ouvrages manuels ; elles doivent savoir faire des bas, des chemises, des broderies, enfin toute espèce d'ouvrages de femme. « On doit considérer ces jeunes filles comme si elles appartenaient à des familles qui ont dans nos provinces de quinze à dix-huit cents livres de rente, et ne devant apporter de dot à leurs maris pas plus de douze ou quinze mille francs, et les traiter en conséquence. On conçoit dès lors que le travail manuel dans le ménage ne doit pas être indifférent. « Je ne sais pas s'il y a possibilité de leur montrer un peu de médecine et de pharmacie, du moins de cette espèce de médecine qui est du ressort d'une garde-malade. Il serait bon aussi qu'elles sussent un peu de cette partie de la cuisine qu'on appelle l'office. Je voudrais qu'une jeune fille, sortant d'Ecouen pour se trouver à la tête d'un petit ménage, sût tailler ses robes, raccommoder les vêtements de son mari, faire la layette de ses enfants, procurer des douceurs à sa petite famille au moyen de la partie d'office d'un ménage de province, soigner son mari et ses enfants lorsqu'ils sont malades et savoir à cet égard, parce qu'on le lui aurait inculqué de bonne heure, ce que les garde-malades ont appris par l'habitude. Tout cela est si simple et si trivial que cela ne demande pas beaucoup de réflexion. « Quant à l'habillement, il doit être uniforme. Il faut choisir des matières très communes et leur donner une forme agréable. Je crois que, sous ce rapport, l'habillement actuel des femmes ne laisse rien à désirer. Bien entendu, cependant, qu'on couvrira les bras et qu'on adoptera les modifications qui conviennent à la pudeur et à la santé. « Quant à la nourriture, elle ne saurait être trop simple : de la soupe, du bouilli et une petite entrée, il ne faut rien de plus. « Je n'oserais pas, comme à Fontainebleau, prescrire de faire faire la cuisine aux élèves : j'aurais trop de monde contre moi ; mais on peut leur faire préparer leur dessert et ce qu'on voudrait leur donner, soit pour leur goûter, soit pour les jours de récréation. Je les dispense de la cuisine, mais non pas de faire elles-mêmes leur pain. L'avantage de tout cela est qu'on les exerce à tout ce qu'elles peuvent être appelées à faire et qu'on trouve l'emploi naturel de leur temps en choses solides et utiles. « Si l'on me dit que l'établissement ne jouira pas d'une grande vogue, je réponds que c'est ce que je désire, parce que mon opinion est que, de toutes les éducations, la meilleure est celle des mères, parce que mon intention est principalement de venir au secours de celles des jeunes filles qui ont perdu leur mère et dont les parents sont pauvres ; qu'enfin, si les membres de la Légion d'honneur qui sont riches dédaignent de mettre leurs filles à Ecouen, si ceux qui sont pauvres désirent qu'elles y soient reçues, et si ces jeunes personnes, retournant dans leurs provinces, y jouissent de la réputation de bonnes femmes, j'ai complètement atteint mon but, et je suis assuré que l'établissement arrivera à la plus solide, à la plus haute réputation. « Il faut dans cette matière aller jusqu'auprès du ridicule. Je n'élève ni des marchandes de modes, ni des femmes de chambre, ni des femmes de charge, mais des femmes pour les ménages modestes et pauvres. La mère, dans un ménage pauvre, est la femme de charge de la maison. » Donc l'Empire n'a rien organisé de général pour l'enseignement secondaire des filles. Les gouvernements qui suivirent ne firent guère plus. On dut à l'initiative privée des cours professés avec élévation et talent par des maîtres de l'Université ; ces cours firent la fortune de quelques établissements particuliers sans profiter au pays tout entier. Créés seulement dans les grandes villes, ils n'eurent d'influence que sur quelques familles. Les classes moyennes et les classes élevées restèrent, en ce qui concerne les filles, dépourvues d'une éducation digne d'elles et de la nation. Les conséquences, tout le monde les connaît ; elles furent exposées avec autant de sagacité que d'éloquence par Jules Simon, devant le Corps législatif, en 1867 : « Les filles, même dans les pensionnats les plus élevés, reçoivent une instruction futile, incomplète, toute d'arts d'agrément, mais sans rien de sérieux et d'élevé. Elles que la nature a douées d'une intelligence si ouverte, d'un tact si sûr, d'une sensibilité si fine et si délicate ; qui sont faites pour comprendre ce qu'il y a de plus grand dans les lettres et pour s'y plaire, qui seraient pour nous des compagnes d'études si utiles et si charmantes, nous les réduisons à n'être que des idoles parées. « Nous ne poussons pas à faire des femmes des révolutionnaires, nous voulons en faire les compagnes intellectuelles de leurs maris. Il n'est personne qui puisse nier que l'instruction qu'on leur donne aujourd'hui ne les prépare pas à ce rôle. Un des grands malheurs de la société actuelle, c'est la séparation de plus en plus considérable qui s'établit entre l'homme et la femme, l'homme allant dans les clubs, se livrant aux exercices du sport, se déshabituant de la vie d'intérieur, et la femme réduite à vivre avec d'autres femmes, loin du coeur et de l'esprit de son mari. » Ces paroles, que l'orateur de l'opposition faisait applaudir du Corps législatif tout entier, ne furent pas perdues pour le ministre de l'instruction publique qui soutenait en ce même moment le projet devenu la loi du 10 avril 1867. Dés le 30 octobre suivant, une circulaire aux recteurs posait nettement la question de l'enseignement secondaire des filles, et présentait un plan d'organisation pour la France entière : « Il reste une chose considérable à faire, disait le ministre : il faudrait fonder l'enseignement secondaire des filles qui, à vrai dire, n'existe pas en France… « Que de plaintes ne s'élèvent pas sur la nécessité de donner aux jeunes filles une instruction en rapport avec le rang qu'elles occuperont un jour dans la société, et avec celle que reçoivent leurs frères dans les écoles de l'Etat et dans les établissements libres ! Les choses en sont venues à ce point que les élèves-maîtresses des écoles normales, destinées pour la plupart à enseigner dans les campagnes, ont une instruction plus complète que beaucoup de jeunes filles auxquelles la naissance et la fortune assigneront une place dans la société la plus éclairée : le simple brevet de capacité pour l'instruction primaire est devenu la preuve d'une éducation soignée ; les jeunes filles le recherchent dans les familles les plus soucieuses de l'instruction, sans autre but que de constater qu'elles se sont élevées au-dessus du niveau de l'ignorance générale., . « Le besoin d'un enseignement plus élevé est si généralement reconnu, l'organisation que j'ai en vue est si simple, si peu coûteuse et peut donner de tels résultats que je n'hésite pas à vous charger d'en préparer le succès. « L'enseignement secondaire des filles est et ne peut être que l'enseignement spécial qui vient d'être constitué pour les garçons par la loi du 21 juin 1865 et d'où les langues mortes sont exclues. « Cet enseignement, caractérisé par la combinaison d'une instruction littéraire générale, de l'étude des langues vivantes et du dessin, avec la démonstration pratique des vérités scientifiques, peut, en effet, s'il est convenablement approprié à sa destination nouvelle, devenir l'enseignement classique des jeunes filles de quatorze à dix-sept ou dix-huit ans. « Les méthodes, les programmes employés pour les uns seront facilement utilisés pour les autres. Il n'y a rien à créer, tout existe ; il s'agit seulement d'en faire l'application aux études des jeunes filles avec les différences que comportent leurs conditions et leurs besoins. « Ainsi l'enseignement secondaire des filles formerait un ensemble régulier, divisé en trois ou quatre années, chacune de six ou sept mois d'études, avec une ou deux leçons par jour, des devoirs remis par les élèves, corrigés par les maîtres, et des compositions mensuelles. « On ne passerait d'un cours à l'autre qu'après un examen sérieux. « Le cours complet aurait pour sanction et pour couronnement la délivrance, par le jury départemental académique, des diplômes que la loi du 21 juin 1865 a institués. « Les programmes seraient arrêtés et la surveillance des cours serait faite par les membres du conseil de perfectionnement que la loi du 21 juin 1865 a créé, et dont le maire a, dans chaque ville, la présidence. Enfin, les cours ne seraient point publics ; mais la jeune fille y serait conduite par sa mère, sa gouvernante ou sa maîtresse de pension, qui assisteraient aux leçons. « Ces cours, s'adressant aux familles aisées ou riches, seraient nécessairement payants : 15 ou 20 francs par mois. « De la somme ainsi trouvée, il serait fait deux parts : les deux tiers ou les trois quarts formeraient la rémunération des professeurs ; le reste serait mis en réserve pour former un fonds qui servirait aux dépenses du matériel et à la création de bourses d'externat en faveur des jeunes filles pauvres qui montreraient une vocation décidée pour les hautes études et pourraient se préparer dans ces cours à donner elles-mêmes un jour l'enseignement secondaire. « Le local serait dans une salle de l'hôtel de ville ou de quelque édifice communal, car cet enseignement devrait être établi sous le patronage, le contrôle et la direction des autorités municipales, c'est-à-dire de ceux qui sont les représentants légaux de tous les pères de famille de la cité. « Quant aux maîtres et aux moyens d'enseignement, ils sont tout prêts. Les membres de l'enseignement secondaire, qui ont déjà la confiance des familles, puisque soixante-dix mille enfants leur sont confiés dans les lycées et les collèges, peut-être même quelques membres des facultés, n'hésiteraient pas à prêter leur concours, s'il était réclamé, et, dans ce cas, je les autoriserais à employer pour ces cours extérieurs tout le matériel scientifique du lycée. « Vous voyez, monsieur le recteur, qu'il n'y aurait besoin, pour cette oeuvre considérable, ni de bâtir de nombreuses maisons, ni de créer un nouveau personnel, ni de constituer à grands frais un matériel scientifique ; il suffirait d'appliquer le principe qui a si bien réussi pour les cours d'adultes : le matériel et le personnel de l'enseignement secondaire seraient utilisés deux fois ; frères et soeurs auraient les mêmes maîtres. « En tout ceci, monsieur le recteur, nous n'avons rien à entreprendre par nous-mêmes. C'est une oeuvre de persuasion à poursuivre auprès des autorités municipales et des familles Qu'elles le veuillent, et dans quelques semaines, sans dépenses ni de l'Etat, ni du département, ni de la commune, l'enseignement supérieur des filles sera fondé dans les quatre-vingts villes qui ont un lycée et dans les deux cent soixante qui possèdent un collège : nos trois mille professeurs sont tout prêts. » Certes, ces vues étaient grandes quant au principe, ingénieuses quant à l'application. Créer d'un trait de plume un vaste réseau de cours, avec des programmes tout prêts, approuvés par les conseils de l'Université, avec un personnel aussi compétent que dévoué, avec des locaux, et sans qu'il en coûtât un denier au budget de l'Etat, c'était un coup de maître. Le succès répondit d'abord aux voeux du ministre. Vingt-quatre cours s'organisèrent dès l'année 1867, dont plusieurs dans la ville de Paris. De ces derniers le plus important, celui qui peut servir de type, prit le nom d'Association pour renseignement secondaire des filles et reçut du ministre la jouissance d'une salle de cours à la Sorbonne. Parmi les noms des membres fondateurs figuraient ceux de Milne-Edwards, membre de l'Institut, professeur à la faculté des sciences et au Muséum ; Paul Albert, professeur de rhétorique au lycée Charlemagne ; Paul Bert, professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle ; Gaston Boissier, maître de conférences à l'Ecole normale et professeur au Collège de France ; Levasseur, professeur au lycée Napoléon ; Salicis, répétiteur à l'Ecole polytechnique ; Viollet-le-Duc, inspecteur général des monuments historiques ; Wurtz, membre de l'Institut ; Mme Pape-Carpantier, directrice du Cours normal des salles d'asile, etc. Un programme d'études fut arrêté. Il embrassait trois années et comprenait la littérature, l'histoire, la géographie, l'économie domestique, les éléments du droit usuel, les sciences naturelles et physiques et certaines notions des sciences mathématiques, le dessin ; quant aux langues vivantes et à la musique, l'Association annonçait qu'elle en remettait l'enseignement aux soins des familles. Les cours de chaque année avaient une durée de six mois (du 1er décembre au 31 mai). Un cours de lettres et un cours de sciences se succédaient immédiatement pour épargner aux élèves des déplacements trop réitérés. Des devoirs, des compositions, des examens étaient prescrits, avec un caractère seulement facultatif. Le diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire spécial devait servir de sanction aux trois années de cours. La rétribution à payer par les familles était de 75 francs par trimestre. Les mères, parentes ou institutrices étaient admises à raison d'une personne pour chaque jeune fille inscrite. Il est resté de cet enseignement plus d'une trace durable, non seulement dans la mémoire de celles qui l'ont suivi, mais dans l'ordre des productions scientifiques et littéraires. Un recueil spécial se fonda sous le titre d'Echo de la Sorbonne et publia les leçons les plus remarquables, lesquelles, recueillies plus tard en volumes, formèrent le noyau d'une bibliothèque à l'usage de l'instruction secondaire des jeunes filles. L'enseignement secondaire des filles était donc inauguré en pleine Sorbonne et d'une manière digne de lui. Interrompu par la guerre de 1870, il devait reprendre avec une vigueur nouvelle au lendemain de nos désastres. Malheureusement les cours de province ne rencontraient pas semblable fortune : 24 cours fondés en 1867, 10 en 1868, 3 en 1869, 1 en 1870, soit en tout 38 cours, se réduisaient à 5 en 1879, et, si l'on ajoute 9 créations survenues de 1870 à 1879, l'effectif arrive à 14 unités. L'oeuvre n'avait pas répondu aux premières espérances qu'elle avait fait naître. C'était sans doute une illusion généreuse de penser qu'une organisation aussi complexe pourrait se soutenir sans dotation au budget, sans personnel spécial, sans locaux appropriés, sans plan d'ensemble, sans sanction législative. Ajoutons que l'esprit public n'était pas préparé et qu'il hésitait entre des sympathies naturelles et des défiances suggérées. [HIPPOLYTE DURAND. Avec suppressions et additions.] DEUXIEME PARTIE. — De 1870 à nos jours. Enseignement normal. Enseignement primaire élémentaire. Comme on l'a vu plus haut, l'enseignement des filles reçut, par la loi du 10 avril 1867, un commencement d'organisation : cette loi augmenta le nombre des écoles spéciales, améliora en quelque façon la situation des institutrices, et élargit les programmes. Par malheur, rien ne fut fait pour assurer un recrutement meilleur du personnel enseignant féminin : dans les écoles publiques de filles foisonnaient toujours des congréganistes, munies de la simple lettre d'obédience, ne présentant par conséquent que des garanties insuffisantes de capacité. En 1870, il n'y avait encore que dix-neuf écoles normales d'institutrices. Dans la plupart des départements, la préparation des futures maîtresses se faisait dans ce qu'on appelait les « cours normaux », cours organisés auprès de certaines écoles de filles, congréganistes en général, et où l'enseignement était faible et la préparation professionnelle médiocre, souvent nulle. Pour indirecte que soit l'action des femmes dans la vie politique, elle n'en est pas moins réelle, et elles ont une influence sociale plus grande encore. Le gouvernement de la troisième République, qui s'était donné pour tâche de restaurer et de promouvoir l'instruction publique en France, comprit donc qu'il ne pouvait se désintéresser de l'éducation des filles et qu'elle n'était pas la partie la moins importante de l'oeuvre entreprise. Dès l'abord on vit aussi avec justesse qu'en cette affaire rien n'était plus urgent et plus essentiel que de constituer un personnel de maîtresses qui fussent vraiment dignes de ce nom. C'est la préoccupation qui se marqua dans la loi du 16 juin 1881 qui abolit la lettre d'obédience, et imposa la possession du brevet de capacité non seulement aux directrices d'école, mais aux adjointes, et pour les écoles composées de plusieurs classes exigea de la directrice un titre de capacité supérieur. Dans cette voie, d'ailleurs, un pas décisif était déjà fait : par la loi du 9 août 1879, tous les départements avaient été mis dans l'obligation d'avoir, dans un délai déterminé, une école normale d'institutrices : le recrutement, recrutement large et permanent, des maîtresses laïques était ainsi assuré désormais. Après n'avoir eu si longtemps qu'une existence précaire, qu'une direction incertaine, l'enseignement normal des femmes, enfin véritablement fondé, reçut son organisation par l'arrêté du 3 août 1881 qui réglait l'emploi du temps, la répartition des matières d'enseignement et les programmes d'études. Pour composer ces programmes, on partit de ce principe que les institutrices devaient être aussi cultivées et aussi instruites que les instituteurs. Mais, tout en jugeant bon qu'élèves-maîtres et élèves-maîtresses eussent une instruction équivalente, on crut aussi qu'il convenait qu'elle ne fût pas identique. Point de différence, il est vrai, pour toute la partie littéraire (instruction morale et civique, pédagogie et administration scolaire, langues et éléments de littérature française, langues vivantes, histoire et géographie ) ; mais, si les programmes scientifiques comportent les mêmes matières, ils sont, pour les élèves-maîtresses, réduits dans leurs développements ; de même, pour l'enseignement du dessin, on ne relient de scientifique que ce qui est nécessaire pour l'intelligence des principes et des règles, et, le dessin d'ornement prend le pas sur le dessin géométrique, utile surtout pour les hommes. En outre, il y a dans l'arrêté du 3 août 1881 toute une partie qui vise l'éducation appropriée à des femmes. Les élèves-maîtresses reçoivent des notions d'économie domestique. Leurs travaux manuels consistent en travaux de couture, coupe et assemblage. Elles doivent, au jardin, apprendre à exécuter les principales opérations de la culture maraîchère, celles qui se font dans un jardin ordinaire bien tenu, où l'on trouve en abondance des légumes varies, des fruits et des fleurs. Elles sont initiées aussi aux premiers soins à donner en cas d'accident. Ou se proposait, en un mot, « de faire des élèves-maîtresses des jeunes filles instruites, autant qu'il en est besoin, dans les sciences et dans les lettres, mais instruites en même temps des choses de la vie, de la tenue d'un ménage, d'un jardin, d'une basse-cour, de la comptabilité domestique, de la préparation des aliments, de tout ce qui contribue à l'ordre et à l'embellissement, à l'économie et à la prospérité d'une maison. » (Instructions officielles de 1881.) Ce n'est pas la faute de ce programme, excellent dans son esprit général et dans le détail de ses dispositions, si l'enseignement des écoles normales prit insensiblement un caractère trop général, trop abstrait, trop formel. Lorsqu'on s'aperçut de cette fausse orientation, on pensa qu'il fallait en chercher la cause dans le l'ait que normaliens et normaliennes se préoccupaient trop de préparer l'examen du brevet supérieur qu'ils devaient subir à la fin de la troisième année d'études. De là, la réforme opérée par le décret du 4 août 1905 qui place l'examen du brevet supérieur à la fin de la seconde année et qui consacre ta troisième année tout entière à la préparation professionnelle et pratique. De là les retouches apportées en même temps aux programmes de 1881. Il n'y est pas fait de changement essentiel, mais tous les remaniements ont pour objet de marquer que l'enseignement doit avoir surtout un caractère réaliste. C'est ainsi que, dans les programmes spéciaux aux écoles normales d'institutrices, on a augmenté le nombre des heures attribuées à ce qui a trait à l'éducation proprement féminine. « Le programme des écoles normales d'institutrices, disent les instructions officielles, tout en restant, dans ses grandes lignes, le même que celui des écoles normales d'instituteurs, doit s'adapter particulièrement à l'éducation féminine et au rôle social de l'institutrice. C'est pourquoi il a paru nécessaire de donner, dans ces écoles, une place importante à l'économie domestique, à l'hygiène et aux travaux du ménage. » Nous voyons, en effet, que le cours d'économie domestique en troisième année ne comporte pas moins de 30 leçons, et il est recommandé au professeur de ne pas donner cet enseignement ex-cathedra, mais de s'efforcer plutôt de fournir des indications précises, classées méthodiquement, et qui puissent servir aux applications ménagères. L'enseignement de l'hygiène comporte une partie nouvelle : la puériculture ; il lui est attribué une heure par semaine. Trois heures par semaine sont réservées à la couture et au raccommodage, deux heures à la cuisine, deux heures au savonnage et repassage, deux heures au nettoyage et entretien des meubles, ustensiles et vêtements, deux heures au jardinage. Dans quelques écoles normales de filles, on a même spécialisé la préparation pratique de façon à l'adapter aux besoins industriels de la région où elles sont situées : dès 1904 (décret du 4 janvier), l'enseignement de la dentelle a été organisé dans les écoles normales d'institutrices du Puy, de Caen et d'Alençon. Au lendemain de la loi du 9 août 1879 avait été fondée l'Ecole de Fontenay-aux-Roses (novembre 1880). Elle devait remplir pour les écoles normales d'institutrices le même office que l'Ecole normale de la rue d'Ulm remplissait pour les lycées et collèges de garçons, c'est-à-dire préparer des professeurs et des directrices pour ces écoles. Un inspecteur général, Félix Pécaut, fut chargé d'organiser les études, tandis qu'une directrice, Mme de Friedberg, avait pour mission de veiller à tout ce qui regardait le service intérieur. L'Ecole de Fontenay-aux-Roses se recrute par un concours entre aspirantes âgées de dix-neuf ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, munies du brevet supérieur, ou du diplôme de bachelier, ou du certificat d'études secondaires. Elles sont réparties en deux sections, celle des sciences et celle des lettres, qui poursuivent des études distinctes, mais qui ont en commun certains cours de littérature, de psychologie, de morale, de pédagogie, de langues vivantes, de musique vocale. La durée des études est fixée à trois ans. — Le concours d'admission porte sur les matières enseignées dans les écoles normales primaires. C'est donc le même programme que celui du brevet supérieur ; mais, « au lieu de vérifier seulement, comme on le fait à l'examen du brevet, si le candidat possède la moyenne requise d'instruction générale, on recherche chez les aspirantes des qualités et des habitudes d'intelligence qui permettent de bien augurer de leur vocation pédagogique ». — L'enseignement est donné par des professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur (lycées de Paris, Sorbonne, Muséum), qui viennent, les uns toute l'année, les autres quelques mois seulement, quelques-uns trois, quatre, cinq fois par an, donner des leçons ou des conférences. Ainsi organisée, l'Ecole de Fontenay-aux-Roses a eu sur l'enseignement normal féminin la plus heureuse influence, due surtout à l'action singulière exercée par Félix Pécaut sur les générations de jeunes filles qui, dans l'espace de seize années (1880-1896), passèrent sous sa direction. « Ancien pasteur et ancien publiciste, dit Henri Marion, pénétré à la fois d'un idéal pédagogique tout libéral et tout moderne et d'un sentiment tout religieux de sa tâche, on ne dut pas seulement à l'ascendant de son caractère et à sa force de persuasion, le ton qu'il sut donner à cette grande école, faisant par elle rayonner au loin le plus pur zèle et la plus haute idée de l'éducation ; on lui dut aussi et surtout le choix souvent renouvelé, toujours heureux, des collaborateurs les plus propres à entretenir la flamme. » Lorsque Félix Pécaut mourut, il fut remplacé par Jules Steeg, qu'une mort soudaine emporta un an après. Il n'y eut pas de directeur nommé après lui ; Mme Dejean de la Bâtie, qui avait succédé à Mme de Friedberg, resta seule chargée de la direction. Il parut que les traditions de l'école étaient, dès lors, assez fortement établies. L'enseignement normal des filles ayant été ainsi constitué, on pouvait songer à organiser pour elles un enseignement élémentaire. Il y fut pourvu par la loi du 28 mars 1882. Dans le programme tracé par cette loi, on suivit le principe dont s'était inspiré Condorcet en 1792 : les enfants des deux sexes, égaux par l'intelligence et ayant des devoirs équivalents comme membres d'un Etat et d'une famille, ont les mêmes droits à recevoir la première instruction, et à la recevoir dans la même mesure. Il y eut donc parité presque complète dans les programmes qui furent établis pour les écoles de garçons et pour les écoles de filles. Les matières d'enseignement étaient : l'instruction morale et civique ; la lecture et l'écriture ; la langue et les éléments de la littérature française ; la géographie, particulièrement celle de la France ; l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ; les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels ; les travaux manuels et l'usage des outils des principaux métiers ; les éléments du dessin, du modelage et de la musique ; la gymnastique ; pour les filles spécialement, les travaux à l'aiguille (qui, dans les écoles mixtes dirigées par un instituteur, devaient être enseignés par une maîtresse spéciale). Ce programme est toujours en vigueur. Notons seulement qu'il a été quelque peu allégé et simplifié par le décret du 18 janvier 1887, dont l'article 27 dispose : « L'instruction primaire élémentaire comprend : l'enseignement moral et civique ; la lecture et l'écriture ; la langue française ; le calcul et le système métrique ; l'histoire et la géographie, spécialement de la France ; les leçons de choses et les premières notions scientifiques ; les éléments du dessin, du chant et du travail manuel, principalement dans leurs applications à l'agriculture (travaux d'aiguille dans les écoles de filles) ; et les exercices gymnastiques ». Dans la pratique, on avait été amené à reconnaître que l'on avait un peu passé la mesure en 1882 : d'où la suppression de la littérature française, des notions de droit et d'économie politique ; d'où la substitution des leçons de choses à l'enseignement des sciences naturelles, physiques et mathématiques. On n'abaissait pas le niveau ; on s'efforçait seulement de mieux mettre les choses au point, d'écarter de cet enseignement ce qui était étranger au caractère pratique qu'il doit avoir. Il est question à cette heure de faire de nouvelles retouches au programme de l'école élémentaire. La question est à l'étude, et ce qui résultera de cette étude, nous ne saurions le préjuger. Tout cependant semble indiquer que c'est une orientation de plus en plus pratique qui prévaudra. Cela ne se marque-t-il pas dans certaines mesures de détail qui ont été déjà prises? Telle la circulaire et les instructions du 4 janvier 1897, qui s'adressent aux écoles primaires des deux sexes et sont relatives à l'enseignement des notions élémentaires d'agriculture dans les écoles rurales ; telle l'instruction du 20 mars de la même année en vue d'introduire aussi dans les écoles des deux sexes un enseignement anti-alcoolique ; telle encore la loi du 5 juillet 1903 sur l'apprentissage de la dentelle à la main dans les écoles de filles des régions où existe l'industrie dentellière. C'est, du reste, le sens dans lequel les maîtres paraissent se diriger spontanément ; c'est ce que l'on peut voir, en ce qui concerne les institutrices, par la façon dont elles comprennent leur rôle dans les cours qu'elles font aux jeunes filles adultes. Si elles ne négligent pas la culture générale, elles ont surtout souci de ce qui prépare leurs élèves à leur tâche de futures ménagères et de futures mères de famille : ce qui figure en première ligne aux programmés de ces cours, ce sont des causeries sur l'hygiène, surtout celle de la première enfance, sur l'entretien du ménage ; ce sont des travaux manuels (couture, coupe, travaux d'agrément) et des exercices de dessin appliqué à l'ornementation. Il n'est pas indifférent de remarquer, à cette occasion, que les institutrices qui, naguère, s'abstenaient en masse de faire des cours d'adultes, participent aujourd'hui en très grand nombre à l'oeuvre de la seconde éducation : en 1906-1907, le total des cours des jeunes filles s'élevait à 17 868. Les institutrices d'autrefois n'avaient peut-être pas moins de zèle que celles d'à présent. Mais, se sentant peu instruites, elles n'osaient pas ne pas se borner à des besognes très humbles et, en général, considéraient que leur affaire était de garder les petits enfants. Mais, depuis vingt ans, le personnel féminin des écoles primaires s'est senti le droit de prendre meilleure opinion de lui-même et d'avoir des visées plus relevées. Et, en effet, en consultant la dernière statistique de l'enseignement primaire (1906-1907), nous y voyons que sur 62 077 institutrices laïques, il y en a 31 818 qui sont pourvues du brevet supérieur, soit un peu plus de la moitié. Cette indication ne suffit-elle pas pour permettre d'affirmer que, depuis un quart de siècle, le niveau de l'enseignement élémentaire des filles a sensiblement monté? Enseignement primaire supérieur et professionnel. Cependant, bien que le recrutement des maîtres se soit amélioré, bien que les programmes aient été étendus, l'enseignement élémentaire, par le fait seul de l'âge des écoliers qui le reçoivent, n'est et ne peut être qu'un minimum. Pour la même raison, ses effets sont fragiles et précaires ; des élèves de six à treize ans ne sauraient avoir beaucoup de prise sur ce qu'ils apprennent, et les notions qu'on leur donne risquent de s'effacer vite de leur esprit. Or, il y a en France, plus encore peut-être que dans d'autres pays, de nombreuses familles de travailleurs qui possèdent des ressources suffisantes pour échapper au besoin de donner dès la première heure un gagne-pain à leurs enfants : et, sans oublier qu'ils auront de bonne heure à se suffire par le travail, le plus souvent par le travail manuel, elles se rendent compte qu'un supplément d'instruction et d'éducation ne serait pas pour eux un luxe déplacé, que, pour eux, il y aurait non seulement un avantage d'ordre général, mais un profit pour la vie pratique, à affermir, à perfectionner, à compléter le savoir qu'ils ont acquis dans leurs premières années. C'est pour cette clientèle que Guizot, par la loi de 1833, fonda l'enseignement primaire supérieur. La loi anti-démocratique du 15 mars 1850 négligea à dessein de le mentionner et, par suite, pendant près de trente ans, il fut comme inexistant. Mais le gouvernement de la République l'a fait revivre en 1881 et organisé par les décret et arrêté du 18 janvier 1887. Dès le début, Jules Ferry en avait très heureusement défini le caractère en disant qu'il devait « former le large couronnement d'une éducation primaire menée à bien et non pas le commencement stérile d'un autre cycle d'études qui n'aboutiraient pas » (Rapport au président de la République, 21 octobre 1881). Malheureusement, l'amour-propre malavisé de certaines municipalités, le zèle exagéré de certains maîtres le firent durant un temps dévier de la route qui lui avait été si nettement tracée, et c'est pour l'y rappeler qu'ont été rendus les décret et arrêté du 21 janvier 1893. (Pour les détails, voir l'article France.) Pour donner une idée de l'enseignement primaire supérieur en tant qu'il s'adresse aux filles (et c'est à cet égard seul que nous avons à le considérer ici), nous envisagerons donc ce que l'organisation de 1893 a voulu en faire. Cette organisation, il est vrai, il est question en ce moment de la retoucher ; un projet en ce sens sera soumis au Conseil supérieur dans la session qu'il tiendra au mois de juillet de la présente année (1909) ; mais ce projet ne comporte pas de modifications profondes ; il a plutôt pour objet de préciser, de compléter les indications des programmes du 18 août 1893 et d'en accentuer l'esprit. A cette heure, l'enseignement primaire supérieur, pour les filles aussi bien que pour les garçons, est donné dans deux catégories d'établissements : 1° dans les cours complémentaires, 2° dans les écoles primaires supérieures proprement dites. Le cours complémentaire est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction que celle-ci ; l'école primaire supérieure est installée dans un local distinct et sous une direction différente de celle de l'école élémentaire. Les cours complémentaires, depuis la circulaire du 15 février 1893, ne comportent plus qu'une année d'études. Les écoles primaires supérieures peuvent en comprendre deux, trois et même quatre. Elles sont dites écoles de plein exercice, quand le nombre des années d'études est au moins de trois. Il peut être annexé aux écoles primaires supérieures des internats qui sont tantôt au compte des municipalités, tantôt au compte des directeurs ou des directrices. Dans ces écoles, l'Etat concède des bourses (bourses d'internat, bourses d'entretien, bourses familiales) aux enfants ayant subi avec succès un examen qui a pour objet de constater leur aptitude. Quant à renseignement, il est gratuit dans les écoles primaires supérieures et dans les cours complémentaires. Pour les cours complémentaires, on n'a pas cru devoir établir de programme fixe. L'enseignement général qui y est donné a pour objet, dans ses grandes lignes, la révision et le complément du cours supérieur de l'école primaire : partant, on peut dire que, comme dans les programmes de l'école élémentaire, il est commun aux filles et aux garçons. Mais cet enseignement, dans sa partie pratique, doit participer de l'enseignement primaire supérieur, en être comme une première et sommaire initiation, et il comporte ainsi une orientation professionnelle qui, naturellement, est très différente selon les sexes. C'est pour cette raison qu'aux termes de l'arrêté du 25 janvier 1895, le programme est dressé pour chaque cours complémentaire par le directeur ou la directrice avec le maître ou la maîtresse chargés du cours supérieur de l'école élémentaire ; ils ont à tenir compte d'abord du niveau de l'instruction des élèves, ensuite des besoins de la région où se trouve placée l'école. Il n'est donc pas possible de présenter un type de l'enseignement au cours complémentaire : cet enseignement non seulement peut, mais doit être très varié, suivant les lieux. Il faut nous borner, pour donner une idée de ce qu'il pourrait être, à dire ce qui s'est fait à Paris depuis tantôt dix ans. En 1898, le directeur de l'enseignement primaire de la Seine réorganisa 17 de ces cours : 10 pour les garçons, 7 pour les filles. Pour les filles, voici les grands traits de l'organisation adoptée : l'enseignement général se donne dans la matinée et comprend la morale, le français, l'arithmétique, l'histoire et la géographie, la comptabilité, les sciences, l'hygiène et l'économie domestique, l'anglais, le chant et la gymnastique ; il lui est attribué seize heures trois quarts. Dans l’après-midi, vingt et une heures sont consacrées à l'enseignement professionnel et ménager : huit pour le dessin, quatre pour la confection quatre pour la lingerie, deux pour les modes, trois pour renseignement ménager proprement dit. L'expérience, faite dans ces dix dernières années, a donné de bons résultats ; ces cours complémentaires sont très appréciés par les familles ouvrières de Paris. Il y a lieu de croire que, sur beaucoup de points, on a su se régler d'après ce modèle : M. René Leblanc, dans son rapport sur l'Exposition de l'enseignement (1900), témoignait d'ailleurs que, dès ce moment, on avait de nombreux exemples de cours complémentaires où l'on avait su heureusement concilier les besoins pratiques et la nécessité supérieure d'un enseignement vraiment éducatif. L'arrêté du 18 août 1893 a prescrit des programmes pour les écoles primaires supérieures de filles. Il faut bien entendre toutefois que, suivant le principe adopté pour l'enseignement élémentaire, ces programmes sont équivalents à ceux qui ont été dressés pour les garçons, s'ils ne leur sont pas identiques. Pour toutes les matières d'ordre littéraire, les cours sont sensiblement les mêmes dans les écoles des deux sexes : notons cependant que, pour les écoles de filles, le programme d'enseignement de la morale est précédé d'une observation qui invite les directrices et les maîtresses à « approprier leurs leçons au caractère de leur auditoire et à insister sur certains devoirs particuliers qui s'imposent à la jeune fille et à la femme ». Et, pour plus de clarté, vient, après l'observation générale, un détail des devoirs de la jeune fille envers elle-même, de ses devoirs de famille, de ses devoirs sociaux, de ses devoirs civiques. Dans les études scientifiques, les différences sont plus notables : en mathématiques, le programme des écoles de filles est beaucoup plus réduit que celui des écoles de garçons ; en géométrie, il se borne à l'étude des constructions utilisées en dessin et aux démonstrations nécessaires aux opérations de mesure des surfaces et des volumes : encore a-t-on soin d'écarter la plupart des théorèmes qui ne peuvent être présentés sous une forme immédiatement intuitive ; en agriculture, tout enseignement théorique a été supprimé. Notons aussi qu'en 1893 a été rédigé un nouveau programme pour l'enseignement du dessin dans les écoles primaires supérieures de jeunes filles. Sans entrer dans le détail, disons qu'il oriente l'étude du dessin dans le sens de la composition décorative. Quant à l'enseignement pratique, qui doit naturellement s'adapter aux travaux féminins, il comprend les travaux manuels (couture, coupe et confection, tricot, broderie, modes, étude historique du vêtement et des travaux d'art féminin), auxquels sont consacrées quatre heures par semaine en première et deuxième année, trois heures en troisième année ; et l'économie domestique, à laquelle, en troisième année, il est attribué une heure par semaine. Mais il faut remarquer que ce que nous venons d'indiquer n'est applicable qu'à la section d'enseignement général. Or, dans les écoles primaires supérieures de filles comme dans celles de garçons, il se tait, après la première année, une spécialisation qui comprend quatre sections : 1° section d'enseignement général, 2° section industrielle, 3° section commerciale, 4° section agricole. Pour les trois dernières sections, une note officielle avertit qu'on n'a pas cru devoir fournir de programme spécial ni d'emploi du temps déterminant les heures attribuées à chaque matière : les programmes et l'horaire de l'enseignement général serviront de programme et d'horaire minimum, — Conformément à l'art. 3 de l'arrêté du 18 août 1893, « l'horaire et le programme des cours spéciaux sont arrêtés pour chaque établissement, sur la proposition de la directrice, les maîtres et maîtresses entendus, par l'inspecteur d'académie. Il y a lieu de tenir compte, dans la plus large mesure, pour la détermination de ce programme accessoire et la fixation des heures supplémentaires d'enseignement, des besoins locaux, afin de faciliter le plus possible aux élèves l'entrée dans les établissements de commerce ou d'industrie de la région ». Ici encore, nous ne saurions donc donner un schéma de l'enseignement ; le seul moyen de le connaître serait de visiter beaucoup d'écoles et de l'y voir fonctionner, puisqu'il est variable, par définition, suivant les milieux. Il est permis toutefois de citer, comme types, des écoles dont la réputation est faite dès longtemps : telles les deux grandes écoles parisiennes, l'école Sophie Germain, fondée en 1882, et l'école Edgar Quinet, fondée en 1892. Depuis trente années qu'il a été restauré, l'enseignement primaire supérieur a vu s'accroître sa clientèle d'une façon continue et rapide. En ce qui concerne les filles, des chiffres empruntés à la dernière statistique de l'enseignement primaire feront ressortir ces progrès :
A un moment, on s'est plaint que les élèves des écoles primaires supérieures se dirigeassent en trop grand nombre vers les emplois de l'Etat, que, pour les filles en particulier, il y en eût trop qui se préparassent à la profession d'institutrice. Cette plainte n'est pas complètement injustifiée ; mais il convient aussi de ne rien exagérer. Des enquêtes ont été faites pour connaître la carrière suivie par les élèves sortis des écoles primaires supérieures. La dernière statistique de l'enseignement primaire donne à cet égard des renseignements très précis et très concluants. Or, on y peut voir que, de 1903 à 1907, sur 24 630 jeunes filles sorties des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires, 4130, soit 16, 7 %, sont entrées comme élèves-maîtresses dans les écoles normales. Cette proportion est sans doute assez forte ; mais elle ne paraîtra pas excessive, si l'on songe que beaucoup de ces jeunes filles appartiennent à des familles d'instituteurs et sont conduites par une pente naturelle à suivre la même voie que leurs parents. Le succès de cet enseignement s'explique surtout sans doute par le fait qu'il répond à un réel besoin ; mais le soin qu'on a mis à recruter le personnel qui le donne y a contribué aussi dans une large mesure. La loi du 30 octobre 1886 remet au ministre lui-même la nomination des directeurs, directrices et professeurs des écoles primaires supérieures ; elle leur impose la possession du titre exigé du personnel enseignant des écoles normales. À côté de l'enseignement primaire supérieur, il existe aussi pour les femmes un enseignement proprement professionnel. Ces deux ordres d'enseignement ne doivent pas être confondus. Ils l'ont été pourtant durant un temps assez long, non pas seulement dans les idées, mais même dans les faits. Il importe donc de marquer nettement ce qui les distingue ; et, pour y réussir, le mieux est de citer des textes officiels. Voici comment est établie cette distinction dans le Rapport sur l'organisation et la situation de l'enseignement primaire public en France, publié en 1900 par le ministère de l'instruction publique ; ce document expose en même temps comment s'est faite la séparation entre les deux catégories d'écoles qui, un moment, avaient tendu à se confondre : « La circulaire ministérielle du 15 février 1893... dit fort bien : L'enseignement primaire supérieur se reconnaît du premier coup à son caractère franchement pratique et utilitaire : en ce sens général, il est professionnel. — Mais la circulaire, précisant la signification exacte du mot « professionnel » dans le cas présent, ajoute tout aussitôt : L'enseignement primaire supérieur n'en reste pas moins un enseignement véritable : il ne se confond pas avec l'apprentissage. C'est une école ; ce n'est pas un atelier ; il s'y trouve des élèves et non des apprentis. » Cependant (nous continuons à citer le Rapport), « la monographie publiée par le ministère de l'instruction publique en 1889 indiquait l'existence de deux sortes d'écoles primaires supérieures : les écoles non professionnelles et les écoles professionnelles, toutes deux pourvues d'ateliers, différant pourtant les unes des autres par le degré d'importance que les unes ou les autres attribuaient à l'enseignement professionnel. Les unes, ne dépendant que du ministère de l'instruction publique, étaient régies par la loi du 30 octobre 1886 et par les règlements organiques du 18 janvier 1887. Les autres, placées sous la double autorité, sous le condominium, comme on a dit, du ministère de l'instruction publique et du ministère du commerce, étaient régies par la loi du 11 décembre 1880, par les décrets du 17 mars et du 28 juillet 1888. » Ce régime mixte eut pour résultat que, dans cette dernière catégorie d'écoles, l'enseignement professionnel primait l'instruction générale ; l'enseignement primaire supérieur proprement dit y était abaissé. Une coupure devenait ainsi nécessaire : elle fut faite par la loi de finances du 26 janvier 1892, dont l'art. 69 est ainsi conçu : « Les écoles primaires supérieures et professionnelles dont l'enseignement est surtout industriel et commercial relèveront à l'avenir du ministère du commerce et de l'industrie, auquel elles seront transférées par décret, et prendront le nom d'écoles pratiques de commerce et d'industrie ». Ce transfert eut lieu en effet et, dès le 1er juin 1892, douze écoles primaires supérieures passaient, par décret, au ministère du commerce ; en 1905, le changement était accompli pour 52 établissements : 42 pour les garçons, 10 pour les filles (non compris 6 écoles parisiennes). Voici comment une circulaire du ministre du commerce, en date du 20 juin 1893, précise le caractère de ces écoles pratiques : « Elles diffèrent essentiellement des écoles primaires supérieures, dans lesquelles une part est faite à l'enseignement professionnel, et qui ont simplement pour objet la préparation à l'apprentissage. Pour éviter toute confusion, il importe de préciser le caractère des premières : elles sont destinées à former des employés [et des employées| de commerce et des ouvriers [et des ouvrières] aptes à être immédiatement utilisés au comptoir et à l'atelier. » Nous ne saurions omettre de rappeler que les premiers essais d'organisation de l'enseignement professionnel des filles sont dus à l'initiative privée. Dès 1848, Mme Bachellery proposait à H. Carnot le plan d'une école normale professionnelle pour les femmes. En 1856, Mme Elisa Lemonnier, avec l'aide de quelques amies, s'employait à placer un certain nombre de jeunes filles pauvres dans des établissements où elles apprenaient un état. Ainsi se constitua la Société de protection maternelle pour les jeunes filles, qui, en 1864, fut transformée en une Société pour l'enseignement professionnel des femmes. Par cette société, deux écoles du nouveau type furent fondées du vivant de Mme Lemonnier ; deux autres s'ouvrirent après sa mort, survenue en 1865. Ces quatre écoles établies à Paris ont compté beaucoup d'élèves et ont rendu des services appréciables. Les écoles pratiques d'industrie et de commerce qui existent actuellement pour les filles sont situées: à Paris (il y en a 6), à Boulogne-sur-Mer, a Cherbourg, à Dijon, au Havre, à Marseille, à Nantes, à Reims, à Roanne, à Rouen, à Saint-Etienne. Dans ces écoles se donne à la fois l'enseignement industriel et l'enseignement commercial ; pour les filles, il n'existe pas encore des écoles de commerce et des écoles d'industrie distinctes ; mais on se propose d'en ouvrir au fur et à mesure des besoins régionaux ; et, pour ces écoles à naître, des programmes distincts ont été déjà préparés. Présentement, chaque école établit son programme en s'inspirant des convenances locales. A titre d'indication, donnons le programme de deux de ces établissements. A Nantes, la durée des études est de trois années. Dans la section commerciale, l'enseignement général comprend : la morale, la langue française, l'histoire, la physique, l'histoire naturelle, l'hygiène, la géométrie, le dessin, l'économie domestique, la coupe et couture usuelles. Les matières de l'enseignement commercial sont : commerce, comptabilité, tenue des livres, anglais, arithmétique appliquée, algèbre appliquée, géographie, chimie, droit civil et commercial, économie commerciale, écriture, sténographie, dactylographie. Dans la section industrielle, l'enseignement général porte sur : la langue française, l'histoire, la géographie, l'histoire naturelle, l'hygiène, l'économie domestique, la physique, la chimie, l'arithmétique, la géométrie, la comptabilité, la morale, l'écriture. L'enseignement industriel comprend : confection pour dames, confection pour enfants, lingerie fine, broderie blanche, broderie au passé, coupe, repassage, dessin industriel. A Boulogne-sur-Mer, outre l'enseignement général commun aux élèves des deux sections, les programmes comprennent, pour la section commerciale, des cours de comptabilité et tenue de livres, quelques éléments de législation usuelle et commerciale, et l'étude de l'anglais] pour la section industrielle, un enseignement pratique et technique des travaux d'atelier. Les élèves en première et en deuxième année ne font que de la couture proprement dite ; elles se spécialisent en troisième année et choisissent entre : 1° la coupe, l'assemblage et la confection des vêtements de femme ; 2° le repassage, le glaçage, le nettoyage des étoffes. Un cours de modes a lieu une fois par semaine pour les élèves de troisième année. Un cours de cuisine théorique et pratique a lieu deux fois la semaine. Toutes les élèves suivent un cours de dessin en rapport avec l'enseignement qu'elles reçoivent. On voit par là que, suivant les lieux, il peut y avoir des variations assez notables. Mais ces écoles où l'enseignement n'est pas uniforme poursuivent un but commun: suppléer à l'apprentissage chez la patronne, apprentissage qui, depuis un certain temps, a presque cessé d'exister, et former une élite d'ouvrières capables de soutenir la concurrence avec l'étranger par le goût, l'intelligence et l'habileté de l'exécution. Ces écoles ont leurs adversaires. Mais, quelque opinion que l'on ait sur leur compte, de quelque façon que l'on préjuge leur avenir, il faut reconnaître qu'en fait elles ont eu un bon départ. Le chiffre de leur population a suivi une progression ascendante très rapide : en 1893, elles ne comptaient, pour les filles, que 375 élèves ; en 1904, ce chiffre s'était élevé à 2403. Enseignement secondaire. Le gouvernement de la troisième République, qui a organisé et sécularisé l'enseignement des filles dans l'ordre primaire, a pu, dans l'ordre secondaire, mener à bien la même entreprise. Longtemps les familles des classes moyennes n'eurent pour faire élever leurs filles que des pensionnats privés ou des couvents où, comme le disait Jules Simon, en 1867, elles ne recevaient qu'une instruction « futile, incomplète, toute d'arts d'agrément ». On a vu comment Duruy, en créant les cours secondaires, tenta de faire cesser cette situation et de satisfaire « un grand intérêt, maladroitement et odieusement méconnu ». On a vu aussi comment sa tentative réussit dès l'abord, tant elle répondait à un besoin réel. Mais l'institution des cours secondaires, telle qu'il l'avait conçue, dépendait de trop de concours bénévoles pour n'être pas fragile et précaire. Aussi, interrompus par la guerre, les cours eurent de la peine à reprendre, en 1871, dans les villes où ils existaient, et, durant quelques années, il s'en ouvrit fort peu de nouveaux ; encore ces établissements végétaient-ils pour la plupart. Il parut évident qu'il fallait faire quelque chose de plus et de mieux : constituer une Université féminine, organiser pour les jeunes filles une éducation nationale, en fondant à leur usage des établissements d'Etat analogues aux lycées et aux collèges de garçons. Mais ce programme, assez hardi et nouveau, ce n'est pas le gouvernement qui le mit en avant : seule, de toutes nos institutions légales d'éducation publique, l'instruction secondaire des femmes est due à l'initiative parlementaire. Elle a eu pour promoteur un député, M. Camille Sée. Le 28 octobre 1878, il présenta à la Chambre des députés un projet de loi dont voici les quatre premiers articles : « 1. Il sera fondé des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles. — 2. Le ministre de l'instruction publique, après entente avec les Conseils généraux et les conseils municipaux, déterminera les départements et les villes où seront fondés les établissements qui recevront des élèves internes et des élèves externes. — 3. Le ministre ouvrira dans les autres départements des établissements d'externes. Il pourra, après entente avec les Conseils généraux et les conseils municipaux, y adjoindre des internats. — 4. Tous les établissements sont fondés et entretenus par l'Etat avec le concours des départements et des villes. » Ce projet était précédé d'un rapport très étendu et très étudié, rédigé par M. Camille Sée lui-même, où il réunissait tous les arguments de droit et de fait qu'on peut faire valoir en faveur d'un enseignement secondaire public des jeunes filles, et où il montrait comment sur ce terrain nous étions fort devancés par la plupart des autres nations. Dans la première discussion à laquelle ce projet fut soumis (15 décembre 1879), la Chambre fit voir qu'elle lui était favorable en principe. Mais, à la deuxième délibération, des difficultés commencèrent à se produire. Le 19 janvier 1880, Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, fit remarquer que la création d'internats de jeunes filles allait imposer au Trésor des charges au-dessus de ses moyens. Il ajoutait qu'elle imposerait aussi à l'Université « des responsabilités nouvelles, d'un ordre très délicat, et qu'elle ne recherche pas ». Autre difficulté : l'instruction religieuse serait-elle donnée dans l'intérieur des établissements, ou le soin de pourvoir à cet enseignement serait-il laissé entièrement aux familles ? — Tant que ces deux questions ne furent pas réglées, le sort de la loi resta en suspens. On les résolut par des transactions : il fut décidé que les nouveaux établissements seraient des externats auxquels des internats pourraient être annexés par les municipalités, et que l'enseignement religieux serait donné, dans les lycées et collèges, par les ministres des différents cultes, aux enfants dont les parents en feraient la demande. La loi put enfin être promulguée le 21 décembre 1880. Il avait fallu deux ans de persévérance pour la faire triompher ; au Sénat, en particulier, la droite, qui ne voulait pas voir séculariser l'instruction des femmes, fit donner plusieurs de ses orateurs, entre autres Chesnelong, et Jules Ferry dut monter plusieurs fois à la tribune pour enlever le vote. Si, en effet, le gouvernement n'avait pas pris l'initiative de la loi, cela ne signifiait pas qu'il se désintéressait de l'oeuvre qu'elle voulait fonder. On avait déjà pu juger de ses dispositions à cet égard par le zèle qu'il avait mis à réorganiser les cours secondaires, qui languissaient depuis 1870. Paul Bert ayant fait inscrire dans la loi de finances de 1879 un crédit de 100 000 francs en faveur de cette institution, Bardoux, alors ministre de l'instruction publique, invita les recteurs à lui fournir des renseignements sur les cours qui avaient existé autrefois dans leur ressort et siliceux qui subsistaient encore à ce moment (27 janvier 1879). Peu après, Zevort, directeur de l'enseignement secondaire, adressait aux chefs d'académie une circulaire (22 avril 1879) destinée à provoquer « le développement d'une institution dont l'importance n'a pas besoin d'être démontrée », et promettant les encouragements de l'Etat aux municipalités qui seraient disposées à entrer dans la voie que leur indiquait la générosité du Parlement. Un des premiers actes de Jules Ferry à son arrivée au ministère fut de régler, par une dépêche du 8 septembre 1879, les conditions auxquelles les cours pourraient être subventionnés, et de leur donner ainsi une organisation qui leur avait manqué jusqu'alors. Voici quelles étaient ces règles : 1° vote préalable d'une allocation par les conseils municipaux, qui doivent s'engager, en outre, à fournir des locaux convenables pourvus du mobilier usuel nécessaire ; 2° fixation d'un tarif de rétribution scolaire ; 3° désignation de l'affectation qui serait donnée à la subvention du Trésor ; 4° indication du détail des sommes à dépenser pour la rémunération des professeurs. Ces dispositions, qui furent complétées dans la suite par plusieurs autres circulaires, eurent pour résultat que ces cours prirent de la consistance. Ils n'ont d'existence légale qu'à raison du crédit qui, depuis 1879, leur est alloué sur le budget de l'Etat ; ils ne sont pas des établissements publics: toutefois ce ne sont pas non plus des établissements libres, mais des établissements municipaux subventionnés par l'Etat. Avec un programme (il doit se rapprocher autant que possible du plan d'études des lycées et collèges), un personnel rétribué, un local distinct, un matériel d'enseignement, ils présentent des garanties de stabilité et diffèrent beaucoup ainsi des cours créés par Duruy, lesquels étaient comme en l'air. En fait, depuis bientôt trente ans, ils ont constamment prospéré. Dans la plupart des cas, un cours ne disparaît que pour se transformer en lycée ou en collège. Dés 1887, sur les 44 lycées et collèges de filles existants ou décrétés, 35 avaient commencé par être de simples cours secondaires. Une note ministérielle jointe au projet de budget du ministère de l'instruction publique pour l'exercice 1885 faisait ainsi ressortir ces avantages : « Les cours secondaires méritent les encouragements du Parlement. Grâce à eux, l'enseignement secondaire des jeunes filles commence à être apprécié des familles et à se développer progressivement, même dans les régions où il semblait devoir rencontrer le plus d'obstacles. Les cours secondaires permettent de donner, dans une certaine mesure et à peu de frais, le nouvel enseignement et préparent l'esprit public, dans chaque ville, à la création d'un lycée ou d'un collège. » Ainsi, même avant le vote de la loi Camille Sée, l'administration universitaire avait pris des mesures propres à préparer le succès de l'institution qu'elle fonda. Lorsque le vote de la loi fut acquis, le ministère de l'instruction publique surveilla son application avec une sollicitude constante. Les objections et réserves d'ordre financier que Jules Ferry avait été, à un moment, amené à présenter, firent craindre à certains quelque mauvais vouloir de la part de l'administration supérieure et des autorités académiques. Mais rien n'était moins justifié que cette crainte. Il n'est que juste, au contraire, de dire que si les choses purent aller sans heurts et sans acoups, ce développement régulier de l'oeuvre est dû surtout à l'intérêt avec lequel Jules Ferry, aidé par son collaborateur Zevort, la suivit aux premières heures. Ce bon vouloir était indispensable, car l'application de la loi ne laissait pas de présenter des difficultés sérieuses. Et d'abord il fallait des locaux pour les lycées et collèges à créer. Le décret du 28 juillet 1881 établit comment il serait pourvu à leurs dépenses d'installation et d'entretien : les villes avaient à supporter les premières les frais d'établissement des lycées et collèges ; mais l'Etat et les départements devaient aussi y contribuer (art. 4). Déjà dans la séance de la Chambre des députés du 10 juillet 1881, en réponse à une question de M. Camille Sée, le ministre avait formellement déclaré que « le gouvernement était prêt à contribuer aux frais de premier établissement des lycées » — et ses paroles visaient aussi les collèges — « par un sacrifice égal à la moitié de la dépense totale ». En effet, conformément à cette déclaration, dès le 12 mai de la même année fut déposé un projet de loi — qui devint la loi du 2 août 1881 — par lequel le gouvernement demandait d'augmenter de 120 millions la dotation de la Caisse des lycées, collèges et écoles primaires, et de prélever sur ce crédit une somme de 20 millions pour les établissements secondaires de jeunes filles. Depuis lors, les règles de la participation de l'Etat aux frais de première installation ont varié : elles ont été déterminées successivement par les lois du 20 juin 1885 et du 26 juillet 1893. Mais, en fait, le Parlement n'a pas marchandé à l'enseignement secondaire des jeunes filles les subsides dont il a eu besoin pour se développer. Au nouvel enseignement, outre des locaux, il fallait un personnel. Tout au début, on eut recours à des professeurs de l'enseignement supérieur et à des professeurs des lycées de garçons, et, même encore maintenant, des professeurs hommes font dans les lycées et les collèges de jeunes filles des leçons qui sont pour une part dans la faveur qu'obtiennent ces maisons. Pourtant les femmes devaient avoir la plus grande part dans l'enseignement des femmes ; sans quoi l'on eût eu l'air de croire à leur infériorité intellectuelle. Aussi, en présentant son projet de loi, M. Camille Sée avait déclaré que si, pour commencer, on pouvait s'adresser à des hommes, il faudrait avoir soin, dès que l'on trouverait des femmes capables d'enseigner, de les préférer toujours : « Elles prendront leurs grades comme les hommes, disait-il, et feront •partie au même titre du corps enseignant ». Comme conséquence de la loi du 21 décembre 1880, il prit donc l'initiative de la loi par laquelle fut instituée « une école normale d'internes destinée à recruter des professeurs femmes pour les écoles secondaires de jeunes filles ». La loi fut votée sans débats à la Chambre et, au Sénat, ne rencontra qu'une assez faible opposition. Ce résultat acquis, on ne perdit pas de temps. Très vite on décida que la nouvelle école normale serait installée à Sèvres, dans une partie des bâtiments de l'ancienne manufacture de porcelaine, qui se trouvaient alors disponibles. A la tète de l'établissement on plaça Ernest Legouvé, avec le titre d'inspecteur général des études, et on nomma directrice Mme Jules Favre, qui avait naguère dirigé avec beaucoup de distinction une institution de jeunes filles à Versailles, et qui fit preuve, dans son nouvel emploi, de remarquables qualités. On constitua en même temps le corps des professeurs, que l'on prit à la fois dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement secondaire. Enfin, «n concours d'entrée ayant été provisoirement organisé, une première promotion de 40 élèves fut admise à l'école le 12 décembre 1882. Aujourd'hui, pour prendre part au concours, les conditions, fixées par l'arrêté du 4 janvier 1884, sont les suivantes : les aspirantes doivent : 1° être âgées de dix-huit ans au moins et de vingt-quatre ans au plus ; 2° justifier, soit du diplôme d'études secondaires, soit d'un diplôme de bachelier, soit du brevet supérieur. Les élèves de la première promotion ne formaient qu'un seul groupe de jeunes filles étudiant à la fois les sciences et les lettres ; mais, sur la demande des professeurs, elles se divisèrent en deux sections, l'une scientifique, l'autre littéraire ; et les épreuves du concours d'entrée, orales et écrites, furent aussi désormais divisées en deux séries. A partir de 1884, la durée des études à l'école a été fixée à trois années. L'arrêté du 4 janvier 1884 a institué les grades propres à l'enseignement secondaire des jeunes filles. Ce sont : 1° le certificat d'aptitude, analogue à la licence, et qui est délivré soit dans l'ordre des sciences, soit dans l'ordre des lettres ; 2° l'agrégation qui, elle aussi, pendant dix années, ne comprit que deux ordres, ordre scientifique, ordre littéraire. Depuis l'arrêté du 31 juillet 1894, l'agrégation pour l'ordre des lettres, d'abord indivise, comprend deux sections, la section littéraire et la section historique. De même l'agrégation pour l'ordre des sciences est divisée en deux sections, la section des sciences mathématiques et la section des sciences physiques et naturelles. Ces grades, ce sont les élèves de Sèvres surtout qui les obtiennent : en 1900, l'école avait donné 387 certifiées, dont 211 étaient devenues agrégées. D'autres personnes pourtant se présentent directement aux examens et concours de l'enseignement secondaire des jeunes filles, et cette concurrence des élèves de Sèvres avec les aspirantes du dehors profite à la valeur des épreuves et à la force des études. En somme, le personnel enseignant féminin qui, il y a vingt-cinq ans, était à créer tout entier, se trouve aujourd'hui constitué d'une façon complète. Dès la première heure avaient été arrêtées les matières à enseigner dans les lycées et collèges de jeunes filles ; c'est la loi elle-même qui les avait déterminées. Duruy naguère avait pensé que les programmes de l'enseignement spécial pouvaient, avec quelques adaptations, convenir à l'enseignement secondaire des jeunes filles. On eut plus d'ambition sous la troisième République : on voulut que cet enseignement fût véritablement un enseignement classique, égal à celui que recevaient les garçons. Le problème à résoudre consistait à « féminiser » cet enseignement, comme disait M. Camille Sée, à réaliser, suivant le mot de Legouvé, « l'égalité dans la différence ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 décembre 1880, l'enseignement secondaire des jeunes filles comprend : l'enseignement moral ; la langue française, la lecture a haute voix, et au moins une langue vivante ; les littératures anciennes et modernes ; la géographie et la cosmographie ; l'histoire nationale et un aperçu de l'histoire générale ; l'arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l'histoire naturelle ; l'hygiène ; l'économie domestique ; les travaux à l'aiguille ; des notions de droit usuel ; le dessin ; la musique ; la gymnastique. Ce programme général fut accepté sans grande difficulté par les Chambres ; la droite ne fit guère d'opposition qu'à propos de l'enseignement moral, auquel elle aurait voulu adjoindre l’enseignement religieux. Mais, lorsque l'on eut réglé dans le détail l'aménagement des matières à enseigner dans les diverses classes, des critiques assez vives se produisirent de divers côtés, et, comme il arrive, elles lurent souvent contradictoires. Les uns se plaignaient que le niveau des éludes lût trop élevé ; d'autres, en revanche, prétendaient que cet enseignement secondaire des jeunes filles n'avait rien de secondaire ; ils le trouvaient presque identique à l'enseignement primaire supérieur. « La différence, disaient-ils, est peut-être dans le rang social de la clientèle ; elle n'existe pas dans l'enseignement même ». Si cette critique eût été fondée, les promoteurs de l'enseignement nouveau auraient dû reconnaître qu'ils avaient manqué leur but. Mais elle ne l'était pas, et on ne laissa échapper aucune occasion de la réfuter. « Les programmes de l'enseignement primaire supérieur des filles tels qu'on les conçoit aujourd'hui, écrivait Gréard, ont de nombreux rapports, sans doute, avec ceux de l'enseignement secondaire, tels que les détermine la loi du 21 décembre 1880 ; mais les procédés qu'ils comportent sont essentiellement différents. Les études primaires, quel qu'en soit le degré, sont, avant tout, des études de résultats immédiats et d'applications utiles ; le temps presse, et l'enfant a besoin d'avoir entre les mains, aussi vite que le permet l'emploi des bonnes méthodes, l'instrument de travail que l'école a pour objet de lui créer. Les études secondaires sont plus ou moins des études de loisir ; par suite, elles peuvent et doivent être des études à longue portée. » Raoul Frary disait aussi très bien : « L'enseignement primaire supérieur est un couronnement ; l'enseignement secondaire est un commencement. Si les programmes se ressemblent au début, c'est que l'un est arrivé à son développement, tandis que l'autre est encore dans la première période de croissance. D'ailleurs, l'esprit et le but des deux institutions diffèrent. D'un côté, on cherche une instruction directement utile, de l'autre une culture désintéressée. » — A ceux qui, au contraire, trouvaient les programmes trop ambitieux, on répondait qu'on avait eu la préoccupation, tout en faisant place à ce qui est propre à élever et à orner l'esprit, d'éviter tout ce qui peut favoriser la pédanterie. « Il ne s'agit pas de donner aux jeunes filles une éducation factice ou prétentieuse, disait un recteur, et de former des pédantes ou des précieuses ridicules. On n'a voulu qu'une chose : développer chez les jeunes filles, à côté de l'imagination et du goût, le jugement et la raison ; les habituer à ne pas se payer de mots, de formules chimériques, d'explications fausses ; mais leur faire comprendre franchement et sincèrement les grands faits de l'histoire, les principales lois du monde extérieur ; les devoirs que nous dictent notre conscience et les principes les plus solides de la morale ; en un mot, leur donner, en tenant compte des différences inhérentes à leur sexe, une éducation qui ne s'éloigne pas trop de celle que reçoivent les jeunes garçons. Les futures mères de famille seront ainsi préparées à une communauté d'idées plus complète et plus intime pour l'avenir avec leurs maris. » Et il est vrai que dans la façon dont sont fixés le plan d'études et l'horaire se marque bien le souci de prévenir la surcharge de l'enseignement et le surmenage des élèves. Il faut en effet remarquer en premier lieu que la durée de la scolarité ne dépasse pas cinq années (de douze à dix-sept ans), que le nombre d'heures d'enseignement, par semaine, ne va jamais au delà de 20, que les classes et les cours doivent se faire dans une heure, pas davantage. « Nous n'entendons pas, disait Gréard à propos des jeunes filles, supprimer de leurs études l'effort, qui seul est fécond ; nous voudrions simplement le mieux utiliser. Encore moins est-il question de faire pour les filles une science moins exacte, une science à leur usage, mais seulement de leur rendre la science, la vraie science, plus assimilable, en la dégageant de tout ce qui n'est pas indispensable à l'éducation de l'esprit. Bien du détail de menu savoir et de menus faits peut leur être épargné. Elles n'ont que faire des curiosités. Ce que nous demandons pour elles, en un mot, c'est un enseignement sobre, bien dépouillé, un enseignement de résultats et de conclusions, qui mette avec exactitude les sentiments, les idées, les inventions, les découvertes, les grands gains de la civilisation humaine en pleine lumière. En mesurant le temps aux professeurs, on avait le dessein de les obliger à maintenir leur enseignement dans une juste mesure. » Une autre disposition heureuse, et qui procède du même esprit, c'est la division en cours obligatoires et cours facultatifs, qui se fait après la troisième année d'études. « C'est — dit Gréard — une idée prévoyante et libérale que le partage établi, pour les deux années de la seconde période, entre les matières scientifiques et les matières littéraires, chaque section ayant un fonds commun de cours obligatoires et une série diverse de cours facultatifs. On ne peut guère se le dissimuler : à partir de quinze ans, la jeune fille commence à appartenir aux soins du ménage en même temps qu'aux relations du monde. » Notons enfin que l'on s'est gardé d'omettre ce qui, dans l'éducation des femmes, a une valeur pratique : aux travaux à l'aiguille (couture, coupe et assemblage) sont réservées deux heures par semaine d'enseignement obligatoire dans les trois premières années ; au programme de la troisième année sont inscrites douze conférences d'une heure sur l'économie domestique et l'hygiène. De plus, il a été fait à l'éducation artistique la part qui lui revient : l'enseignement du dessin, auquel se joint, en troisième année, celui de l'histoire de l'art, est également obligatoire pendant la première période de trois ans, et il lui est attribué deux heures par semaine. C'est toujours avec la préoccupation de prévenir le dressage et le surmenage que l'on n'a pas voulu créer un diplôme spécial comme sanction des études ; on s'est contenté d'établir deux certificats d'études, l'un délivré à la fin de la troisième, l'autre à la fin de la cinquième année, à la suite d'un examen passé devant les maîtresses de l'établissement, sous le contrôle d'un représentant de l'Etat. Toute cette organisation, dont nous avons essayé de marquer les grands traits, subsiste depuis bientôt trente ans. Il y a bien été apporté quelques retouches par l'arrêté du 16 juillet 1897, mais ce sont des retouches légères, qui portent sur les détails et qui, du reste, loin de modifier l'inspiration, les tendances, les directions générales que nous avons signalées, né font, au contraire, que les accentuer. Qu'elles répondent aux désirs des famillles, c'est ce dont il n'est pas permis de douter, si l'on considère le progrès continu qu'ont fait depuis 1882 les établissements secondaires de jeunes filles. Dès les premières heures, le succès a passé les espérances qu'avaient pu concevoir les plus optimistes. En 1881-1882, il n'y avait encore que quatre établissements (1 lycée, 3 collèges), comptant ensemble 342 élèves. Cinq ans plus tard, en 1886-1887, le nombre des établissements s'est élevé à 35 (16 lycées, 19 collèges) avec une population de 4967 élèves. Depuis ce temps, le mouvement n'a pas cessé de s'accélérer ; marquons quelques moments : Nombre des lycées en 1890 : 24 ; en 1900 : 47: en 1908 : 48. Nombre des collèges en 1890 : 26 ; en 1900 : 30 ; en 1908 : 67. Nombre des élèves dans les lycées: en 1890 : 4000 ; en 1900 : 9200 ; en 1908 : 17 400. Nombre des élèves dans les collèges : en 1890 : 3200 ; en 1900 : 4200 ; en 1908 : 10 800. Il faut ajouter à ces chiffres ceux qui représentent la population des cours secondaires. Bien que le nombre de ces établissements ait été réduit par la transformation de beaucoup d'entre eux en lycées ou collèges, la clientèle qui fréquente ceux qui subsistent comprend encore 6800 élèves. Il y a donc, en France, à l'heure actuelle, 35 000 jeunes filles qui reçoivent l'enseignement secondaire tel qu'il a été institué par l'Etat. Il n'est pas sans intérêt de rappeler comment, dès 1886, un étranger, le Dr Wychgram, professeur à l'école secondaire municipale de jeunes filles de Leipzig, appréciait l'oeuvre dont M. Camille Sée a été le promoteur : « Les institutions fondées par la troisième République, écrivait-il, méritent au plus haut point notre approbation ; il est de notre devoir de les recommander à l'attention de ceux qui nous gouvernent, et cela d'autant plus énergiquement que l'on n'a que trop souvent chez nous fait preuve d'indifférence à l'égard de cette question. Les plaintes formulées contre" l'organisation de nos écoles secondaires de filles ne cesseront que lorsque l'Etat lui-même aura fondé un certain nombre d'établissements types et fait contribuer au bien de l'enseignement des femmes son autorité et sa clairvoyance pédagogique. » Enseignement supérieur. Il fut un temps où les femmes étaient exclues de l'enseignement supérieur, sinon de droit, au moins de fait. Et ce temps n'est pas encore très éloigné de nous. Pour le prouver, il suffira de citer un passage du discours que M. Camille Sée prononça à la Chambre des députés, le 19 janvier 1880 : « La puissance publique, disait-il, a créé pour les jeunes gens un enseignement supérieur qui peut, dans les départements, présenter quelques lacunes, mais qui, à Paris, est largement organisé. Nous avons les Facultés de droit, de médecine, des lettres, des sciences, le Collège de France, le Muséum, l'Ecole des chartes, l'Ecole des Hautes études. L'enseignement y est donné par des maîtres dont plusieurs sont illustres. La plupart de ces grandes écoles sont fermées aux femmes. Je ne m'en plains pas pour l'Ecole de droit ; je n'éprouve nul besoin d'avoir des avocats femelles. J'avoue que l'accès de l'Ecole de médecine n'est plus interdit aux femmes. Enfin, je sais qu'elles fréquentent le Collège de France. Mais elles sont expressément exclues des cours de la Faculté des lettres par un arrêté qui, si je ne me trompe, remonte à la Restauration. Qu'on m'en dise le motif! Rien qu'en traversant la rue Saint-Jacques, elles peuvent suivre des cours d'histoire, de philosophie, de littérature qu'on leur ferme soigneusement de l'autre côté du ruisseau. » Qu'il y eût ou non des règlements formulant expressément l'exclusion des femmes, on peut dire qu'à cette époque elles n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur ; c'était par les moeurs qu'il leur était interdit. Une femme qui, publiquement, se mettait en peine d'acquérir la haute culture, n'était peut-être pas un objet de scandale, mais en tout cas elle se faisait remarquer et, malaisément, échappait au ridicule. Cependant le préjugé avait reçu quelques atteintes depuis l'époque où Duruy avait engagé les professeurs des facultés à faire des cours publics où les dames étaient admises et où elles parurent en effet. Mais était-ce vraiment de l'enseignement supérieur qui se distribuait dans ces réunions? N'étaient-elles pas plutôt tout simplement une distraction élégante? N'importe, c'était un premier pas. Par là on commença à s'habituer à voir avec d'autres yeux ce qui naguère paraissait étrange. Quand l'enseignement secondaire des jeunes filles eut été créé, quand il commença à se développer, il devait arriver tout naturellement que, parmi celles qui l'avaient reçu, il s'en trouvât un certain nombre prises du désir de pousser plus loin leurs études : et tout d'abord celles qui se destinaient au professorat des lycées et collèges. Elles subissaient les examens du certificat d'aptitude, le concours de l'agrégation devant des jurys où les maîtres de l'enseignement supérieur prenaient place : presque de nécessité, elles devaient chercher à suivre leurs leçons. Ce premier groupe d'auditrices ainsi formé ne tarda pas à en attirer d'autres. En même temps les étrangères, qui n'étaient pas gênées par nos préjugés nationaux, se mirent à affluer. Si bien que, dans les salles de cours des facultés, l'élément féminin ne tarda pas à être représenté de plus en plus. Donnons ici quelques chiffres empruntés aux Enquêtes et documents relatifs à l'Enseignement supérieur. Voici, pour l'année 1898-1899, le relevé des étudiantes françaises qui ont suivi des cours dans les diverses facultés des treize universités et de l'Ecole d'Alger : droit, 3 ; médecine, 145 ; pharmacie, 165 ; sciences, 38 ; lettres, 149. Même relevé pour l'année 1899-1900 : droit, 2 ; médecine, 164 ; pharmacie, 186 ; sciences, 39 ; lettres, 170. Pour les années suivantes, nous n'avons plus de données ; dans les Enquêtes et documents, on n'a pas continué à faire cette statistique. Mais, dans le Rapport présenté au ministre, en 1908, par le Conseil de l'université de Paris, rapport auquel sont annexés les rapports des doyens des diverses facultés, nous trouvons les renseignements suivants : il y a eu 36 étudiantes françaises à la Faculté de droit, 94 à la Faculté de médecine, 12 à l'Ecole de pharmacie, 85 à la Faculté des sciences, 351 à la Faculté des lettres. Ainsi, en cette année, le total des étudiantes françaises de la seule université de Paris est supérieur à ce qu'il était huit ans plus tôt pour toutes les universités de France. On voit assez par là quelle a été la rapidité et l'étendue de ce mouvement. Ajoutons que l'accession des femmes aux leçons de l'enseignement supérieur n'a pas eu les inconvénients que prévoyaient les pessimistes, qu'il semble plutôt avoir produit d'heureux résultats. A ce sujet, voici ce qu'écrit, dans son Rapport de 1908, M. le doyen de la Faculté des lettres de l'université de Clermont : « L'élément féminin grandit aux cours de la faculté. Parmi les jeunes filles qui assistent à nos leçons, il en est de très bien préparées, aptes à prendre la tête du cours. D'autres ne peuvent suivre les cours régulièrement, occupées qu'elles sont par leur travail professionnel dans les écoles ou les institutions de la ville ; d'autres suivent un peu en amateurs, et par mode, ou sont insuffisamment préparées, ou n'ont pas la santé suffisante pour supporter la fatigue d'une préparation sérieuse et suivie. Ces candidates et ces étudiantes bénévoles sont, à mon avis, un excellent instrument de prospérité pour l'université ; leur présence au cours n'entraîne aucun inconvénient et y améliore au contraire la tenue générale ; leur participation aux exercices pratiques est vue d'un bon oeil parleurs camarades et leur donne parfois d'excellents exemples. » Il y a apparence que si, dans les autres rapports, on ne trouve pas de renseignements de ce genre, c'est que la présence des femmes aux cours des facultés est dès maintenant considérée comme un fait normal et qui n'appelle plus de mention particulière. Que les femmes pussent un jour non seulement suivre les leçons, mais briguer les grades de l'enseignement supérieur, c'est ce que l'on n'imaginait guère il y a trente ans ; on peut même dire que les plus déterminés partisans des progrès de l'instruction féminine ne souhaitaient rien de pareil. M. Camille Sée faisait à ce sujet des déclarations très nettes dans son discours du 19 janvier 1880 : « Je ne dis pas qu'il faille, comme aux Etats-Unis, organiser l'enseignement supérieur de la femme. L'enseignement supérieur s'adresse à des jeunes gens qui, en général, veulent embrasser une carrière : celui-ci entre à l'école de droit pour être avocat, fonctionnaire ; celui-là à l'école de médecine pour être médecin. Je sais qu'il est des jeunes filles qui ont leur diplôme de docteur en médecine ; mais ce sont de rares exceptions, et, s'il faut dire toute ma pensée, je crois que nous aurons toujours trop peu de sages-femmes et assez de docteurs femelles. — Le jeune homme suit les cours de la faculté à un âge où déjà une jeune fille, par cela seul qu'elle est femme, a d'autres devoirs à remplir. La jeune fille, à dix-sept ou dix-huit ans, se marie, elle est quelquefois déjà mère de famille. — D'ailleurs, je n'examine pas la thèse de l'instruction des femmes dans les carrières dites libérales et dans les carrières administratives. Ce n'est pas un préjugé, c'est la nature elle-même qui renferme les femmes dans le cercle de la famille. Il est de leur intérêt, du nôtre, de l'intérêt de la société entière, qu'elles demeurent au foyer domestique. Les écoles que nous voulons fonder ont pour but, non de les arracher à leur vocation naturelle, mais de les rendre plus capables de remplir les devoirs d'épouse, de mère et de maîtresse de maison ». Il est vrai, en effet, qu'à cette époque le nombre des femmes qui possédaient des grades de l'enseignement supérieur était tout à fait restreint : de 1866 à 1882, il ne leur fut délivré par les facultés que 138 diplômes dans toute la France : baccalauréat ès lettres, 49 ; baccalauréat ès sciences, 32 ; licence ès lettres, 2 ; licence ès sciences, 3 ; doctorat en médecine, 20 ; officiat de santé, 2 ; diplôme de pharmacie, 1. Encore, celles qui prenaient ces grades les prenaient comme une parure, le plus souvent, et ne s'en servaient pas pour s'ouvrir l'accès de telle ou telle profession. Quelques années après, les choses ont changé de face. Voici, pour la période de six années qui va de 1888-1889 à 1897-1898, le relevé des grades obtenus par des étudiantes françaises :
Nous empruntons ces chiffres à la Statistique de l'Enseignement supérieur, publiée en 1900. Nous manquons de renseignements officiels pour les dix dernières années. Mais il est permis d'affirmer, sans craindre de commettre une erreur, que, dans cette dernière période, tous ces chiffres se sont élevés dans une forte proportion. C'est que la conquête des grades académiques a cessé d'être pour les femmes une sorte de sport intellectuel : beaucoup s'en servent aujourd'hui pour entrer dans les carrières libérales, autrefois réservées aux hommes. Cette perspective, en 1880, M. Camille Sée ne voulait pas l'examiner. Il avait tort. Mieux avisé, Charles Bigot écrivait, en 1882 : « Il faut donner aux jeunes filles une instruction solide. Le temps n'est plus où il suffisait à la femme de nourrir et d'élever les enfants, d'être apte aux travaux du ménage. L'instruction sérieuse apporte à la jeune fille le moyen de vivre de son travail, d'exercer une profession. » Nombre de jeunes filles ne se marient qu'après la vingtième année ou ne se marient pas du tout. Pourquoi ne feraient-elles pas des études supérieures et n'en profiteraient-elles pas pour se créer des situations qui leur assurent l'indépendance? Est-il bien prouvé, d'autre part, que l'exercice d'une profession libérale soit incompatible avec la pratique des devoirs de mère de famille? En fait, le nombre des femmes qui entrent dans cette voie va toujours en augmentant ; on a vu, dans ces dernières années, tomber des barrières qui leur défendaient l'accès de certaines professions : depuis la loi de novembre 1899, la profession d'avocat n'est plus interdite aux Françaises, et il en est au moins deux qui sont, à l'heure présente, inscrites au barreau de Paris. En 1907, il y avait, à Paris, une femme pharmacienne, et deux à Montpellier. A cette même date, on comptait en France 83 femmes docteurs en médecine, dont 70 à Paris et 13 dans les départements. Ajoutons que l'enseignement supérieur de l'art est maintenant accessible aux femmes comme l'enseignement supérieur des lettres et des sciences ; l'Ecole nationale des beaux-arts leur a depuis quelques années ouvert ses portes. Bien plus, il n'est pas interdit de prévoir le moment où les femmes ne s'en tiendront pas à recevoir l'enseignement supérieur ; à cette heure, il en est au moins une qui le donne : Mme Pierre Curie est chargée du cours de physique à la Sorbonne. Quelque jugement que l'on porte sur ce développement de l'instruction féminine, il faut, en tout cas, le tenir pour ce qu'il y a de plus nouveau dans l'histoire de l'éducation nationale sous la troisième République. A quelque point de vue que l'on envisage ses conséquences possibles, elles ne sauraient manquer de portée et d'influence sur l'avenir de la société française. Bibliographie. — Pour les recueils généraux, voir la bibliographie de l'article France. On pourra en outre consulter spécialement les ouvrages suivants : BASTIEN, Les Carrières de la jeune fille, Paris, Fontemoing, s. d. ; BAUZON, La Loi Camille Sée, Paris, Hetzel, 1881 ; DROUARD, Les Ecoles de filles, Paris, Belin, 1904 ; Mlle DUGARD, De l'éducation moderne des jeunes filles, Paris, Colin, 1900 ; GAUSSERON, Que faire de nos filles? Paris, Librairie illustrée, 1888 ; GREARD, Mémoire sur l'enseignement secondaire des filles, Paris, Delalain, 1883 ; JACOULET, Notice historique sur les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, Paris, Imprimerie nationale, 1889 ; LEBLANC (René), La Réforme des écoles primaires supérieures, Paris, Larousse, 1907 ; L'Enseignement professionnel au début du vingtième siècle, Paris, Cornély, 1905 ; LEGOUVE, Derniers Souvenirs, Paris, Hetzel, 1898 ; MARION, L'Education des jeunes filles, Paris, Colin, 1902 ; PECAUT et JACOULET, Notice sur les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud, Paris, Imprimerie nationale, 1889 ; ROUSSELOT, La Pédagogie féminine, Paris, Delagrave, (887 ; Camille SEE, Lycées et Collèges de jeunes filles, Paris, Cerf, 1889 ; VILLEMOT, Etude sur l'organisation, le fonctionnement et les progrès de l'enseignement secondaire des jeunes filles, Paris, Dupont, 1888 ; WYCHGRAM, L'Instruction publique des femmes en France, Paris, Delagrave, 1889.
Maurice Pellisson
|