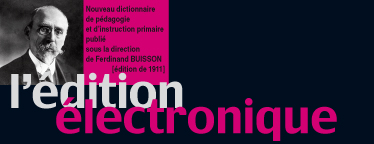 |
cCuvier (Georges)Cet illustre naturaliste appartient aussi à la pédagogie, tant par les fonctions qu'il remplit successivement dans l'enseignement et dans l'administration de l'Université, que par ses écrits relatifs à l'instruction publique. Né à Montbéliard en 1769, d'une famille protestante, Georges Cuvier fut élevé en Wurtemberg, dans le Carolinum, internat fondé par le duc Charles-Eugène ; il y fut préparé, dans la section des « Cameralia », à la carrière administrative. Mais son goût l'entraînait vers les sciences naturelles. Venu en France (Montbéliard avait été annexé en 1792), il fut d'abord précepteur en Normandie. S'étant rendu à Paris en pluviôse an III, il fut nommé en prairial an III (mai 1795) professeur d'histoire naturelle à l'école centrale du Panthéon ; et. bientôt après, suppléant à la chaire d'anatomie comparée au Muséum, puis membre de l'Institut (frimaire an IV). En 1800, il fut choisi comme successeur de Daubenton au Collège de France. En 1802, nommé l'un des commissaires de l'Institut auprès des inspecteurs généraux de l'instruction publique, il fut chargé, en cette qualité, de l'organisation des lycées de Nice, de Marseille et de Bordeaux. Napoléon, qui tenait en haute estime les rapacités administratives de Cuvier, le nomma en 1808 conseiller de l'Université, et le chargea d'importantes missions ; c'est ainsi qu'en 1809 Cuvier organisa la Faculté des sciences de Paris ; qu'en 1809 et 1810, il se rendit en Italie pour y faire une enquête sur les établissements d'instruction publique des pays italiens réunis à l'Empire ; qu'en 1811, il fut chargé d'une mission semblable en Hollande et dans les départements de la Basse-Allemagne ; et qu'en 1813, enfin, il fut envoyé à Home pour réorganiser l'instruction publique dans les anciens Etats de l'Eglise, annexés à la France. Napoléon, comme jadis Philippe de Macédoine donnant Aristote pour précepteur à Alexandre, avait voulu confier à Georges Cuvier l'éducation du roi de Rome, et lui avait déjà demandé de dresser la liste des livres qui devaient composer la bibliothèque de son élève. Les événements de 1814 empêchèrent la réalisation de ce projet. La Restauration fit entrer Cuvier au Conseil d'Etat (1814) ; et en 1815, l'ordonnance royale du 15 août, qui remplaçait le grand-maître de l'Université par une Commission de l'instruction publique, nomma en même temps Cuvier l'un des cinq membres de cette Commission. Il continua, sous le gouvernement des Bourbons, à prendre une part importante aux actes de l'administration universitaire. « C'est surtout à lui, dit un de ses biographes, que l'on doit l'établissement des comités cantonaux (1816), institution dont il avait apprécié les avantages dans son voyage en Hollande ; l'établissement des concours d'agrégation pour le recrutement du corps enseignant, à l'instar de ce qui se faisait à l'université de Turin ; et l'introduction, dans l'enseignement secondaire, des cours d'histoire, de langues vivantes, et d'histoire naturelle. » Il fut président de la Commission de l'instruction publique, comme successeur de Royer-Collard, du 13 septembre 1819 au 4 octobre 1820 ; puis président du Conseil royal de l'instruction publique, du 31 juillet 1821 au 1er juin 1822. L'ordonnance du 1er juin 1822 rétablit la charge de grand-maître, et y nomma l'abbé Frayssinous ; puis, le 26 août 1824, celui-ci reçut le titre de ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. Cuvier, que Louis XVIII venait de créer baron, fut alors nommé directeur des facultés de théologie protestante ; en 1827, il devint directeur des cultes non catholiques. La monarchie de Juillet fit de lui un pair de France. Il mourut à Paris en 1832. Nous n'avons pas à nous occuper des travaux de Cuvier comme naturaliste. Mais nous devons signaler ses écrits relatifs à l'instruction publique. Ce sont : les Rapports sur les établissements d'instruction publique des départements au delà des Alpes, faits en 1809 et 1810 (ils sont imprimés dans le Recueil des lois et règlements concernant l'instruction publique, Paris, Brunot-Labbe, tome IV, pp. 80 et suiv.) ; le Rapport sur les établissements d'instruction publique en Hollande et sur les moyens de les réunir à l'Université impériale, fait en exécution de l'art. 50 du décret impérial du 18 octobre 1811, par M. Cuvier, conseiller titulaire, et M. Noël, conseiller ordinaire et inspecteur général de l'Université ; 1 vol. in-8 de 198 p., chez Fain, imprimeur de l'Université, 1811 ; et le Rapport sur l'instruction publique dans les nouveaux départements de la Basse-Allemagne, fait en exécution du décret impérial du 13 décembre 1810, également par Cuvier et Noël, 1 vol. in-8 de 116 p., Fain, 1811. Les nombreux rapports concernant diverses questions d'instruction publique, rédigés par Cuvier sous le gouvernement de la Restauration, n'ont pas été publiés. Le Rapport sur les établissements d'instruction publique en Hollande (dont la rédaction appartient tout entière à Cuvier, quoique le nom de Noël figure aussi sur le titre) contient, sur l'histoire de l'instruction primaire dans ce pays et sur les méthodes d'enseignement qui y étaient employées au commencement du dix-neuvième siècle, des pages fort intéressantes, que nous reproduisons par extraits à l'article Pays-Bas. Cuvier a été très frappé de ce qu'il a vu dans les écoles primaires hollandaises, dont il déclare l'organisation « admirable » et « au-dessus de tout éloge ». Il pense « qu'il serait fort aisé d'adapter cette organisation à la France entière ; l'on n'aurait qu'à remplacer l'inspecteur ou commissaire général (des écoles hollandaises) par un de nos inspecteurs d'académie, que l'on chargerait spécialement des petites écoles, auquel on subordonnerait les surveillants de cantons, et qui ferait ses rapports au recteur. Les surveillants eux-mêmes seraient très faciles à trouver, car il ne manque, dans aucun de nos cantons, de citoyens instruits qui ont assez de zèle et jouissent d'assez de loisir pour se charger avec plaisir de fonctions que. leur utilité rendrait bientôt si honorables. » Toutefois, l'admiration de Cuvier ne s'étend pas aux écoles primaires supérieures ou Burgerscholen, qui lui paraissent des institutions mal conçues et même dangereuses ; il s'élève contre « cette instruction ultérieure, incomplète et mutilée, qui prétend se cacher sous le même nom (d'instruction primaire), et, en détournant la plus grande partie de la jeunesse d'une vraie et solide instruction, cherche à se soustraire elle-même à la surveillance du gouvernement » ; imbu des idées universitaires d'alors, Cuvier n'admet, au-dessus des écoles primaires proprement dites, que des établissements secondaires complets, des lycées. Au nombre des passages les plus saillants de ce rapport se trouve celui où Cuvier, décrivant les collèges hollandais, discute la question de l'internat, si controversée encore aujourd'hui. Il est intéressant de voir sur quels arguments un conseiller de l'Université impériale, discutant les avantages respectifs de l'externat et de l'internat, fondait sa préférence pour le dernier système. « Les pensionnats (dans ceux des collèges hollandais où il en existe) — dit Cuvier — sont beaucoup trop petits ; d'ailleurs, il n'est point du tout dans le goût de ce peuple de mettre ses enfants en pension ; et c'est une remarque d'autant plus essentielle à faire ici, qu'elle s'applique à tous les pays protestants, et qu'elle a exercé une grande influence sur la nature de toutes leurs institutions d'éducation ; l'explication s'en trouve dans l'histoire même de l'instruction publique en Europe. Les pensionnats pour les enfants qui n'en sont encore qu'aux éléments, pensionnais auxquels le nom de collèges a été presque réservé chez nous depuis un siècle, sont d'une institution relativement récente ; ils paraissent être nés avec les ordres religieux voués à l'éducation, tels que les jésuites et autres semblables, tous postérieurs à la Réformation. Les parents catholiques se prêtaient volontiers à des arrangements dont la tendance principale était d'arrêter les progrès du protestantisme ; et maintenant que l'habitude est prise, que les bons effets de ces maisons pour l'instruction et l'éducation en général, et indépendamment du but particulier et un peu exclusif qu'elles avaient d'abord, sont manifestes, il a été aisé d'en faire continuer l'usage. 11 est plus difficile de le faire naître dans les lieux où il n'a jamais existé. « Comme il n'arrive que trop souvent, on a conçu des préventions contre un ordre de choses que l'on ne connaît pas ; on suppose qu'il est impossible de garantir les moeurs dans ces réunions nombreuses de jeunes gens ; comme si, dans les grandes villes surtout, elles n'étaient pas aussi exposées à beaucoup de risques par les courses continuelles des écoliers. On imagine que la marche uniforme de ces institutions ôte toute liberté à l'esprit, et toute aisance aux manières, et l'on oublie qu'elle est le meilleur préservatif contre le préjugé des rangs et les ridicules de la vanité ; on méconnaît enfin l'avantage éminent de cette éducation commune, qui, ne faisant vivre que pour l'élude, n'accordant de récompense, de considération, qu'à l'étude, ne laisse à l'amour-propre aucun prétexte pour s'en dispenser, et, ne fournissant aucune autre ressource contre l'ennui, contraint, pour ainsi dire, à la méditation les esprits qui y sont le moins disposés. « Nous croyons donc que le gouvernement ne pourra engager les Hollandais à confier leurs enfants à des maisons d'éducation publique, qu'en y attirant les uns par des bourses, et les autres par des avantages quelconques, réservés à ceux qui y auront fait leurs études. » Le Rapport sur les établissements d'instruction publique dans les départements de la Basse-Allemagne, rédigé aussi entièrement par Cuvier, ne contient pas, comme celui sur la Hollande, des remarques d'une portée générale ; mais on y trouve des renseignements très précieux sur les écoles primaires de la Westphalie, du duché d'Oldenbourg, des villes hanséatiques, et de divers districts hanovriens et prussiens. Quant aux Rapports concernant l'Italie, ils ne traitent que de l'instruction secondaire et supérieure. |
