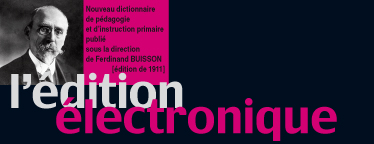 |
cCommunes (Obligation des)Les obligations qui incombent aux communes pour le service de l'enseignement primaire sont de deux sortes. Les unes ont trait à l'établissement et à l'entretien matériel de certaines catégories d'écoles ; les autres sont relatives au paiement d'indemnités diverses dues au personnel attaché à ces écoles. Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois, le Conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'établissement et l'entretien d'une école, à la condition que toutes les communes .intéressées y consentent (Loi du 30 octobre 1886, art. 11 ; décret du 7 avril 1887, art. 22). Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le Conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte (Loi du 30 octobre 1886, art. 11). Il résulte de ces dispositions que si la population d'une commune ou d'une réunion de communes autorisée par le Conseil départemental est inférieure à 500 habitants, la seule école obligatoire est une école mixte pour garçons et filles. D'autre part, la loi du 20 mars 1883 relative à l'obligation de construire des maisons d'école avait déjà spécifié dans son article 8 que « toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu et dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif d'au moins 20 enfants d'âge scolaire ». Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du Conseil départemental. Mais il est nécessaire que l'une au moins des communes intéressées y consente. (Loi du 30 octobre 1886, art. 11 ; décret du 7 avril 1887, art. 22.) Inversement, la circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 peut, sous la même condition, s'étendre sur plusieurs communes. Dans ce cas, comme dans celui qui précède, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du Conseil départemental. (Loi du 30 octobre 1886, art. 12.) Tel est l'outillage scolaire minimum prévu par la loi comme exigible des communes sur toute la surface du territoire. Mais il est évident qu'il ne saurait être considéré comme suffisant pour libérer une commune de ses obligations dans tous les cas. Aussi appartient-il au Conseil départemental, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, de déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, en même temps que la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés (Loi du 30 octobre 1886, art. 12.) La circulaire du 27 mai 1888 a exposé en ces termes les raisons qui justifient le pouvoir ainsi dévolu au Conseil départemental : « Assurément, on aurait pu concevoir un autre système : la loi aurait pu fixer elle-même une échelle de population à laquelle correspondrait, degré par degré, tel nombre fixe d'écoles ou de classes ; elle aurait pu, pour toutes les catégories d'écoles primaires élémentaires, comme elle l'a fait pour la catégorie toute spéciale des écoles de hameau proprement dites, déterminer à la fois une distance kilométrique et un effectif minimum d'élèves entraînant de droit tant d'écoles ou tant de classes. Mais le législateur n'a pas voulu s'engager dans cet excès de réglementation. Il a compté d'abord sur le bon vouloir et sur l'intérêt même des communes, ensuite sur l'équité et la compétence du Conseil départemental : il en a fait une sorte de jury départemental des intérêts scolaires ; il lui a donné les fonctions d'un tribunal arbitral chargé d'examiner une à une les situations locales, d'ouvrir une enquête, d'étudier les propositions des conseils municipaux, et, cela fait, de déclarer, non d'après les textes, mais d'après le bon sens et la bonne foi, combien il faut au moins d'écoles ou de classes dans telle commune pour que l'instruction obligatoire n'y soit pas lettre morte, pour qu'il y ait possibilité matérielle de recevoir et d'instruire tous les enfants d'âge scolaire. Le législateur a pensé qu'il prenait contre l'imperfection des jugements humains toutes les garanties désirables en ajoutant que cette décision du Conseil départemental ne serait exécutoire que si le ministre, informé des réclamations qu'elle a pu susciter, la reconnaît bien fondée et la revêt d'une approbation définitive. « Le Conseil départemental est donc juge du nombre minimum d'écoles ou de classes dont l'établissement est rigoureusement obligatoire, c'est-à-dire qu'il décide si les locaux scolaires ouverts dans la commune suffisent ou ne suffisent pas pour recevoir la population en âge de scolarité obligatoire. « Il est juge de la nature de ces écoles, c'est-à-dire qu'il décide s'il convient d'établir des écoles mixtes ou des écoles spéciales à chaque sexe, à une ou à plusieurs classes, des écoles de plein exercice ou des écoles de demi-temps, des écoles ordinaires ou des écoles de hameau, ou même des classes enfantines. « Il est juge enfin du siège de ces écoles ou de ces classes, c'est-à-dire qu'il décide, après enquête, s'il est convenable, ou s'il est possible, de les grouper sur un seul point ou de les répartir sur plusieurs dans différents quartiers de la ville, dans différentes sections de la commune. » En dehors des écoles légalement obligatoires qui peuvent être, comme on vient de le voir, ou bien des écoles communales ordinaires, ou bien des écoles de hameau proprement dites établies dans les conditions de la loi du 20 mars 1883, les communes peuvent fonder et entretenir des écoles facultatives. La loi en énumère six espèces possibles, savoir : 1° Les écoles maternelles, dans les communes de plus de 2000 habitants dont 1200 agglomérés (Loi du 30 octobre 1886, art. 15) ; 2° Les classes enfantines en général (Même loi, art. 15) ; 3° Les écoles de filles établies dans les communes de 400 à 500 habitants, antérieurement à la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 (Même loi, articles 11 et 15) ; 4° Les cours complémentaires (Même loi, art. 14) ; 5° Les écoles primaires supérieures (Même loi, art. 14) ; 6° Les écoles professionnelles ou écoles manuelles d'apprentissage (Même loi, art. 14). Le caractère essentiel de toutes ces écoles est que l'établissement, et par conséquent le maintien, en sont facultatifs. Mais, si elles ont été régulièrement créées, leur entretien donne lieu, tant qu'elles existent, de la part de la commune, à une dépense assimilée aux dépenses obligatoires. L'approbation ministérielle requise par l'art. 13 de la loi du 30 octobre 1886, pour la création des écoles publiques, n'est d'ailleurs donnée pour les écoles maternelles et les classes enfantines que si la commune s'est engagée à inscrire pendant dix ans au moins au nombre des dépenses obligatoires les dépenses qui lui incombent pour ces deux établissements. L'engagement est de cinq ans seulement pour les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires, ainsi que pour les écoles professionnelles régies par la loi du 11 décembre 1880 (Décret du 16 mars 1891). Mais si les communes désirent obtenir des subventions de l'Etat pour la construction ou l'appropriation des établissements énumérés ci-dessus, l'engagement doit porter sur une période de trente ans (Décret du 28 mars 1899). La convention qui intervient ainsi entre l'Etat et les communes pour la création et l'entretien de ces écoles facultatives les fait souvent désigner sous le nom d'écoles conventionnellement obligatoires. On les distingue ainsi des écoles purement facultatives, telles que les écoles maternelles dans les communes de moins de 2000 âmes ou de moins de 1200 habitants agglomérés, et les écoles de filles dans les communes qui n'ont pas plus de 400 âmes. Ces deux dernières catégories d'écoles ne peuvent jamais donner lieu à des dépenses assimilables aux dépenses obligatoires. Comme aucun engagement n'est intervenu pour leur installation, les communes restent maîtresses de les supprimer quand bon leur semble, sous la seule réserve que la suppression n'aura d'effet, sauf les cas de force majeure, qu'à partir de la rentrée des classes. (Circulaire du 8 février 1888.) Indépendamment de l'entretien et, s'il y a lieu, de la location des bâtiments des écoles primaires, les communes ont encore à pourvoir : 1° Aux frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ; 2° A l'acquisition, à l'entretien et au renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ; 3° A la fourniture des registres et imprimés à l'usage des écoles. (Loi du 19 juillet 1889, art. 4.) En ce qui concerne la rémunération du personnel, sont à la charge des communes : 1° L'indemnité de résidence prévue à l'art. 12 de la loi du 19 juillet 1889 ; 2° Le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; 3° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et les frais de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à l'usage des élèves des écoles primaires élémentaires situées dans les communes ou sections de communes dont la population agglomérée est de 500 habitants au moins. Cette dernière disposition, introduite par l'article 56 de la loi de finances du 26 décembre 1908, a répondu à un voeu formulé depuis longtemps dans l'intérêt de l'hygiène des maîtres et des élèves ; 4° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880 (Loi du 19 juillet 1889, art. 4) ; 5° Les indemnités allouées aux maîtresses de couture dans les écoles mixtes dirigées par un instituteur (Loi du 19 juillet 1889, articles 4 et 46, modifiés par la loi du 25 juillet 1893). Cependant le ministre de l'instruction publique est autorisé, jusqu'à concurrence d'un crédit spécial, à accorder des subventions aux communes pour le paiement de ces indemnités (Loi de finances du 16 avril 1895, art. 50). — Voir Mixtes (Ecoles). La loi du 19 juillet 1889 ayant mis les traitements des instituteurs et institutrices des écoles primaires publiques à la charge de l'Etat, la question s'est posée de savoir comment il convient d'employer les revenus des dons et legs dont la destination était de pourvoir aux dépenses de l'instruction primaire. La circulaire du 20 décembre 1890 contenait à cet égard les instructions suivantes adressées aux préfets : « Les communes qui ont reçu ces libéralités en demeurent propriétaires, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'art. 19 de la loi du 30 octobre 1886, ainsi conçu : « Toute action à raison des donations et legs faits « aux communes antérieurement à la présente loi, à « la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère « confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle « n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le « jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de « l'école aura été inséré au Journal Officiel ». Mais si, en principe, les communes n'ont plus à contribuer au paiement des traitements du personnel des écoles primaires publiques, elles n'en doivent pas moins, pour faire emploi du produit de ces fondations, rechercher les intentions des donateurs. « Il y a donc lieu, pour chaque espèce particulière, de se reporter aux termes mêmes de ces libéralités. « Si les fondations ont été faites, d'une manière générale, pour le service de l'instruction primaire, les municipalités doivent en appliquer les revenus aux dépenses obligatoires qui incombent aux communes en vertu de l'art. 4 de la loi précitée ; s'il y a un excédent, elles doivent l'employer au paiement de dépenses facultatives d'instruction primaire, telles que fournitures scolaires, secours aux élèves indigents, suppléments de traitement, etc. « Si elles ont été affectées expressément à des suppléments de traitement, la commune emploie les revenus de ces fondations à l'acquittement des indemnités de résidence et de logement que la loi met à sa charge, ces indemnités constituant en réalité des compléments du traitement légal. Si même le revenu du don ou du legs est supérieur au chiffre de ces dépenses, l'excédent doit nécessairement être conservé à l'instituteur a titre de supplément de traitement. « Lorsque la libéralité a été faite spécialement pour le paiement du traitement légal, elle doit servir encore à acquitter les indemnités de résidence et de logement. Si la commune n'a pas à payer d'indemnités de cette nature, ou si le revenu de la libéralité dépasse le montant de ces indemnités, la fondation en tout ou en partie devient sans affectation. « Enfin, si les libéralités s'appliquent à des écoles de filles dans les communes de moins de 401 habitants ou à des écoles maternelles dans les communes qui ont moins de 2000 habitants ou moins de 1200 âmes de population agglomérée, il ne peut exister de difficulté. Comme la loi du 19 juillet 1889 n'a apporté aucune modification en ce qui concerne les dépenses de ces écoles, les revenus desdites libéralités doivent continuer à recevoir leur destination régulière et venir en déduction des dépenses que les communes ont à supporter pour ces écoles. » — Voir Publiques (Ecoles) ; Hameau (Ecoles de) ; Logement ; Maisons d'école ; Mobilier scolaire ; Résidence (Indemnités de). |
