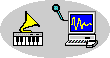
ACOUSTIQUE
ASPECTS TECHNOLOGIQUES
|
|
ACOUSTIQUE |
![]()
Notes : En cliquant sur ![]() vous
pourrez écouter les sons correspondants ; de plus, certaines images
sont réactives et peuvent alors être agrandies en cliquant
dessus.
vous
pourrez écouter les sons correspondants ; de plus, certaines images
sont réactives et peuvent alors être agrandies en cliquant
dessus.
© INRP - TECNE
Dernière mise à jour 09/04/1998
|
Désigne un phénomène (ou une grandeur) périodique et dont les oscillations sont symétriques par rapport à un niveau zéro. Une oscillation peut être périodique sans être alternative. |
|
Opération de transfert d'une valeur entrante en une valeur émergente égale au produit de la valeur entrante par un facteur appelé coefficient d'amplification : la grandeur concernée la plus courante est une tension électrique (voir Rapport d'amplification).
Pièce spécialement traitée acoustiquement pour que ses parois ne réfléchissent pas les ondes sonores ; elle est utilisée, en particulier, pour l'étude des enceintes acoustiques.
Terme employé dans le cas d'un gain négatif (voir Gain).
Discipline qui se donne pour tâche de mesurer l'acuité auditive et donc de détecter les pathologies associées. On distingue l'audiométrie subjective, dans laquelle le patient participe aux tests, de l'audiométrie objective dans laquelle le patient n'intervient pas de façon active.
Courbe qui indique, en fonction de la fréquence, la perte d'audition, en décibels (dB HL ou dB HTL), par rapport à un niveau zéro considéré comme normal.
Fréquence correspondant à un signal audible. Ce terme est parfois équivalent à basse-fréquence. On parle également de technologie audiofréquence et de signal audiofréquence.
Panneau rigide sur lequel sont fixés un ou plusieurs haut-parleurs.
Pour un haut-parleur ou une enceinte acoustique : domaine de fréquence (N2-N1) pour lequel les sons sont reproduits avec une fidélité satisfaisante, la tolérance étant généralement fixée à quelques décibels (bande passante à -3 dB, par exemple).
|
De façon générale, c'est l'intervalle en fréquence, sur la courbe de réponse d'un quadripôle, pour lequel le gain ne varie pas de plus de x dB . Pour un étage amplificateur, on prend le plus souvent pour x les valeurs 2 ou 3. |
|
Haut-parleur chargé de reproduire sensiblement la bande 40-300 Hz.
Forme spécifique de diagramme polaire d'un microphone (en forme de coeur).
Voir Anéchoïque.
Système électronique qui simule le phénomène de réverbération.
Filtre, placé sur un préamplificateur, permettant de relever le niveau des graves et des aigus lors d'une écoute à faible niveau. (Synonyme : Loudness).
Commandes placées sur l'amplificateur permettant de faire varier le niveau des fréquences basses ou aiguës suivant le choix de l'auditeur.
Courbe qui exprime le gain en fonction de la fréquence. On parle encore de courbe amplitude-fréquence. La réponse d'un même haut-parleur peut varier largement en fonction du type d'enceinte dans laquelle il est fixé.
Variation de la sensibilité ou de la sensibilité relative en fonction de la fréquence.
Appareil de contrôle du niveau de crête d'un signal.
C'est l'unité, symbole dBm, de niveau d'un signal exprimé en volt efficace : N = 20*log(U/Uo) avec Uo = 0,775 V. Ceci correspond à la valeur de la différence de potentiel qui, appliquée à une résistance de 600 W, engendre une puissance dissipée de 1 mW en régime sinusoïdal permanent.
Sont également utilisés : le dBu (identique à dBm, Allemagne), le dBv (identique à dBm, Japon et USA), le dBV (Uo = 1 V).
Pour un haut-parleur : courbe de réponse, intensité sonore-angle, tracée pour une fréquence donnée dans un plan, le plus souvent horizontal, en coordonnées polaires et dont le haut-parleur occupe le centre.
Pour un microphone : variation de la sensibilité ou de la sensibilité relative selon l'incidence d'une onde plane ou sphérique, définie par rapport à un axe de référence. Les diagrammes de directivité donnent le rapport M(a)/M(0), où M(0) est la sensibilité dans l'axe de référence (a = 0 degré), lequel est aussi l'axe du lobe principal du diagramme.
Induction parasite entre lignes conductrices ou circuits audiofréquences.
La diaphonie électrostatique est plus sensible dans les aigus ;
la diaphonie électromagnétique est plus sensible dans les
graves.
Désigne dans la pratique le taux de présence du signal de
l'une des voix (droite ou gauche) sur l'autre voie.
voir Diagramme polaire.
Les distorsions apportées par un système se manifestent par les déformations de toutes sortes (à l'exclusion de l'homothétie) qui peuvent apparaître entre le signal en entrée et le signal en sortie de ce système.
Notion qui exprime la variation du gain en fonction de la fréquence (voir Courbe de réponse). La mesure de la distorsion se ramène à une mesure de gain. S'exprime en dB.
Notion qui quantifie l'apparition, en sortie d'étage, d'harmoniques qui ne figurent pas en entrée. La valeur est calculée à partir de la tension efficace en entrée (fréquence N), de la tension efficace de sortie correspondante et des tensions secondaires (de fréquences k*N). S'exprime en dB ou %.
Relatif à deux signaux en entrée. Si N1 et N2 désignent les fréquences des 2 signaux en entrée, on constate l'apparition en sortie de signaux de fréquences respectives : N(k1, k2) = k1*N1 ± k2*N2 > 0 avec k1 et k2 entiers. Le taux d'intermodulation est défini en pratique comme égal à quatre fois le taux de distorsion harmonique.
Décalage non linéaire de la phase entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Elle varie avec la fréquence.
Capacité d'un appareil à respecter les variations de puissance correspondant à des intensités sonores variables.
Rapport de la grandeur électrique délivrée à la grandeur acoustique (pression) mesurée sur le diaphragme du microphone pour une fréquence spécifiée (souvent 1000 Hz). S'exprime en V/Pa.
Identique à la définition de l'efficacité intrinsèque (voir Efficacité intrinsèque), mais ici la pression est mesurée avant l'introduction du microphone; on tient alors compte de l'effet de filtre obstacle apporté par le microphone lui-même (voir Niveau d'efficacité). S'exprime en V/Pa.
Rapport de la pression sonore rayonnée par le haut-parleur à la racine carrée de la puissance électrique fournie au haut-parleur. Les mesures sont faites à 1000 Hz. S'exprime en Pa/W1/2.
Pression acoustique dans l'axe du haut-parleur, à une distance d'un mètre, lorsqu'il est excité par un bruit rose dont la tension correspond à une puissance de 1 W dans l'impédance nominale. La largeur de bande du bruit rose doit être limitée à celle, nominale, du haut-parleur. S'exprime en Pa.
Matériau diélectrique solide susceptible de conserver en permanence une polarisation électrique (ex : Téflon, Mylar).
Caisse de résonance associée à un ou plusieurs haut-parleurs. Sa forme et ses dimensions sont étroitement liées aux caractéristiques du (des) haut-parleur(s). On distingue classiquement les types suivants : enceinte close, ouverte ou à évent ou bass-reflex, enceinte à radiateur passif ou à haut-parleur auxiliaire passif, à haut-parleur auxiliaire actif, enceinte à labyrinthe, enceinte à décompression, à résonateur.
Rapport entre l'impédance interne de l'amplificateur et celle des enceintes.
Différence entre le bruit réel mesuré à la sortie d'un amplificateur et la valeur amplifiée d'un bruit de référence en entrée. Les mesures doivent être faites dans la même bande de fréquence.
Terme employé dans les techniques d'enregistrement du son : désigne le quotient de la valeur maximale observée sur la moyenne des valeurs observées.
Défini par : (Eo/Ed)2 avec :
Eo : efficacité en champ libre suivant l'axe du microphone.
Ed : efficacité en champ diffus.
Voir Indice de directivité.
Technologie analogique ou numérique.
- Passe-bas : filtre qui laisse passer toutes les fréquences
en dessous d'une fréquence limite maximale (fréquence de
coupure).
- Passe-haut : filtre qui laisse passer toutes les fréquences
en dessus d'une fréquence limite minimale (fréquence de coupure).
- Passe-bande : superposition d'un passe-haut et d'un passe-bas telle
que soient sélectionnées les fréquences comprises
entre les fréquences de coupure des deux filtres.
- Coupe bande : inverse du précédent ; il laisse passer
les fréquences basses jusqu'à la fréquence de coupure
du passe-bas puis les fréquences hautes à partir de la fréquence
du passe-haut.
- Paramétrique : filtre dont les fréquences de coupure
peuvent être réglées par l'utilisateur.
- Filtre résonant : équivalent à un filtre passe-bande ;
laisse passer une bande de fréquence centrée sur une fréquence
dite de résonance (voir Résonance
dans "Notions fondamentales").
Concerne un système de lecture sonore : elles correspondent à une variation de fréquence (N) liée à une variation de vitesse de l'enregistreur ou du lecteur.
- si N < 0.1 Hz, on parle de dérive,
- si 0.1 Hz < N < 10 Hz, on parle de pleurage,
- si N > 10 Hz, on parle de scintillement.
Fréquence pour laquelle on observe une chute de xdB sur la courbe de réponse ; x vaut le plus souvent 3 (voir Bande passante et Largeur de bande).
Fréquence de résonance du transducteur. Elle risque de perturber la linéarité de la courbe de réponse et doit donc être rejetée dans les infra ou les ultrasons.
Bande horizontale (exprimée en dB) à l'intérieur de laquelle se maintient la courbe de réponse sur un intervalle fréquentiel déterminé.
Définition générale : G = 20*log(Us/Ue), avec
Us = tension en sortie et Ue = tension en entrée.
De façon plus générale c'est la différence
entre deux niveaux exprimée en dBm (voir Décibel).
Transducteur électro-acoustique. On distingue classiquement les haut-parleurs : électrodynamique (classique, plan, à ruban, à chambre de compression, à pavillon, à conque, rotatif (Leslie)), électrostatique, piézo-électrique, ionique.
Forme spécifique de diagramme polaire d'un microphone.
C'est la valeur de la résistance pure qui est substituée au haut-parleur lorsqu'on mesure la puissance électrique de la source à une fréquence spécifiée. Valeurs normalisées en ohms: 2, 4, 8, 15, 25, 50, 100 et 400 .
Caractérise l'aptitude d'un microphone à distinguer une
source d'un bruit ambiant.
Il est égal à: 20*log(Fdir)½
avec Fdir : facteur de directivité (voir Facteur
de directivité).
Voir Distorsion.
Pour un amplificateur : intervalle en fréquence, sur l'axe horizontal de la courbe de réponse, dont les deux fréquences extrêmes correspondent à un gain qui vaut le gain maximal divisé par racine carrée de 2 (ceci peut correspondre à une bande passante à -3dB).
Pour un haut-parleur : on distingue la largeur de bande nominale (Bn), qui est le domaine de fréquences spécifié, par des limites, basse et haute, attribué au haut-parleur selon l'usage prévu, et la largeur de bande utile (Bu) qui est le domaine de fréquences, spécifié par des limites, basse et haute, pour lequel la réponse est de 10 dB en dessous de celle prise comme référence dans la zone médiane de la courbe de réponse. Le plus souvent Bu est diffèrent de Bn.
Voir Courbes isosoniques dans "Notions fondamentales".
En isolation par une paroi, on vérifie sensiblement que l'isolation brute apportée par cette paroi croît de 6 dB, à fréquence constante, quand la masse surfacique est multipliée par deux (ce qui, pour un même matériau, revient à doubler son épaisseur).
En isolation par une paroi, on vérifie sensiblement que l'isolation brute apportée par cette paroi croît de 6 dB, à masse surfacique constante, quand la fréquence est multipliée par deux.
Voir Correction physiologique.
Haut-parleur reproduisant sensiblement la bande 200 à 7000 Hz. On distingue parfois le bas-médium (200 à 1200 Hz) et le haut-médium (1200 à 7000 Hz).
Transducteur acoustico-électrique. On distingue classiquement les types qui demanderaient chacun un développement : micro électrodynamique, électrostatique ou à condensateur, piézo-électrique, à électret, à charbon.
Par opposition à stéréophonie, désigne la technique qui consiste à enregistrer un son en prenant l'énergie en un seul point de l'espace physique.
On distingue la modulation d'amplitude qui fait référence à la modification de l'amplitude d'un signal sinusoïdal par un autre signal, et la modulation de fréquence qui fait référence à la modulation de la phase d'un signal sinusoïdal par un autre signal. Si fp désigne la fréquence du signal modulé (porteuse) et fm la fréquence du signal modulant, on a :
- Modulation d'amplitude : s(t) = A*(1 +ß .sin(2Pi.fmt))sin(2Pi.fpt)
- Modulation de fréquence : s(t) = A*sin(2Pi.fpt +ß .sin(2Pi.fmt))
Ces techniques sont utilisées en télécommunication mais également en synthèse sonore. Les spectres des signaux modulés en amplitude ou en fréquence sont caractéristiques (Voir FM (synthèse) et Synthèse sonore dans " Electronique et informatique musicale").
|
|
|
|
|
|
Valeur en dBm < 0 exprimée par rapport au niveau zéro.
Neff = 20*log(E/Er) ; s'exprime en dB. Avec:
E : efficacité,
Er : efficacité de référence : 1 V/Pa
pour 0 dBv ; 0,775 V/Pa pour 0 dBm.
Si pour 1 Pa le micro délivre 10 mV alors Neff = - 40 dBV. Ce niveau doit être le plus grand possible.
Niveau du signal le plus grand supporté par un quadripôle. S'exprime en dBm (voir Décibel).
Valeur de la pression acoustique à ne pas dépasser, exprimée en dBspl (avec : 1 Pa => 94 dBspl). On doit spécifier quel est le taux de distorsion, la fréquence et l'impédance de charge au moment de la mesure (voir également Décibel).
Niveau d'un signal pris comme référence dans un quadripôle déterminé.
Forme spécifique de diagramme polaire d'un microphone.
Désigne un dispositif mécanique, électrique, optique
siège d'un phénomène périodique (voir Périodique
dans "Notions fondamentales").
Un tel dispositif est naturellement amorti, et pour que les oscillations
soient entretenues, il faut un apport d'énergie extérieur.
Un oscillateur peut alors être en oscillations libres entretenues,
ou en oscillations forcées. Dans le premier cas les vibrations ont
lieu à la fréquence propre du système, dans l'autre,
la fréquence est celle imposée par l'extérieur (excitateur)
et l'amplitude dépend de cette fréquence (voir Résonance
dans "Notions fondamentales").
Lorsque les oscillations sont sinusoïdales (l'amplitude est une fonction
sinusoïdale du temps) : on parle alors d'oscillateur harmonique.
En électronique (analogique ou numérique) on utilise des générateurs dits "basse fréquence" permettant de générer des signaux périodiques de différentes formes : sinusoïde, triangle, carré, etc.
Pour un haut-parleur, désigne la puissance à ne pas dépasser pour permettre une bonne dissipation de la chaleur par le haut-parleur. S'exprime en Watt (W).
Pour un haut-parleur, désigne la puissance à ne pas dépasser pour permettre un mouvement limité de la membrane dans une zone admissible. S'exprime en Watt (W).
Voir Puissance admissible.
Pour un haut-parleur, désigne la puissance que le haut-parleur supporte, sur une durée prescrite, sans modification notable de ses caractéristiques. Cette notion est voisine de celle de "puissance sinusoïdale maximale en régime stationnaire". S'exprime en Watt (W).
Pour un haut-parleur, désigne le double de la puissance sinusoïdale maximale que peut supporter, en régime stationnaire, le haut-parleur. On la définit aussi comme celle, maximale, que peut délivrer l'amplificateur pendant de brefs instants, au passage de "forte" par exemple. S'exprime en Watt (W).
Cette caractéristique, essentiellement commerciale, semble être de plus en plus abandonnée.
Pour un haut-parleur, désigne la puissance entrée attribuée au haut-parleur selon l'usage prévu (le plus souvent reproduction de la parole ou de la musique). S'exprime en Watt (W).
Voir Puissance limite d'utilisation pour un signal sinusoïdal. Cette notion est reliée à celle, assez floue, de "tenue en puissance".
Puissance, en utilisation continue, à partir de laquelle l'amplificateur ne respecte plus l'équilibre du spectre original. S'exprime en Watt (W).
Terme ambigu qui désigne, suivant les cas, soit l'énergie émise par une source en une seconde (W) soit la puissance acoustique surfacique (W.m-2).
Voir Densité acoustique dans "Divers".
Système conducteur comportant deux pôles d'entrée et deux pôles de sortie.
Si on appelle Ue la tension efficace en entrée d'un amplificateur et Us la tension efficace de sortie le rapport d'amplification est le rapport Us/Ue >1.
Si Us/Ue <1 on parle de rapport d'atténuation.
En technologie audiofréquence : différence entre
le niveau nominal et le niveau de bruit de fond. Dans le cas des microphones
le niveau de référence est de 1 Pa => 94 dBspl.
En électronique courante : différence entre le niveau
maximum et le niveau de bruit de fond.
En dB linéaire ou en dB pondéré.
Défini à fréquence donnée par: R= 100*(Pa/Pe) ; avec :
Pa : puissance acoustique totale rayonnée,
Pe: puissance électrique nominale entrée.
Remarque : R est toujours très faible (quelques centièmes).
Différence, en dBm, entre niveau maximum et niveau nominal.
Sensibilité à une fréquence ou à une bande de fréquence. S'exprime en V/Pa : S = U / p ; avec
U : tension efficace aux bornes du microphone,
p : pression acoustique efficace en un point de référence
du microphone.
Ls = 20*log(S/Sr) avec :
Sr : sensibilité de référence de 1V / 1Pa.
Pression sonore exprimée en dBspl, à une distance d'un mètre dans l'axe, pour une tension efficace de 2,8 V aux bornes de l'enceinte (ceci correspondrait à une puissance de 1 W si impédance était purement résistive de valeur 8 ohms).
Puissance acoustique exprimée en dBspl, à une distance d'un mètre dans l'axe, pour une tension efficace de 2,8 V aux bornes de l'enceinte (ceci correspondrait à une puissance de 1 W si l'impédance était purement résistive de valeur 8 ohms). La sensibilité décroît avec la puissance électrique.
Appareil de mesure d'un niveau sonore (sound level meter).
Monocorde qui sert, en acoustique, à faire des expériences
sur les cordes vibrantes.
Perception d'un relief sonore.
Mise en oeuvre, à la restitution du son, d'une illusion de localisation
spatiale des sources sonores (qui caractérise la perception binaurale).
Voir Facteur de directivité.
Voir Distorsion harmonique.
Voir Distorsion d'intermodulation.
Voir Puissance limite d'utilisation.
Total harmonic distorsion : distorsion harmonique totale (voir Distorsion harmonique).
Système physique qui fait passer d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie. On s'intéresse spécialement, en acoustique, aux transductions acoustique / mécanique, mécanique / électrique, optique / électrique.
Haut-parleur reproduisant sensiblement la bande 5000 à 20 000 Hz.
Voltage controlled amplifier : amplificateur contrôlé en tension. Technique mise en oeuvre dans les synthétiseurs analogiques.
Voltage controlled filter : filtre contrôlé dont la fréquence de résonance est contrôlée en tension. Technique mise en oeuvre dans les synthétiseurs analogiques.
Voltage controlled oscillator : oscillateur dont la fréquene est contrôlé en tension. Technique mise en oeuvre dans les synthétiseurs analogiques pour réaliser de la synthèse FM : l'oscillateur VCO est alors soumis à l'action d'un autre oscillateur (de fréquence fixe ou lui-même de type VCO).
Valeur quadratique moyenne de la tension.
Volume sonore équivalent : autre expression du rapport signal
/ bruit (Rs).
La référence est de 94 dBspl (ce qui correspond à
1 Pa).
V.S.E. = 94 dB - Rs (dB)
Appareil de contrôle du volume sonore en décibels.
Volume unit : unité de volume sur un vu-mètre.
Voir Boomer.
Unité légale de puissance ; symbole W.
En mécanique, 1 W correspond à la puissance d'une force
de 1 newton provoquant un déplacement à la vitesse de
1 m.s-1.
En électricité, 1 W correspond à l'énergie
fournie par un générateur débitant un courant d'intensité
égale à 1 A (ampère) sous une tension de 1 V
(volt).