|
|
|
|
|
L'île binationale, française et hollandaise, se trouve à 250 kilomètres au nord de la Guadeloupe qui est son département-région-académie de rattachement. Ces écoles font donc partie des treize écoles volontaires retenues dans l'échantillon de l'Académie de la Guadeloupe. Nous avons choisi ce groupe scolaire composé d'une école maternelle et d'une école élémentaire parce que ses caractéristiques en font un cas particulièrement intéressant par rapport à la finalité de la Charte: il s'agit d'étudier comment, dans un milieu socialement défavorisé, culturellement éloigné de la France et de l'institution scolaire, linguistiquement divers et politiquement ambigu, se structurent les relations entre enseignants, parents et autres partenaires, pour faire de l'école un lieu attractif et porteur de sens.
La monographie présentera dans un premier temps la situation et ses contraintes, et dans un deuxième temps les ressources et les projets.
1. Les écoles
Les locaux
Sur un sol sableux, entre lagon et mer caraïbe, l'école maternelle et l'école élémentaire constituent un ensemble continu, séparées par des clôtures en grillage.
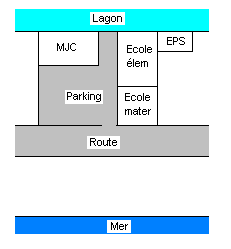
L'école maternelle est formée de neuf petits bâtiments hexagonaux qui entourent un petit préau couvert, lui-même hexagonal.

L'un de ces bâtiments est la cantine, commune aux deux écoles. 147 enfants de l'école maternelle et 236 de l'école élémentaire y déjeunent sur 60 m2, ce qui oblige à de multiples services. Le bureau de la directrice est un peu excentré, le plus souvent accessible en traversant une classe. Ce bureau n'a rien de directorial: c'est plutôt une salle commune des enseignants et des ATSEM, avec une table de réunion centrale et autour le téléphone, le réfrigérateur, l'ordinateur, et quelques autres ustensiles électroménagers, des étagères de rangement pour du matériel pédagogique, administratif. L'école ne comporte pas d'aire de jeux, en sorte que les maîtres, pour pratiquer l'éducation physique et sportive, balisent un "terrain" entre les voitures du parking du centre culturel. Les enseignants disent souffrir quelque peu de l'architecture des lieux, difficiles à aménager au point qu'ils ont conçu ensemble le schéma de ce qui leur paraît l'école idéale: une école rectangulaire, entourant une cour rectangulaire, sur un schéma classique de monastère, avec des salles spécialisées et un terrain de sport rectangulaire!
L'école élémentaire dispose de 21 salles ordinaires, de 4 salles spécialisées (musique, informatique, anglais, BCD) emprunte deux salles au Centre culturel, et utilise une aire de jeux pour l'EPS.

L'école du Lagon s'est ouverte en 1984 avec cinq classes élémentaires, une classe d'adaptation et deux sections enfantines, l'une pour les 5 ans et l'autre pour les 4 ans. Actuellement, les effectifs des deux écoles se présentent comme suit.
|
|
|
|
| École maternelle |
|
|
| École élémentaire |
|
|
La maternelle a en moyenne 26,4 élèves par classe, ce qui correspond à la moyenne de l'île (26,8). Toutefois, aucun enfant de deux ans n'est scolarisé en maternelle, faute de place pour les recevoir. La question est souvent évoquée, mais la mairie, qui a beaucoup investi ces dernières années sur le plan des constructions scolaires, se trouve aujourd'hui en difficulté budgétaire. Du point de vue des niveaux, l'école comprend deux petites sections, trois moyennes et trois grandes.
L'école élémentaire est composée de 22 classes, dont une classe d'initiation, une classe de perfectionnement, et un regroupement d'adaptation. La moyenne de 20,7 élèves par classe est inférieure à la moyenne de l'île (22,4).
"Saint-Martin ne fournit pas à l'Éducation nationale assez de personnel", écrivait l'IDEN en 1982. Aujourd'hui c'est encore le cas: il faut "importer" des maîtres du "continent" (de Guadeloupe) et de France.
|
|
|
|
|
| Depuis moins de 3 ans |
|
|
|
| De 3 à 5 ans |
|
|
|
| Depuis plus de 5 ans |
|
|
|
| Total |
|
|
|
Les maîtres sont généralement très jeunes, et la rotation du personnel est fréquente. Selon le rapport d'une commission d'enquête de 1998, "le corps enseignant à Saint-Martin comprenait 33% de maîtres sortant de l'IUFM, 30% de maîtres ayant un an d'expérience et 15% de maîtres en ayant deux". La mobilité des enseignants est forte et constitue aux yeux de l'inspection un obstacle à la continuité des projets: "plus de 30% des maîtres se renouvellent chaque année", "on a l'impression de construire sur du sable", "dès que les maîtres sont formés, par exemple à l'informatique, aux techniques du FLE, ils partent et tout est à recommencer".
Parmi les maîtres qui sont depuis moins de 3 ans à Saint-Martin, à l'école maternelle du Lagon ils sont 5 sur 6 sortants de l'IUFM, et à l'école élémentaire sur les 20 maîtres, ils sont 4 sortants de l'IUFM et 9 n'ayant qu'une année d'expérience.
Les écoles du Lagon sont en ZEP, comme Saint-Martin dans son ensemble. "Seule commune française de langue anglaise", Saint-Martin est classée "zone d'éducation prioritaire" depuis 1982. Les principales difficultés auxquelles les établissements, - qu'il s'agisse des douze écoles publiques, des deux collèges ou du lycée polyvalent - , ont à faire face et qui constituent les deux pôles prioritaires de lutte dans le projet de la ZEP, sont d'une part la maîtrise du français (30 à 35% des élèves de 11-12 ans seraient illettrés au collège de Cul-de-Sac) et d'autre part la violence dans la collectivité, ou du moins une forme de tension liée aux problèmes de coexistence des diverses communautés.
Une commission d'enquête réunie en 1998 et dont les membres - comprenant l'IEN, le proviseur du lycée, le proviseur adjoint, les principaux des deux collèges -, font partie du comité de pilotage de la ZEP, synthétise ses observations de la manière suivante:
Les observations de la commission d'enquête (1998) · Hétérogénéité des classes
- Pas de référent linguistique (celui qui existe n'est pas celui de l'école)
- L'environnement culturel est tout autre.
· Le modèle n'est pas l'école
C'est dans la rue que cela se joue
A Saint-Martin, l'école n'est pas la référence. Les élèves parlent français uniquement dans la classe.
· Hors de l'école tout est fini, pas de réinvestissement.
Pire, le peu qui est appris est oublié s'il n'y a pas motivation par nécessité.
Le Saint-Martinois n'utilise pas notre langue, c'est un fait; il existe de nombreux exemples (au bureau même)
· Saint-Martin est un simple lieu de passage pour les Haïtiens, les Dominicains, les Dominiquais…
Tous visent les États-Unis et ne voient pas l'utilité de la langue française.
Difficulté pour les enseignants de faire passer les "mauvais plis".
· L'agressivité permanente est importante chez les enfants (coexistence de cultures différentes, incompréhensions)
Au collège, on insiste sur les "nombreux actes d'incivilités et une montée de la violence verbale et physique entre les élèves et aussi envers les enseignants". "Violence, irrespect, refus de l'effort", selon le Collège de Cul-de-Sac)
· Environnement social délicat, familles éclatées, familles monoparentales.
Pas du tout d'implication des parents qui ne voient pas la finalité de l'école
· Manque de moyens, pauvreté culturelle.
· Nombreux primo-arrivants.
A Saint-Martin , le problème est plus grave qu'ailleurs.
Le diagnostic n'est pas nouveau. Déjà, pour l'inspecteur de l'Éducation nationale, en 1990:
"Le français se trouve relégué au rang de langue seconde sinon étrangère, cependant que la culture qu'il véhicule n'est en adéquation ni avec les valeurs en vigueur sur le plan local ni avec celle des milieux d'origine des immigrés".
"Consécutivement aux flux migratoires, la juxtaposition et l'incompréhension des diverses cultures en présence sont génératrices d'agressivité et d'indiscipline dans les classes, notamment à l'école élémentaire et au collège. D'une façon plus générale, la rupture entre le référent culturel du milieu scolaire et le système de valeurs du milieu familial, accrue par l'obstacle de la langue, en tant qu'elle explique en grande partie la non-implication des familles dans le problème scolaire et le manque d'investissement de la part des élèves, cette rupture est supposée jouer un rôle capital dans la genèse de l'échec scolaire."
Les résultats scolaires sont considérés dans l'ensemble comme faibles. Parmi les indicateurs de niveau, on peut signaler un retard jugé important au niveau de l'école primaire, et un écart significatif entre les résultats obtenus par les élèves de Saint-Martin aux épreuves de français et de mathématiques en début de CE2 et les résultats nationaux.
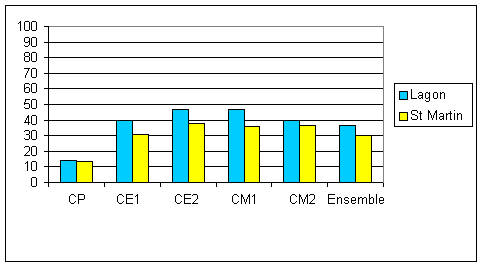
Les retards, liés, sont importants dans l'ensemble, maximum au CE2, plus sévères encore au Lagon qu'à Saint-Martin dans son ensemble.
En ce qui concerne "l'évaluation CE2", les scores en français comme en mathématiques sont sur 100 (items). En français les épreuves comportent 30 items en compréhension, 12 items en production d'écrit, 44 items en connaissance du code; en mathématiques, 14 items portent sur les travaux géométriques, 28 sur les mesures, 26 sur les travaux numériques et 10 sur la résolution de problème.
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Français |
|
|
|
|
|
|
| Mathématiques |
|
|
|
|
|
|
En français comme en mathématiques les résultats obtenus à Saint-Martin sont moins élevés que ceux des 10% les plus faibles au niveau national. L'écart des résultats entre le français et les mathématiques est le même au niveau national et à Saint-Martin (5.1 points), ce qui peut laisser supposer qu'il s'agit d'une faiblesse d'ensemble qui ne porte pas de manière exclusive sur le français.
A Saint-Martin, dans son ensemble, la population résidente serait composée de 60% d'étrangers et de 40% de Français distribué comme suit:
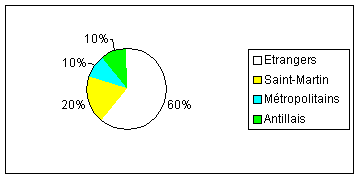
Parmi ces étrangers, qui sont majoritaires dans la population, les Haïtiens représentent la communauté la plus importante, suivis par les Antillais des îles "anglaises" et par les Dominicains.
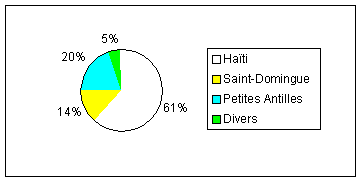
Dans les écoles du Lagon, la population scolaire se distribue actuellement comme suit:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maternelle Lagon |
|
|
|
|
|
|
|
| Élémentaire Lagon |
|
|
|
|
|
|
|
| Ensemble de Écoles primaires de Saint-Martin |
|
|
|
|
|
|
|
La colonne "Guadeloupe/Saint-Martin" regroupe en fait deux populations qu'il conviendrait de dissocier. Nos observations nous permettent de dire que les Guadeloupéens représentent environ 1/3 de ce regroupement. Le Saint-Martinois "de souche" se définit souvent de deux manières. D'abord il est Saint-Martinois parce que l'un des ses parents l'est; ensuite parce qu'il parle l'anglais de Saint-Martin. C'est ce qui le rapproche de ses voisins de la Caraïbe anglophone. Il est et se sent aujourd'hui minoritaire sur son propre territoire: on estime qu'environ un habitant sur quatre est Saint-Martinois.
Les Guadeloupéens ont commencé à venir à Saint-Martin à partir des années soixante-dix en même temps que se développaient le tourisme et la construction des premiers hôtels. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à occuper la région de Sandy Ground où ils se sont implantés. Ils ont en commun avec les Haïtiens de parler créole, même si ce n'est pas tout-à-fait le même au point de susciter parfois des incompréhensions. Mais ils ont en particulier le fait de ne jamais avoir été bien acceptés des Saint-Martinois du fait notamment que la Guadeloupe représente la tutelle sur la "dépendance" que constitue Saint-Martin d'un point de vue politico-administratif.
Les Français de métropole, peu nombreux, sont très sous-représentés à Sandy Ground par rapport à Saint-Martin. Ils sont en fait concentrés en d'autres lieux. Ils sont venus à Saint-Martin en plusieurs vagues: d'abord l'arrivée de fonctionnaires, de commerçants et de quelques "aventuriers" dans les années 60-70, puis dans les années 70-80 la venue plus massive de commerçants et promoteurs attirés par les affaires juteuses qu'il était possible de monter sur place, enfin à partir de 1986 un afflux plus important lié aux avantages de la loi de défiscalisation. Les Français de Métropole, comme les autres étrangers, se définissent ici par leur degré d'intégration et d'implication, et par leur honnêteté. Mais comme figure de l'ancien colonisateur, et représentant de la légalité formelle et de l'autorité, ils se définissent aussi par leur degré d'arrogance ou au contraire de respect des hommes et des traditions existantes. En général, aux yeux de la population locale, ils se divisent en deux: ceux que l'on peut qualifier "de gens honnêtes, respectueux des autres et des traditions", ceux qu'on considère comme "arrogants" participant à une "nouvelle colonisation", "envahissants", "opportunistes", disparaissant dès qu'ils ont fait fortune ou faillite. Souvent, "ils se croient en France":
J'ai eu l'occasion d'assister à des scènes où les parents métropolitains viennent plus ou moins engueuler le directeur ou l'enseignant parce qu'en France ça ne se fait pas comme ça, dit une enseignante. "Chez moi en France…", "chez moi en France, on prête tous les livres", alors là, il y a de quoi vous faire... mais justement on n'est pas en France, … et en même temps on est en France. C'est vrai qu'on est dans une situation...
Manifestement pour le Saint-Martinois d'origine ou d'adoption, Saint-Martin n'est pas la France, en tous cas pas tout-à-fait.
"Trop de métropolitains, nous dit le prêtre catholique, ne contribuent pas à l'édification de la cité. Ils me disent parfois "en France ça ne se fait pas ainsi", et je leur réponds (malicieusement) "mais nous ne sommes pas en France!" .
Les Dominicains (de Saint-Domingue), d'implantation relativement récente, sont fortement sur-représentés à l'école maternelle du Lagon, ce qui laisse supposer une forte augmentation de cette communauté dans les années à venir au niveau de l'école primaire. Après les Haïtiens, ils représentent la majorité des étrangers de l’île. Eux aussi, dans la perception commune, se divisent entre deux catégories, mais sexuelles cette fois: les femmes et les hommes. L’immigration en provenance de Saint-Domingue s’est d’abord faite par les femmes, et de manière significative depuis 1985. Elle aurait commencé, dans les années 1970, par l’introduction de prostituées en partie hollandaise. Et cette image de la fille séduisante et facile reste fortement ancrée dans les représentations. Les appréciations des femmes comme des hommes convergent: les Dominicaines sont séduisantes, les hommes les recherchent, et les ménages s'effondrent. 90% des ménages sont "fissurés" par des "Espagnoles", nous assure le curé de Marigot. Les hommes, de plus en plus nombreux, ont une image d'hommes durs, parfois "portés sur la délinquance".
Les Haïtiens font partie, avec les Dominicains, de la forte immigration liée au déficit de main d'œuvre au moment de la construction des grands hôtels dans les années 80. Ils ont la réputation de vivre en petites communautés très soudées. En même temps, les Saint-Martinois font la différence entre ceux qui souhaitent s'intégrer, et ceux qui sont en transit.
"Il y a un très petit noyau qui essaie de s'intégrer vraiment et de rester. Ça fait à peu près 10-12 ans qu'ils sont là. Entre temps il y a eu des naissances, il y a eu ce qu'on appelle les "Haïtiens Saint-Martinois". Des gens soit de père Saint-Martinois et de mère haïtiennne ou de père haïtien et de mère Saint-Martinois. Il y a eu ce brassage. Et puis il y a maintenant de jeunes Haïtiens qui essaient de s'intégrer. Il y a eu naissance d'associations des émigrés de Haïti, de Saint Domingue… Chaque communauté a maintenant son association qui va rencontrer le maire, le sous-préfet. On peut dire que quand il y a un projet de la commune, en les contactant, ils participent. il y a quand même un certain nombre de jeunes qui s'intéressent à la vie de la commune. Ils participent aux activités sportives, aux manifestations culturelles. Les anciens restent toujours à l'écart, mais les jeunes ils commencent à s'intégrer dans la communauté.
Et le reste est en situation de départ, ils sont attente de partir de quitter Saint-Martin. Ils ne sont pas venus pour rester. Quelles que soient les communautés. Pour les Haïtiens, c'est l'escale pour Miami. Ils sont en transit... Ici ils vivent en même temps dans un climat de peur, parce que comme beaucoup sont illégalement, ils sont employés au noir, ils n'arrivent pas à avoir des papiers. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours en attente de départ. La citoyenneté américaine a pour eux une valeur fantastique. "
La minorité "autres Caraïbes" sont ceux qu'on appelle parfois les "Anglais", notamment les Dominiquais (de Dominique), les Anguillais, les Saint-Luciens et les Saint-Kitts, très intégrés au milieu Saint-Martinois, ne serait-ce que par leur anglais commun, et par le créole à base lexicale française parlé par les Dominiquais et les Saint-Luciens.
Rappelons que la maîtrise du français est la deuxième priorité du projet ZEP. Dans les écoles primaires de Saint-Martin, selon l'Inspection, 8 élèves sur 10 entendent parler chez eux une langue étrangère. Cette observation se confirme dans les écoles du Lagon.

Certes, on peut penser que les Saint-Martinois parlent leur anglais spécifique, les Guadeloupéens le créole guadeloupéen, les Haïtiens le créole haïtien (différent du précédent), les Dominicains l'espagnol et les Français de France le français. En réalité, à des degrés divers d'intensité et de maîtrise, les enfants et les adultes parlent tout à la fois, selon le type de relation qu'ils ont avec l'autre: familière, professionnelle, administrative.
Les Saint-Martinois parlent anglais, mais aussi français, espagnol et créole. Ils ont dû s'adapter de longue date aux étrangers qui les ont reçus ou qu'ils ont reçus. Un Saint-Martinois "de souche", dans l'enseignement, précise:
"Le Saint-martinois parlait deux langues: l'anglais sa langue maternelle et le français dans les administrations, c'est-à-dire à l'école et peut-être des fois à la mairie, à la gendarmerie. Mes parents ne parlaient pas un mot de français. Moi-même j'ai fait tout ma scolarité ici, en français, et un des problèmes que j'ai rencontré en 1970 quand j'ai été en Guadeloupe, c'est que je ne comprenais pas un mot de créole, parce que ce n'était pas une langue parlée à Saint-Martin, ou très peu parce qu'il y avait très peu de guadeloupéens. Lorsque dans les années soixante-dix les Guadeloupéens ont commencé à venir à Saint-Martin, petit à petit les gens ont commencé à parler le créole, d'autant que déjà dans les années quarante, je crois, il y avait certains Saint-Martinois qui étaient partis couper de la canne en Guadeloupe. Jusque dans les années soixante-dix, moi, personnellement j'ai appris à parler le créole en Guadeloupe, parce qu'il fallait s'adapter. A Saint-Martin il y avait donc l'anglais hors de l'école, hors de l'administration, et le français dans les services administratifs."
Le directeur de la bibliothèque municipale, saint-martinois, nous précise que "généralement les Saint-Martinois ont l'anglais comme langue maternelle, ils sont créolophones, apprennent le français à l'école et souvent ils ont des parents qui sont un peu hispanophones, un peu de Curaçao. Il y a donc toujours un apprentissage linguistique sur le tas, multiple. Quand j'étais petit garçon je parlais presque trois langues: le français, l'anglais de l'église, et une espèce de créole anglophone que l'on utilise à Saint-Martin qui est un peu la langue de tous les jours. Je parlais l'anglais standard, l'anglais correct avec les gens qui nous enseignaient à l'école du dimanche, français avec ma mère, mon père et puis les enseignants à l'école, et l'anglais saint-martinois avec les autres personnes, avec mes camarades de classe, avec d'autres adultes qui habitaient dans le village où j'habitais."
Ginette, au CM2 de Sandy Ground, de père saint-martinois et de mère dominicaine, nous dit que les langues qu'elles parlent le mieux sont l'anglais et l'espagnol. Elle parle aussi le créole français (guadeloupéen) mais pas le haïtien.
Les Guadeloupéens parlent créole et français sans problème; les plus anciens manient couramment l'anglais de Saint-Martin.
Les Français parlent leur langue et parfois un peu d'anglais et d'espagnol. Lorsqu'ils sont nés sur place, ils savent utiliser l'anglais saint-martinois, ce qui leur permet d'ailleurs de marquer leur différence.
Les Haïtiens, outre le créole haïtien, parlent anglais et français. Certains, en partance pour Miami, ne s'expriment qu'en anglais.
Pour eux, c'est peut-être déjà une position sociale. Parler anglais c'est déjà mieux que parler le créole. Ils essaient d'oublier leur nationalité haïtienne pour qu'on les accepte mieux.", nous dit une Saint-Martinoise par alliance.
Carlos, lui aussi dans un CM2 de Sandy Ground, est de père et de mère haïtiens. Son père parle créole, sa mère anglais et il pense que les langues qu'il parle le mieux sont l'espagnol, l'anglais et le créole, même si, pour lui, c'est le français qui lui paraît le plus utile.
Pour les Dominicains, la durée de leur séjour à Saint-Martin est déterminante. Manuel qui est au CM2, est depuis un an à Saint-Martin. Son utilisation du français, même si elle nous surprend par sa qualité, est encore difficile. On sent un effort constant dans la recherche des mots et des tournures. Les enfants qui sont dans son cas ne sont pas - il faut l'indiquer - les plus "mauvais" élèves.
5. Le milieu économique et social
L'économie de l'île est dominée par les activités de service dans l'hôtellerie et le commerce.

Depuis le début des années 70, l'île a connu, d'un point de vue économique, un fort développement du tourisme de luxe, ce qui a généré des emplois dans la construction et dans les services. Cette situation a attiré bon nombre de personnes extérieures à l'île, et en trente ans la population résidente a octuplé. Ce boom démographique s'est fait particulièrement sentir après la loi Pons de défiscalisation.
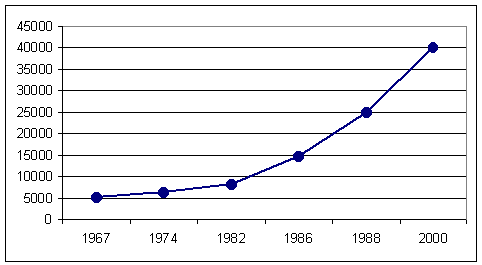
Mais en même temps, les profits tirés de l'activité touristique n'ont vraiment bénéficié qu'à une minorité d'investisseurs étrangers, et l'immigration clandestine a augmenté, ce qui a eu pour effet d'aviver les tensions sociales.
Aux écoles du Lagon, le milieu social des enfants est très modeste. Les catégories socio-professionnelles des pères se distribuent comme suit:

N.B. Les professions intermédiaires comprennent ici des policiers, des contremaîtres, des militaires de grade intermédiaire. Par petits indépendants, on entend: petits commerçants, artisans, petits agriculteurs exploitants, petit pêcheur. La catégorie "sans emploi" couvre des demandeurs d'emploi, des djobeurs (travailleurs occasionnels non déclarés), des femmes "sans profession"
6. Le contexte politico-administratif
Le contexte politique contribue à donner sens donné à l'école. A Saint-Martin, il est complexe et parfois ambigu. les sentiments de proximité entre les personnes ne concordent pas avec les regroupements administratifs et juridiques: les Saint-Martinois se sentent par exemple très éloignés de la Guadeloupe et d'une certaine catégorie de Français; au contraire les communautés d'histoire et de langue les rapprochent des "étrangers" que sont les Antillais des îles dites "anglaises".
Le premier problème est celui des relations avec la partie hollandaise et de l'unité saint-martinoise: l'île de Saint-Martin/Sint Maarten dans sa globalité est pensée d'abord comme une unité culturelle réelle transcendant une dualité nationale (franco-hollandaise) plutôt formelle. En même temps, les différences de rapport à l'Europe, de régimes sociaux, de fonctionnement administratif, etc., introduisent des clivages.
Le deuxième problème est celui du rapport à la Guadeloupe: Saint-Martin, rappelons-le est administrativement une commune de la Guadeloupe. Pourtant elle en diffère sur bien des points. Pour aller vite, un Saint-Martinois nous le rappelle de cette manière:
"La Guadeloupe, franchement, c'est une île qui a des intérêts économiques, sociaux, et culturels qui sont complètement différents de Saint-Martin. Ce sont des créolophones, pas des anglophones, ce sont des planteurs de canne, ce ne sont pas des commerçants."
A l’occasion d’une récente mission sénatoriale conduite Jacques Larché, sénateur de Seine et Marne et président de la Commission des lois du Sénat, déclare à Saint-Martin:
"Il est clair que vous n’êtes pas la Guadeloupe et que votre cause est rationnelle et légitime. Il faut donc que votre développement soit envisagé à part."
Le troisième problème est celui du rapport à la France. L'indépendantisme est une position minoritaire, mais il existe un consensus pour la recherche d'un statut particulier, qui sans rompre avec la France, tienne compte des spécificités et des intérêts locaux.
La question de l'identité saint-martinoise reste donc posée, ce qui n'est pas sans effet sur l'idée que l'on peut se faire de l'école, d'une école française dans une aire américaine partiellement non francophone
L’entrée dans la Charte a pu être diversement perçue par les enseignants de ces écoles: une bonne partie des enseignants qui ont participé à la première rédaction du projet ne sont plus dans l’école et une bonne partie de ceux qui y sont, n’ont pas participé à sa rédaction.
Comme le souligne une des enseignantes: "On s'est senti embarqué dans une chose sur laquelle on n'avait pas vraiment réfléchi. Mais ce qu'on a apprécié, c'est que cette charte répondait exactement à ce qu'on avait déjà commencé à Sandy Ground… En lisant la Charte, on s'est rendu compte qu'on était déjà là-dedans. On s'est dit tous, pourquoi pas!"
Les projets des écoles sont directement liés aux difficultés énoncées qui ont conduit Saint Martin à être une ZEP: la question de la maîtrise du français et de l'agressivité. Pour les deux écoles, avec des styles différents liés à la fois aux personnalités des directrices, mais aussi à la taille des écoles, la question centrale est de faire reconnaître l'institution scolaire dans le quartier comme lieu de socialisation et d'intégration, et comme lieu de l'apprentissage de la langue française. Le moyen privilégié que se sont donné les deux groupes d'enseignants est le travail en commun: travail en commun entre enseignants, entre enseignants et partenaires internes à l'école, Atsem, aides-éducateurs, intervenants extérieurs, entre enseignants et partenaires externes, personnels communaux, Maison des Jeunes et de la Culture implantée dans le quartier, et surtout parents d'élèves. Les directrices qui sont en même temps les seuls enseignants "anciens" de l'école, sont les points d'appui, les incitateurs et les régulateurs de ce travail en commun.
Les buts explicites de l'organisation de l'école maternelle du Lagon est de faire aimer l'école par un aménagement des lieux et des relations qui impliquent chacun à son niveau de responsabilité, et de faire aimer la langue française par des activités diverses qui ne nient pas l'identité des enfants. Cette organisation est ancrée dans des convictions fortes. Dans un milieu environnant démuni, le problème des enfants à l'école est d'abord social: l'école doit en quelque sorte suppléer aux insuffisances éducatives de leur milieu en même temps qu'elle doit instruire. Les deux maîtres mots de la directrice sont "amour et égalité".
"On a l'idée que les enfants de Saint Martin ne peuvent pas aller très loin, alors que c'est faux…J'ai aimé le travail qu'on pouvait faire ici. En général on ne donne pas assez leur chance aux enfants d'ici. Les enfants qui arrivent à l'école sont différents- en particulier par l'origine ethnique - et il est juste de tous les aimer, de procéder au même accueil pour tous, de donner les mêmes chances à tous."
Un parent originaire de Saint Martin avec qui nous avons eu un entretien particulier, souligne à sa façon la question de l'égalité des chances et le mauvais diagnostic posé sur les enfants de Saint Martin: "Ce n'est pas que nos enfants ne savent pas, mais ils ne comprennent pas". Une enseignante de CM évoque une observation proche: "Le premier mois, à propos des enfants, je ne voyais que des problèmes. Quand j'ai commencé mes évaluations diagnostiques, j'ai paniqué…Mais j'ai des enfants trilingues dans ma classe, et à cet âge, c'est extraordinaire. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrive justement à utiliser ça: c'est ce qui nous manque. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Si on savait comment faire pour utiliser cette situation linguistique, on aurait des enfants très brillants à Saint Martin."
A l'école élémentaire, l'orientation prioritaire des actions vise la socialisation, à la fois sous l'angle de la civilité (les règles de la vie commune), de la citoyenneté (responsabilité et autonomie) et de l'identité (connaissance de soi et ouverture sur les autres cultures présentes dans l'île), tout en ayant toujours en perspective la question de la maîtrise de la langue. La directrice de l'école élémentaire, originaire de Saint Martin et adjointe au maire, responsable des affaires sociales et culturelles, est fortement impliquée dans la commune.
1. Le travail entre les enseignants
"Le point fort: j'arrive toujours à unifier les équipes" dit la directrice de l'école maternelle. Une mère d'élève de l'école élémentaire considère que le nombre élevé de professeurs des écoles sans expérience n'est pas vraiment un handicap, car la directrice est là pour contrôler le travail et assurer la continuité.
Un accueil des débutants et des nouveaux venus
Il s'agit pour les deux directrices de faire prendre la mesure des difficultés aux nouveaux venus. A la réunion de prérentrée de l'école maternelle, la directrice précise quels sont, selon elle, les besoins des enfants du quartier et les règles de conduite exigibles de la part des enseignants tant vis à vis des élèves que des parents, en terme de suivi, de rigueur, d'honnêteté, d'amour à l'égard des premiers, de respect réciproque, de sollicitation et d'information à l'égard des seconds. Les enseignants reçoivent un "Livret d'accueil" qui rappelle les finalités de l'école en terme de résultats, qui affiche la volonté d'établir des relations de confiance et d'aide entre la directrice et les nouveaux, et entre les plus anciens et les nouveaux dans un rapport de tutorat.
Le livret comprend outre l'énoncé de ces principes, l'attribution des salles avec la liste des enseignants et Atsem, un calendrier de l'année, les dates des vacances scolaires, la liste des enseignants avec leur adresse et leur téléphone, un document sur la "photographie de la classe" à remplir par l'enseignant (nombre de filles et de garçons et origine des enfants); la liste des semaines de classe ponctuées par les fêtes traditionnelles. Sur cette liste sont répartis en concertation les thèmes d'activités communs, et les moments d'évaluation systématique. S'y trouve également la répartition des zones de surveillance à la récréation et au moment des entrées et des sorties sur l'ensemble de l'année scolaire.
A l'école élémentaire, la directrice nous indique qu'elle informe les nouveaux venus sur le quartier, sur le rôle éducatif de l'enseignant et la tâche de relation qu'ils auront avec les parents. Selon elle, la plupart arrivent à assumer cette mission complexe, du moins ils en prennent conscience. Ainsi s'exprime une enseignante dont c'est la deuxième année à Saint Martin:
"On est dans un endroit où les enfants ont pas mal de problèmes, et pourtant, on essaie de faire quelque chose: on n'y arrive pas forcément parce que nous, nous ne sommes pas vraiment formés pour enseigner à ces enfants; il nous manque quelque chose, je ne sais pas vraiment quoi, mais quelque chose qui pourrait nous amener à faire arriver ces enfants anglophones plus loin que la 4ème ou la 3ème. On a vu que beaucoup d'élèves en 6ème dérapent... Je n'ai pas trop d'espoir: sur les 22 que j'ai envoyés, peut-être 12 iront jusqu'à la seconde. Il faudrait que les enseignants soient formés pour ça; beaucoup à Saint Martin ne sont pas formés: la formation sur le tas ne suffit pas. Ce que je vois sur les enfants du collège avec qui je travaille en cours du soir, ça me fait peur. Il y a un problème au niveau du système. Ce n'est pas évident même à l'élémentaire. Mais on peut donner un bon coup de chapeau à ces enfants qui ne parlent pas le français chez eux et à qui on l'impose à l'école en ne leur enseignant qu'en français."
Une réflexion pédagogique en commun
Dans les deux écoles le travail en équipe est une priorité, car une ressource nécessaire.
A l'école maternelle les réunions hebdomadaires sont instaurées à l'initiative de la directrice; mais elles ne remplacent pas les concertations "obligées" définies par l'inspection dans le cadre de la 27ème heure.. "C'est dans mon premier poste que l'on a fait ce système de travail en commun. On faisait du bon travail: on avait initié cela entre nous. Ce sont des enseignants qui veulent aller de l'avant." La directrice insiste sur le caractère extérieur à la hiérarchie et à l'obligation institutionnelle de cette pratique: on pourrait dire qu'il s'agit plutôt d'un contrat moral. Ces réunions correspondent en fait à une partie de la préparation de chaque enseignant. L'adhésion à ce mode de travail vient du désir de réussir pour faire progresser les élèves, même si la directrice reconnaît que parfois c'est un peu dur, car toutes les équipes n'aiment pas le travail bien fait. "En début d'année, ça peut être 2 ou 3 fois dans la semaine, pour aider à ranger la salle de chacun, évacuer le stress de ces jeunes qui arrivent." Mettre les connaissances en commun et travailler ensemble rend plus performant: les enseignants de l'école adhèrent à cette perspective, d'autant plus que, comme dit l'une d'entre eux: "on ne va pas se braquer, on a tout à apprendre. Alors on entre dans le dispositif". Une autre: "Notre formation initiale est insuffisante; ici, c'est l'occasion de se former". Un autre évoque un sentiment plus social et moral: "On ne sent pas obligé de rester; mais on a une prise de conscience par rapport à la réalité du quartier. On ne peut pas ne pas travailler: ce serait malhonnête." Une autre enfin parle du travail intéressant de réflexion sans lequel le métier serait vite ennuyeux.
Cette préparation est rédigée sur de grands panneaux: les activités sont organisées selon les domaines scolaires; elles sont réparties par semaine entre les congés scolaires. On peut y trouver mention de thèmes, d'objectifs, de supports, d'exercices…Les tableaux d'activités par thème commun sont retravaillés par chacun à son niveau: la discussion porte sur la progression des activités autour du thème qui doit à chaque niveau permettre d'aller plus loin dans les apprentissages, en même temps qu'elle s'appuie sur le niveau précédent.
"Souvent je commence d'abord par me taire pour laisser les jeunes proposer" précise la directrice. Chacun écrit à son niveau… Et nous avons notre dessinateur dans l'école qui dessine ce qu'il faut comme support; qui nous fait aussi des arrangements pour guitare. Bientôt nous allons faire une cassette musicale (comme nous l'avons déjà fait) à partir des chansons chantées dans les classes."
Ceci n'empêche pas un enseignant de travailler parfois un thème de son choix.
De cette façon, les choix pédagogiques ne sont pas définis a priori, mais donnent lieu à discussion. C'est ainsi que, pour l'attribution des classes en début d'année, la directrice refuse de dire à l'avance le niveau de la classe de chacun: il le découvre le jour de la prérentrée, pour éviter que les enseignants ne viennent avec des fiches toutes faites récupérées chez telle personne de connaissance; ce qui conduirait à reproduire des schémas préconçus et à ne pas commencer par observer et analyser la population d'élèves: le travail ne serait alors pas pensé. Ces réunions sont justement le moment où le travail est réfléchi en commun: on discute de tout et on apprend à travailler. Ce qui est un avantage pour les débutants: ils bénéficient d'un cadre sécurisant et de l'expérience acquise par les autres, comme ils peuvent apporter leur savoir et leurs compétences particulières. La directrice est la première à reconnaître qu'elle apprend aussi des jeunes enseignants. Toujours pour éviter l'enlisement dans une routine et des préjugés, quand une année un enseignant a bénéficié d'une "bonne" classe, l'année suivante, il en a une plus difficile; le principe étant que personne n'est "propriétaire" de son niveau de classe, ni de sa salle.
Pour la directrice de l'école élémentaire, travailler en cycles est un outil intéressant, voire indispensable, d'autant plus que l'équipe enseignante est importante. Ainsi sont instaurées des réunions de conseil de cycle une fois par trimestre et des réunions spécifiques d'échanges pédagogiques à la fin de chaque mois qui donnent lieu à compte rendu sur des cahiers de conseil de cycle et un cahier de bord des réunions pédagogiques. Dans le cadre du travail de la Charte, des réunions supplémentaires concernent une petite équipe d'enseignants plus particulièrement chargés du travail d'animation et de coordination des actions. Ces enseignants sont déjà impliqués comme animateurs de cycle ou responsables des deux projets d'action privilégiés que l'école veut développer: le journal scolaire et la radio scolaire. Une enseignante témoigne ainsi:
"Oui, pour le travail, je voudrais rester dans cette école: je ne suis pas sûre de trouver une école comme ça en Guadeloupe. J'ai le sentiment d'une école qui fonctionne de manière rare par rapport à ma connaissance des écoles. Ce qu'on a fait sur le travail en cycle est un travail sérieux de réflexion, de discussion…J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient dans cette école. Ici réellement, j'ai découvert le travail en équipe: j'avais vraiment des collègues de travail…En décembre, après les inspections, on a réellement commencé à discuter sur la manière de faire avec les enfants. Il y a eu beaucoup de concertations. Et au fur et à mesure des réunions, on a vu des améliorations."
Une ambiance conviviale et une exigence d'implication
"Même si les autres écoles m'appellent "le dictateur" - je le sais - , mais je pense que si je l'étais, je ne crois pas que les collègues viendraient travailler dans l'école aussi tard et le week-end…"
La directrice de l'école maternelle s'efforce de développer un sentiment familial dans l'école.
"Je m'arrange pour que dans le bureau ce soit convivial: qu'il y ait la cuisinière, qu'on puisse manger à table, même si après, c'est le vrai fouillis. Ce n'est pas mon bureau, c'est le bureau de tout le monde: il y a la cafetière, la cuisinière, le frigo rempli de plats à manger le midi. Je tiens à ce que cela se passe ainsi."
Cela se traduit par l'importance accordée à l'accueil "affectif" des nouveaux venus. D'autant plus que la majorité des enseignants sortent de l'IUFM et expriment une réelle angoisse face au métier:
"Depuis l'entrée à l'IUFM, on a l'impression que c'est la troisième année de stress, de pression, de course, quelque chose de difficile à vivre. En arrivant sur le terrain on a peur des parents, de l'inspecteur…"
Et la réponse apportée dans cette école, les soulage:
"On est soutenu, c'est sécurisant…Notre place, on nous l'a faite."
Et en particulier vis-à-vis des parents, la directrice apporte un soutien total. Pour elle, les parents ne sont pas là pour surveiller les enseignants.
"Il faut laisser la porte ouverte; je dis aux collègues: vous vous sentez mal, vous venez. Je ne répète pas en public la vie privée des gens; je donne des petits conseils: ça fait partie de la pédagogie tout ça. Il faut savoir donner pour recevoir: une qualité de relation."
Il y a ici de la part de la directrice une volonté d'agir qui correspond à un projet personnel identitaire: être quelqu'un de bon dans un environnement souvent marqué par les histoires, les cancans.
"Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis; un point c'est tout. Et le lendemain, c'est terminé…Même face à quelqu'un d'un peu traître, on discute et on va vers le bon côté des choses. Si quelque chose ne va pas avec un collègue, je l'appelle immédiatement au bureau, on s'explique et c'est terminé. Le lendemain si c'est l'anniversaire de ce collègue, il aura son anniversaire; car les anniversaires sont fêtés à l'école".
Les jeunes enseignants de l'école sont d'ailleurs particulièrement sensibles à cette attitude de franchise.
Et pourtant la directrice se dit très exigeante au niveau du travail. "Je passe regarder dans les classes: si ce n'est pas positif, on en discute. Par exemple, un enseignant écrit très mal, les exercices sont à la limite de la lisibilité, je suis intervenue, il a fait des efforts." Seule une atmosphère sereine et gaie est propice à un travail pédagogique efficace. "Ici on n'entre pas avec ses problèmes: on les laisse sur les clous qui sont sur le grillage de l'école."
Les enseignants de l'école élémentaire reconnaissent également le caractère positif des réunions.
"C'est très convivial d'abord. Souvent il y a un petit pot. La réunion est souvent dirigée par la directrice quand il s'agit de décisions d'ordre général. Mais quand on a à plancher sur une question particulière, on se définit un objectif et on travaille tous dessus pendant 1h ou 1h1/2: tout le monde donne son avis et participe. Je n'ai jamais vu ici d'échauffourée. On arrive toujours à se mettre d'accord. Par exemple, en début d'année s'est posé le problème des heures d'anglais: on a des intervenants d'anglais qui prennent nos classes deux fois 45 minutes durant la semaine. Pendant ces heures, on n'est pas censé ne rien faire. On a donc défini des activités de soutien . Or on a des problèmes de locaux, il fallait définir le public visé, les types d'activités, etc., ça nous a pris deux réunions d'1h et ½. On a décidé de ne prendre qu'un seul élève à la fois, dans notre classe, et c'est l'enseignant de l'élève qui nous demande de faire telle ou telle activité selon les difficultés rencontrées par l'élève au cours des activités qu'il a mises en oeuvre. Il y a une réelle concertation. Il y a toujours une solution commune; peut-être parce que c'est fait en toute convivialité, on n'est pas contraint. On n'a pas l'impression d'avoir la directrice qui nous impose de faire ci ou ça. Ca coule de source: c'est peut-être cette bonne ambiance qui fait qu'on travaille, même si on n'en a pas tellement envie! "
Les parents ont eu l'occasion de nous dire qu'ils appréciaient l'implication des enseignants de l'école élémentaire et de la directrice, et qu'ils redoutaient par comparaison le collège:
"Les enseignants délaissent les élèves: si vous voulez apprendre, vous apprenez, c'est votre problème de ne pas vouloir. On ne s'occupe pas de ceux qui n'apprennent pas."
La directrice considère que les jeunes sont prêts à travailler, qu'ils sont disponibles, que leurs compétences se complètent et qu'ils ont souvent une démarche pertinente.
Des supports pédagogiques divers
A l'école maternelle, les documents pédagogiques, occasions d'expression orale pour les enfants, sont nombreux, divers et rassemblés dans ce que les enseignants appellent "la boîte magique". Le souci est que ces supports soient les plus variés en même temps qu'adaptés à l'environnement des enfants. Ce qui conduit à chercher, selon les circonstances des voyages ou des rencontres, de la documentation aussi bien en langue anglaise de la Caraïbe anglophone proche, que de Porto-Rico, de Saint-Domingue ou de Colombie - documentation qui est ensuite transposée en français par les enseignants -; mais aussi à chercher sur Internet. Ces documents constituent une véritable base de données par thèmes et domaines scolaires, accessibles à tout moment aux enseignants (livres, images, affiches, exercices, diapositives, vidéo…).
"Au niveau du matériel, je responsabilise les collègues en début d'année; et je ne mets de contrôle direct sur rien. Je fais confiance en énonçant dès le départ les règles de conduite: pas de gaspillage, pas d'abus, pas de disparition. Et c'est le cas. Ainsi on a pu progresser en ayant une base de données de plus en plus importante. Le matériel qui servira toute l'année est mis en utilisation libre, en un seul exemplaire; d'où régulation obligée de chacun et concertation pour l'utilisation."
Ces documents servent de support aux révisions nécessaires des acquisitions linguistiques, en particulier pour les non francophones. Certains documents peuvent aussi être empruntés aux méthodes de français langue seconde ou français langue étrangère, bien que les enseignants déplorent l'absence de formation en ce domaine à l'IUFM. Selon la directrice, il est important pour les enfants de ces milieux démunis d'avoir à l'école les moyens technologiques modernes qu'ont chez eux les enfants "bourgeois". Il y a du matériel: des outils audiovisuels en nombre en maternelle (4 téléviseurs par exemple pour 8 classes), des magnétophones, lecteurs de CD dans chaque classe) pour donner de la souplesse aux enseignants dans le choix de leur support de travail.
Dans la circonscription un enseignant, déchargé, forme les enseignants à l'utilisation de l'informatique, fabrique des documents et crée les sites Internet nécessaires. Dans une école la directrice s'est formée à l'utilisation. Elle pousse les enseignants à utiliser l'ordinateur, ouvert dans le bureau, mais aussi les Atsem. Dans l'école élémentaire, un aide-éducateur intervient plus particulièrement dans ce domaine; et un contrat éducatif local (CEL) "Initiation aux nouvelles technologies" indique de manière explicite la volonté de ne pas exclure les enfants du quartier de l’évolution technologique.
C'est grâce à la municipalité, aux ressources ZEP, à la coopérative de l'école alimentée par les parents et les bénéfices des manifestations organisées, que les deux écoles peuvent disposer de matériel suffisant (photocopieur avec maintenance, jeux éducatifs, appareils audiovisuels, livres pour enfants, ordinateurs,…). L’école élémentaire a une BCD qui lui permet de mettre à la disposition des élèves et des enseignants de la documentation : 3600 livres, cassettes documentaires, gérés par un aide-éducateur chargé de son animation. L’intervention systématique dans toutes les classes de l’école sur temps scolaire et avec certains élèves sur le temps autour du repas de midi, assure son utilisation régulière.
Un travail pédagogique par projet
L'école élémentaire, pour mieux donner du sens aux activités scolaires et mieux rendre visibles leurs contenus à l’extérieur de l’école, a décidé depuis quelque temps de produire un journal scolaire "L’écho des sables", qui a été récompensé en 1998-99 lors de la Semaine de la presse à l’école en Guadeloupe, et d’intervenir dans le cadre d’une radio locale sur un créneau intitulé "Radio cité scolaire". Cette année l’équipe souhaite faire de ces projets l’occasion d’un travail pédagogique plus divers, mieux intégré dans les activités scolaires et mieux contrôlé dans ses effets. C’est pourquoi ces deux actions ont été choisies comme occasion de la mise en œuvre d’une démarche plus innovante.
Au niveau des enseignants, l’une d’entre eux explique que pour sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouvait face à ses élèves en début d’année, seule la mise en place d’un projet a pu faire déclencher un processus d’évolution:
"Quand j'ai commencé mes évaluations diagnostiques, j'ai paniqué: je me suis demandé si j'arriverais à faire écrire ces enfants en français. La classe de l'an dernier était assez moyenne. Je me suis embarquée avec eux dans une grande aventure; et je n’ai vraiment réalisé, pris conscience que je pouvais enseigner à ces enfants-là un savoir qu’après les vacances de la Toussaint, quand je me suis remise en question. Ca n'allait pas en expression écrite, je n'avais pratiquement rien fait avec les gamins pendant la première période: je ne savais pas comment m'y prendre. Je sortais de l'IUFM, mais je n'avais pas eu vraiment l'aide qu'il faut pour débuter. Et après mûre réflexion durant les vacances, je suis revenue tranquillement: j'ai mis en place des projets en expression écrite; et puis ça a coulé de source. Il se trouve qu'à la fin de l'année ma classe était très brillante: mes élèves étaient capables de produire de l'écrit (voir le journal de l'école): à la fin tous mes élèves écrivaient en français et en bon français. Pour moi ça a été vraiment génial… C'est le travail par projet qui a fait que tous mes élèves étaient intéressés, que tous ont pu rédiger un compte rendu. Je suis assez stricte sur tout ce que je demande; mais j'étais assez satisfaite. Même l'enfant qui a le plus de difficulté est arrivé à faire un compte rendu. Il savait pourquoi il le faisait. Et je leur ai fait prendre conscience de leurs progrès: je leur répétais sans cesse le rappel de la différence d'avec le début de l'année, en identifiant les progrès."
Une répartition des élèves adaptée à la situation linguistique
Les élèves de l'école maternelle sont répartis en fonction de la scolarisation antérieure et de la date d'arrivée à Saint Martin. Ainsi les grandes sections sont organisées de la manière suivante: une section de primo-arrivants parlant anglais, espagnol ou créole, une autre composée des enfants ayant fait un an d'école maternelle et la troisième des enfants ayant fait deux ans. Les moyennes sections comprennent deux sections comptant les élèves des petites sections, et la troisième les enfants primo-arrivants. Les enseignants ménagent la possibilité de faire passer certains élèves dans une autre section en cours d'année en fonction de leurs résultats. Des moments d'évaluation systématique sont instaurés pour toute l'école: à la rentrée, en janvier et à la rentrée de Pâques. Une importance est accordée au suivi de l'évolution des élèves et au passage en CP. Les enseignants de CP de l'école élémentaire ont été invités à venir voir le travail fait en grande section.
Dans l'école élémentaire, ont été mis en place un CP d'accueil et un CE1 de continuité, classes qui sont destinées à des primo-arrivants, dans lesquelles on utilise une méthode de français langue étrangère. La classe d'initiation (CLIN) est destinée aux enfants de l'âge du CE2 au CM2. Un des enfants avec qui nous avons eu des entretiens, était arrivé à l'école l'année précédente à l'âge de 11 ans, venant de Saint-Domingue. Il bénéficiait du travail en CLIN tous les matins. Il est cette année dans un CM2 normal. Pour la maîtresse de la classe, c'est un enfant "qui en veut", mais qui a de grosses difficultés à l'écrit. Elle reste pourtant persuadée qu'il pourra y arriver, avec une réserve toutefois liée au problème du travail à la maison. Manuel nous dit qu'il fait seul son travail scolaire: sa mère suit elle-même des cours de français et ne peut l'aider ; il ne parle français qu'à l'école. Par ailleurs à l'école élémentaire les élèves peuvent bénéficier de deux heures par semaine d'approfondissement ou d’initiation (anglais ou espagnol) selon que leur langue première est l’anglais ou l’espagnol, ou bien le créole ou le français, grâce à l’intervention de personnels communaux et d’aides-éducateurs. Ce qui est une manière aussi de reconnaître l’enfant dans son environnement socioculturel.
L'aménagement des espaces
Les locaux sont relativement exigus dans les deux écoles compte tenu du nombre d'élèves.
A l'école maternelle, il n'y a ni salle de repos, ni salle polyvalente utile pour la motricité. On y trouve cependant le souci de rendre les locaux les plus agréables possible, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. "Quand ils arrivent à l'école il faut que ce soit beau, vrai, joli…" Les enseignants sont impliqués dans l'aménagement des salles, puisque chaque salle est totalement réaménagée chaque année. En fin d'année tous les affichages sont enlevés, et avec l'aide des enseignants en début d'année, on repeint l'école. Leur implication va parfois jusqu'à acheter du bois de récupération pour arranger un local. Il y a une salle, bureau de la directrice qui sert de salle commune; et le seul meuble de bureau sert à l'ordinateur. Sinon il y a des tables centrales, lieu de discussion, mais aussi de restauration.
A l'école élémentaire, c'est également le bureau de la directrice qui sert de salle de réunion lorsque les enseignants sont en équipes restreintes, sinon ils doivent utiliser la grande salle de la Maison des jeunes qui se trouve à proximité. Une des préoccupations est la propreté des lieux et leur embellissement par les élèves dans le cadre du projet d'école.
On peut considérer que la contrainte de l’exiguïté des lieux est devenue un point d’appui pour renforcer l’ambiance conviviale et organisée du travail.
2. Des partenaires médiateurs et complémentaires (ATSEM, aides-éducateurs, intervenants extérieurs)
Le travail avec les ATSEM
A l'école maternelle, la directrice n'a pas souhaité bénéficier d'aide-éducateur: l'école n'a pas des locaux suffisamment vastes pour multiplier la présence d'adultes dans l'école ; deux par classe sont le maximum utile sans gêne mutuelle. Pour la directrice la priorité est de ne pas considérer l'Atsem comme une femme de ménage aussi bien aux yeux des enseignants que des parents et des enfants.
"Je déteste trouver dans une école des gens qui ne font que du ménage. On les cantonnait dans un rôle de ménage; je dis au collègue qu'on ne peut pas accepter de mettre des humains dans un rôle qu'on n'accepterait pas de faire. Je fais moi-même mes coloriages, découpages…: une Atsem est là pour nous aider."
Elles ont un rôle d'autant plus valorisant qu'elles parlent les langues des enfants, ce dont ne sont pas capables les enseignants à leur arrivée à Saint Martin: elles ont donc souvent une fonction de médiatrice entre les enseignants et les enfants ou entre les enseignants et les parents. Elles peuvent donc aider au travail éducatif dans les classes.
"Je suis très sévère sur les roulements dans l'école; mais pour le travail aussi: j'ai essayé de leur faire comprendre que je voulais des agents pour aider les enfants en classe. Elles ont été contentes qu'on les revalorise."
Ainsi elles ont décidé elles-mêmes de se faire aussi un uniforme qu'elles préparent chaque année dans le plus grand secret. Souvent elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école bien qu'elles eussent pu aller plus loin. Elles ont donc à cœur leur rôle éducatif et ont envie d'apprendre. Lors de la réunion de rentrée, elles reçoivent elles aussi un livret avec un "mot" de la directrice qui les encourage à progresser et réaffirme leur place dans l'école ainsi que toutes les informations nécessaires pour l'année et la définition de leurs tâches. Les Atsem bénéficient d'une certaine autonomie: elles ont leurs propres réunions d'organisation, elles ont le code de la photocopie par exemple. La directrice est satisfaite de leur travail: "il n'y a jamais d'Atsem en train de bavarder dehors". Elles ont également un rôle important à la cantine pour apprendre à manger aux enfants, car certains boivent encore le biberon à la maison ou ne savent pas utiliser les couverts. Elles sont vigilantes pour développer l'autonomie des enfants.
Les aides-éducateurs, les intervenants extérieurs et l’articulation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
A l'école élémentaire, les aides-éducateurs et les intervenants extérieurs ont des services bien définis dans l’emploi du temps des enseignants. Ils reçoivent de la directrice des documents par cycle. Leur intégration dans les activités pédagogiques a l’avantage de donner de la souplesse à l’organisation, même si certains enseignants, en particulier les débutants, ont du mal à intégrer leur présence dans la cohérence de l’enseignement, craignant en particulier la première inspection. Pour la directrice, il n’y aura de bénéfice durable que s’ils interviennent régulièrement dans les activités scolaires. Deux agents communaux contractuels et une aide-éducatrice interviennent dans le cadre de l’initiation ou de l’approfondissement en anglais et espagnol. Les autres aides-éducateurs participent à l’accueil et à la surveillance des élèves, à la mise en place de groupes d’apprentissage différencié, à l’éducation à la citoyenneté, en soutien scolaire, en animation lecture et documentation, en EPS et en nouvelles technologies.
Nous avons pu nous entretenir avec deux d’entre eux. Originaires de Sandy Ground, ils veulent participer à l’évolution du quartier. Par rapport aux enseignants, les aides-éducateurs se perçoivent plus proches des élèves, en particulier parce que, même s’ils ont l’occasion de faire des observations aux élèves, de les "morigéner", ils n’ont pas la fonction d’évaluation-contrôle; cependant les enfants les appellent comme les enseignants "maître ou maîtresse, monsieur ou madame". Ils ont en particulier l’avantage de pouvoir mieux communiquer avec les élèves dans la mesure où ils parlent les langues des enfants (anglais, espagnol, créole et français). Cette capacité à parler les langues des élèves est un élément important du respect que l’on peut obtenir des élèves à Saint Martin. En effet certains élèves peuvent jouer de ce pouvoir certes ambigu de parler sans être compris par l’enseignant - "Je m’adresse à qui je veux dans ma langue", ainsi que le souligne une des aides-éducatrices, reprenant l'expression d'un enfant. Ils participent également aux activités dans les temps périscolaire et extrascolaire. Ce qui renforce leur relation avec les élèves. Ils se considèrent comme des médiateurs linguistiques et pensent que leur tâche est de "donner un coup de main aux enseignants sur une partie des problèmes de l’école", en particulier dans le domaine des comportements. Mais ils ont également des activités plus directement éducatives, par exemple dans la connaissance des livres, l’animation de recherche documentaire sur thèmes, etc. Les enfants semblent apprécier leurs interventions : "Ils peuvent nous expliquer quand on ne comprend pas." nous disent Manuel et Ginette .
L’école élémentaire a considéré que le cadre CEL pouvait être une ressource supplémentaire pour améliorer les résultats des élèves.
|
|
|
|
|
|
||
| Initiation aux nouvelles technologies |
1 enseignant de l’école Aide-éducateur + animateur BAFA Les enseignants dans le cadre de leurs activités |
Temps extrascolaire Temps périscolaire Temps scolaire |
| Ateliers de langue | Intervenants extérieurs et aide-éducateur |
Temps extrascolaire Temps périscolaire Temps scolaire |
| Musique et chant | Intervenants extérieurs et aide-éducateur |
Temps extrascolaire Temps périscolaire Temps scolaire |
| Travaux manuels | Enseignant et aide-éducateur + animateur BAFA |
Temps extrascolaire Temps périscolaire |
| Théâtre et audiovisuel | Enseignant et aide-éducateur + animateur BAFA |
Temps extrascolaire Temps périscolaire |
| Jeux de société | Enseignant + animateur BAFA |
Temps extrascolaire Temps périscolaire |
| Études surveillées et accompagnement scolaire | Enseignant et aide-éducateur + animateur BAFA + parents volontaires |
Temps extrascolaire Temps périscolaire |
|
|
||
| Cours de rattrapage scolaire, français et mathématiques (CP-3ème) | Étudiants | Temps extrascolaire |
| Ateliers de vacances (6-12 ans) | Aides-éducateurs + animateur BAFA | Temps extrascolaire |
| Lecture à la sortie de l’école | Aides-éducateurs + animateur BAFA | Temps périscolaire |
| Initiation à la langue française et alphabétisation (adultes) | Enseignants | Hors temps scolaire |
Dans les CEL proposés par l’école, certains enseignants participent aussi à ces activités hors du temps d’enseignement. Il sera intéressant d’observer quel bénéfice ces enfants, peu aidés dans leur milieu familial, tireront d’un dispositif qui peut articuler savoirs scolaires et savoirs extrascolaires. Les CEL ont aussi pour but de proposer aux enfants un cadre d’activités en dehors du temps scolaire, dans la mesure où les familles du quartier n’ont pas les moyens de prendre en charge leur temps libre. La relation étroite avec l’Association "Centre Culturel" implantée à Sandy Ground, relancée par la directrice à son arrivée, dans le cadre de ses attributions municipales, est un atout important dans cette perspective. Même si les CEL n’ont pas encore reçu de réponse officielle, certaines activités présentées ont déjà commencé avec les enseignants volontaires, les aides-éducateurs et les intervenants extérieurs.
3. Des partenaires à responsabiliser: le travail avec les parents
La question essentielle a été de rendre visible une image de l'école, lieu de socialisation, d'éducation et d'instruction, en particulier aux yeux des parents et dans le quartier en général: "Résultats, Uniforme et Propreté" sont les mots d'ordre, comme le dit une des directrices ; ou comme l'expriment des enseignants, ils ont le désir que l'école soit vécue par les parents comme un "îlot de paix, de moralité et d'espoir dans une île en crise".
A l'école maternelle, en 1992, selon la directrice, l'école fonctionnait, mais il manquait les relations avec les parents. "Les parents avaient peur de l'école. Le premier jour quand j'ai dit bonjour, certains ont sursauté" Il est donc nécessaire de les accueillir, "d'autant plus que les enseignants, ou plutôt les enseignantes de l'école, représentent aux yeux des parents et en particulier des mères, tout ce qu'elles ne sont pas ou n'ont pas: jeunesse, beauté, instruction, voiture; et de plus sont étrangères à l'île!" Ils restaient loin de l'entrée et "lâchaient" leurs enfants.
A l'école élémentaire à la même époque, la directrice remarque que les parents semblaient n'avoir aucun repère de fonctionnement à l'école: "il a fallu apprendre aux parents à se repérer systématiquement dans l'école deux fois par semaine au départ. On avait aussi à lutter contre une certaine forme de vulgarité des parents. Les enfants venaient habillés soit avec "le ventre à l'air", soit en robe endimanchée à volants."
L'information pour tous
A l'école maternelle, les deux points forts sont l'accueil systématique à l'entrée de l'école et le principe que, "même s'il y a un comité de parents, l'école c'est tous les parents d'élèves. Et si j'ai besoin d'eux, je fais appel à n'importe quel parent au moment voulu." Quand il y a une information à faire passer aux parents, dont une grande partie ne sait pas lire le français, la directrice attend que la plupart des parents soient massés devant la porte en fin de journée pour afficher un grand panneau de papier kraft sur lequel est rédigée l'information utile dans les quatre langues pratiquées (français, créole, anglais et espagnol); les petits papiers adressés aux parents par le biais des enfants s'étant avérés inefficaces. Il y a également l'utilisation d'un code couleur selon les sections. Mais cette année pour mieux responsabiliser les parents et les faire évoluer, le message porté sur le panneau renvoyait à une feuille donnée à chaque parent qui informait des dates scolaires avec recommandation orale de l'afficher à la maison dans sa cuisine en permanence! Autre exemple, pour procéder aux élections de parents, on ne met pas l'urne dans le bureau; les élections se font dans la cour après avoir fait rentrer les parents, de même que la lecture intégrale du règlement intérieur lors de la réunion de rentrée - lecture avec traduction simultanée dans les différentes langues. En effet les portes de l'école ne sont ouvertes qu'à certains moments pour obliger les parents à limiter leurs irruptions intempestives.
De même des parents de l’école élémentaire sont conscients que ce souci d'informer quand c'est nécessaire, permet de résoudre les problèmes. Et à leur tour les enseignants constatent un plus grand désir d'être informé de la part des parents. De toute façon, ils sont tenus de venir à l'école voir les enseignants pour récupérer le livret d'évaluation. Les parents d'élèves peuvent venir voir les enseignants pendant la récréation, à l'interclasse de midi ou bien en fin d'après-midi. Une des aides-éducatrices a dans l’école une fonction particulière de médiation à l’égard des parents.
Confiance et exigence
L'école est une institution qui doit aider les parents à assumer leur responsabilité éducative. "Il a suffi que les parents voient qu'ils étaient aimés, qu'ils n'étaient pas rejetés: ils sont heureux, parce que quelqu'un les considère. A la fin de chaque trimestre tous les collègues doivent recevoir tous les parents d'élèves l'un après l'autre à leur bureau pour faire le bilan de l'enfant. Ma grande sévérité n'a pas fait peur aux parents. On ne peut pas faire marcher un établissement sans une certaine discipline personnelle. Ils font beaucoup confiance" dit l'une des directrices.
Au conseil d'école de 1993 les uniformes ont été institués en concertation entre les deux écoles, parce que les directrices se sont rendu compte qu'il y avait socialement un problème: souvent les enfants portaient des vêtements de récupération et les parents ne faisaient pas d'efforts. Il fallait obliger les parents à s'occuper des enfants. Les directrices et comité de parents ont cherché soit des tissus et des couturiers, soit des marchands qui pouvaient proposer des uniformes à des prix accessibles (40 dollars environ par exemple pour les trois uniformes nécessaires pour une année de l'école élémentaire). Et les parents ont suivi pour faire la dépense de départ. A partir de ce moment, l'école est devenue de plus en plus propre aux dires des directrices. A l'école élémentaire on a ajouté le badge de l'école, sorte de d'écusson brodé qui permet d'identifier dans la rue l'appartenance de l'élève. A l'école maternelle, la directrice insiste sur sa vigilance permanente à l'égard de la propreté (hygiène douteuse, cheveux non coiffés).
"J'appelle les parents à mon bureau, on discute, je donne de petits conseils. Je peux faire appel au médecin, au dispensaire. J'ai cherché dans le quartier deux médecins accueillants à cette population pauvre auxquels pouvoir adresser les parents en toute confiance. C'est tout ça qui a fait rentrer les parents dans l'école. Même s'ils ne parlent pas le français, je les invite à rentrer dans les classes; et ça fait plaisir aux enfants de voir leur maman, leur papa dans la classe."
D'après les deux directrices, l'exigence de la ponctualité des élèves, du mot d'excuse lors de l'absence des élèves, ou du certificat médical, même suite à l'appel téléphonique aux parents n'a pas été facile à obtenir. Il faut quelquefois aller au domicile des parents dans le dédale des petites impasses de Sandy Ground. Le concierge de l'élémentaire qui est du quartier, parfois s'en charge. Quand un parent est convoqué avec son enfant et qu'il ne se présente pas, au bout de trois avertissements infructueux, l'élève peut être exclus pendant un jour.
Convivialité et participation collective
Les fêtes organisées par les écoles jouent un rôle important dans la vie du quartier à la fois sur le plan scolaire et sur le plan des relations entre les enseignants et les parents, mais aussi entre les différentes communautés vivant dans le quartier. Un des soucis des enseignants est de développer la tolérance entre les groupes ethniques au niveau des parents, si l'on veut aussi réduire l'agressivité entre les enfants.
La directrice de l'école maternelle souligne par exemple la fierté des parents lorsqu'ils entendent leurs enfants réciter des poésies en français - , "des vraies", souligne-t-elle. Les deux grandes fêtes de la maternelle avec les parents sont Noël et Carnaval. A l'école élémentaire c'est par exemple l'organisation d'un grand léwoz qui est en Guadeloupe une fête traditionnelle avec gros-ka. Une enseignante explique:
"Ici , on a des manifestations à chaque fin de période. On a même une manifestation phare qui est le léwoz, qui réunit le personnel enseignant, tout le quartier et même tout Saint Martin, puisqu'on a une large publicité: on recueille des fonds, utilisés une année pour la BCD, l'an dernier pour 2 ordinateurs. Chaque classe fait une lettre pour solliciter des sponsors et on nous envoie pas mal de choses. Les parents font le repas. On fait venir un groupe de la Guadeloupe. Toutes les tables sont installées du côté du lagon. Et dans les salles de classe, les enseignants vendent des gâteaux, les plats cuisinés, des boissons… Et le lendemain une bonne partie vient nettoyer; tout le monde s'y met, c'est super! même les plus grincheux: on ne peut pas dire non à la directrice ! Non seulement les enseignants travaillent à l'organisation, mais ils misent aussi! Il y a une retraite au flambeau avec les élèves, qui ouvre le léwoz…. Il y a aussi le Chanté Nwel en décembre avec un groupe. C'est important pour le quartier. Certains parents ne viennent que ces jours là."
Les parents que nous avons rencontrés, comprennent cette démarche: "Avec la directrice, c'est la fête quand il faut et le travail quand il faut." Dans le même esprit de participation collective, les élèves du cycle 3 sont invités à prendre en charge la vente de sandwichs, de jus de fruits et de petites glaces confectionnés par des personnels de l'école dans une petite case aménagée – "la case à pops".
L'attente des parents à l'égard de l'école
Elle est d'abord sociale. Mais de plus en plus, on voit les parents s'inquiéter des progrès de leurs enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir apprendre à lire, à vouloir apprendre à parler le français : voir le CEL proposé par l'association "Centre Culturel" qui fait suite à des actions antérieures de même ordre dans le cadre du contrat de ville et qui vise explicitement les parents d'élèves scolarisés dans le quartier afin de les aider à mieux suivre la scolarité de leurs enfants. Lorsque nous avons fait une première réunion avec les parents au début de cette année pour parler de la Charte - une quarantaine de présents malgré son caractère un peu improvisé et en l'absence des directrices et enseignants - nous avons été sensibles au fait que les parents ont manifesté un réel effort pour parler le français et ont posé des questions tout à fait pertinentes: la demande d'exemples de projets liés à la Charte, le souci de savoir si le projet Charte ajoutait ou non quelque chose au projet d'école, la question des langues, la demande de documentation et la possibilité de prochaines rencontres.
Certains parents originaires de Saint Martin ont conscience de l'importance de l'école aujourd'hui, de l'école française, ainsi que l'exprime un parent: "si on veut demain diriger chez nous, il faut diriger la parole, sinon on va mourir. On doit faire cet effort de parler français" ; tout en soulignant le fait que contrairement aux autres régions de la Guadeloupe, à Saint Martin, on ne s'est pas suffisamment attaché à l'importance de l'éducation des enfants, parce qu'on a trop cru en le seul pouvoir de l'argent-dollar gagné relativement facilement à une époque dans l'hôtellerie. L'apprentissage de la langue française apparaît aux yeux de certains parents comme une priorité qu'il faut renforcer, sans nier totalement l'apport des langues premières des enfants. Car pour ces parents, il faut que les enfants de Saint Martin aient d'autres perspectives que les seules filières de l'hôtellerie et de la mécanique, qu'ils puissent occuper ici des postes de responsabilité qui impliquent toujours la langue française.
Dans le contexte complexe où les enseignants de ces écoles exercent leur métier, leur premier point d’appui est de se donner les moyens d’affronter la dimension relationnelle des situations auxquelles ils se trouvent confrontés. Ces relations qui sont conflictuelles au départ du fait de la distance sociale, culturelle, linguistique, économique… entre les différents partenaires, sont travaillées pour devenir les axes d’orientation de l’organisation pédagogique et scolaire. Elles sont travaillées sur le plan socioaffectif au sein même des équipes enseignantes grâce à une direction stricte et bienveillante, exprimée sur un mode de gaieté ou d’humour, et des adjoints jeunes et disponibles le plus souvent ; elles sont structurées par des dispositifs et des objets qui les rendent manifestes, les stabilisent et les régulent. Le second axe est le souci de l’appropriation de l’espace scolaire par tous, de telle sorte que chacun y ait sa place, reconnaisse cette place et s’y sente responsable, en favorisant une circulation des personnes à la fois souple et réglée.
La difficulté majeure à laquelle les enseignants de ces écoles ont à faire face, est de savoir s’ils pourront vraiment obtenir des élèves tels qu’ils sont, les résultats attendus par l’école. Il s’agit en particulier à l’école élémentaire d’étudier le lien entre les objectifs de socialisation et les apprentissages disciplinaires en sorte que le travail sur les uns entraîne une amélioration des autres. Pour l’école maternelle, il s’agit d’examiner l’articulation entre les différentes activités de langage dont l’enfant peut bénéficier, leur cohérence et leur pertinence étant assumées par le biais du travail en équipe. Et c’est là où la perspective de la Charte et de la recherche qui l’accompagne, pourra peut-être aider les enseignants à mieux identifier les effets de leurs actions grâce à une analyse distanciée et une formalisation conceptuelle.